Le problème du Mesri, c’est le Mesri Les dépenses universitaires : charges ou investissements ?
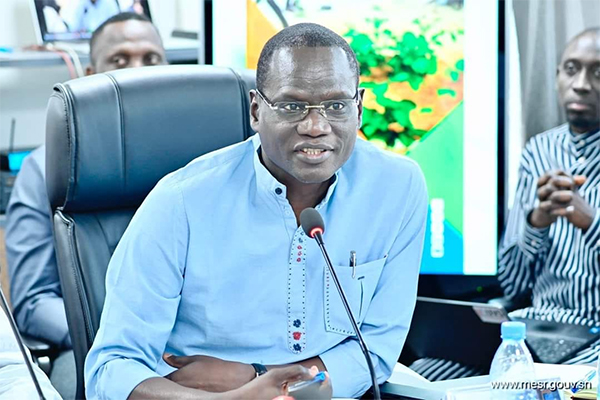
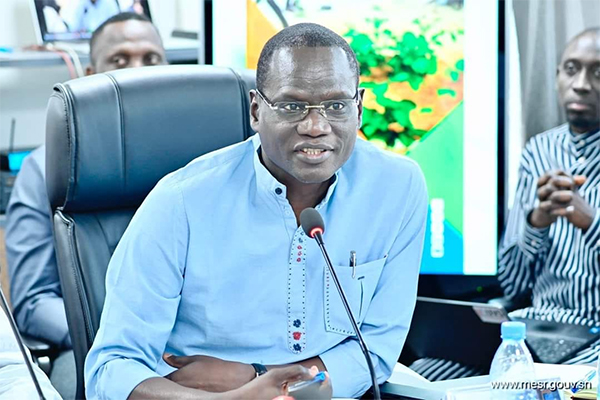
Le ministre de l’Enseignement supérieur commet une erreur stratégique et intellectuelle en présentant les dépenses liées aux étudiants comme une lourdeur budgétaire qui freine le développement. Ce discours, au-delà de sa portée politique, révèle une conception dépassée du rôle de l’université dans l’économie nationale et dans le projet de société.
Loin d’être de simples charges, les dépenses universitaires constituent des facteurs dynamiques de croissance, comme le démontrent les travaux fondateurs de la théorie de la croissance endogène. Le modèle circulaire de Robert Barro, notamment, met en lumière le rôle moteur des investissements dans le capital humain, la recherche et l’innovation. Autour des espaces universitaires, gravitent des économies d’échelle qui profitent directement à la croissance du Pib : commerces, transports, logements étudiants, prestations de services, stages rémunérés, recherche appliquée, etc. L’université est un écosystème économique à part entière.
Dans ce contexte, l’alternative entre financement public et privatisation de l’enseignement supérieur devient un véritable choix de société. Les modèles purement privés, aussi répandus qu’ils soient, ne sont ni soutenables ni efficaces dans nos contextes africains. Pourquoi ? Parce qu’ils excluent une large partie de la population et minent la mission de service public de l’université, creusant les inégalités et détournant l’enseignement supérieur de ses finalités structurantes.
Le retrait de l’Etat du financement de l’enseignement supérieur entraîne une dépendance accrue à l’expertise privée, souvent coûteuse et peu adaptée. Le cas français en est un exemple édifiant : entre deux mandats présidentiels, ce sont plus de 5 milliards d’euros qui ont été versés à des cabinets de conseil comme McKinsey, suscitant un débat vif sur la transparence et la souveraineté des politiques publiques. Ce modèle de fragmentation des compétences est inefficace. A l’inverse, les Etats modernes choisissent de réhabiliter l’expertise publique en investissant dans la formation, la recherche et les capacités internes de planification.
Les dépenses universitaires élevées ne sont donc pas dues à un nombre d’étudiants ingérable, mais à des dysfonctionnements systémiques : mauvaise gestion des calendriers académiques, surcharge des maquettes pédagogiques, sous-effectif chronique d’enseignants, stagnation des chantiers d’infrastructures, retards dans le paiement des bourses, conditions de vie indignes dans les campus, etc. Ces failles de gouvernance ont un coût humain, social, psychologique et économique bien plus lourd que le simple soutien budgétaire aux étudiants.
Ce coût est invisible, mais réel : il pèse sur la santé mentale et physique des jeunes, altère la qualité de leur formation, freine leur insertion professionnelle et engendre une perte de rendement pour l’Etat lui-même, qui investit sans obtenir les effets attendus en matière de développement. Dans ces conditions, ce n’est pas l’étudiant qui coûte cher, mais le système mal organisé qui produit de l’inefficacité à grande échelle.
Il est temps de poser le vrai débat : veut-on une société fondée sur la connaissance, l’innovation, la souveraineté intellectuelle ? Alors, il faut assumer l’investissement dans l’enseignement supérieur comme un levier d’émancipation, de compétitivité et de cohésion sociale. Comment expliquer au Mesri que pour un ministre du 21ème siècle, la dépense publique n’est pas qu’une charge, c’est une construction stratégique de l’intérêt général ?
Je termine par ce passage du professeur Michel Bouvier qui rend parfaitement compte des errements du Mesri : «Qu’il paraît anachronique que les dépenses de recherche et développement soient encore classées dans la catégorie des consommations intermédiaires alors que la connaissance, le savoir, la capacité de créer, d’inventer, font partie au sein de la société «cognitive» qui est maintenant la nôtre, des éléments moteur de la croissance économique.»
Omar SADIAKHOU
Etudiant-Chercheur, Maître en Droit public/Ugb

