Restituer le patrimoine africain
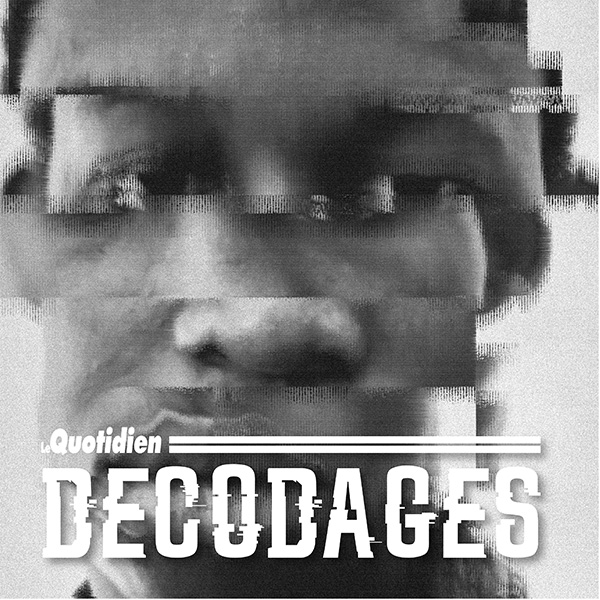
La période que traverse la France avec ses anciennes colonies est semblable à ce que les inconditionnels du Général De Gaulle appellent la «traversée du désert», c’est-à-dire de 1946 à 1958. Dans le rapport remarquable qu’il a produit sur la commande du Président Macron, en prélude au Sommet Afrique-France tenu à Montpellier le 8 octobre 2021, Les nouvelles relations Afrique-France : Relever ensemble les défis de demain, l’historien Achille Mbembe pense que le glas d’un cycle de notre histoire commune a sonné, et que les logiques de domination et de corruption réciproque, communément appelées Françafrique, sont ainsi révolues. Pour les élites françaises, qui ont longtemps pensé l’Afrique avec une «armature intellectuelle datant littéralement de la fin du XIXe siècle», les grandes transformations démographiques, politiques, économiques, sociales… du continent sont venues sans crier gare. L’ancien pré carré est subitement devenu une terre hostile et hasardeuse, où il faudra désormais entrer en compétition avec d’autres puissances -la Russie, la Chine, la Turquie, les pays du Golfe- pour espérer y survivre. Qui plus est, comme on peut aisément le constater, la France n’a plus les moyens de ses ambitions en Afrique ; elle semble revivre, dans une certaine mesure, le même scénario au début des années 1960, où ses colonies subsahariennes étaient devenues suffocantes en raison surtout de la guerre d’Algérie et des pressions de la Communauté internationale, et qu’il fallait les libérer au plus vite.
Lire la chronique – Du souverainisme au kémalisme
Les historiens, les sociologues, les politologues, les journalistes (la plume de Antoine Glaser est assez prophétique), entre autres chercheurs, ont démontré, livre après livre, les tares de la politique africaine de la France : les ingérences pour soutenir des régimes autoritaires au nom de ses intérêts avec des chefs d’Etat en chefs de guerre, au point de déployer des forces militaires pour réprimer des populations civiles ; les organisations plus ou moins secrètes de coups d’Etat pour conjurer des présidents qui lui sont hostiles ; les indignations à géométrie variable pour défendre les valeurs de justice, de démocratie, de liberté et de droits de l’Homme, témoignant d’une manière générale l’incapacité de l’Occident à propager réellement les valeurs de sa civilisation au-delà de ses frontières culturelles, car n’ayant pas, comme le regrettait Paul Valéry, la «politique de sa pensée» ; des ambassadeurs inamovibles qui s’activent dans la vie politique de leur pays hôte en prenant des positions publiques ; les assassinats ciblés des leaders nationalistes ; l’inégalité structurelle des rapports commerciaux, etc.
En un mot comme en mille, l’histoire que nous avons en partage comporte, écrit le poète-Président Léopold Sédar Senghor avec sa lucidité sans exemple, des «pages très cruelles [dont] le rappel n’est pas destiné à raviver d’anciennes blessures, mais à situer très exactement le sens de nos solidarités».
Dans l’Ouest africain, et paradoxalement au Sénégal, le souverainisme est un sport national. Les militaires de l’Alliance des Etats du Sahel (Aes) s’appuient sur le rejet violent de la France pour construire un discours susceptible de répondre à une demande d’une bonne partie de la jeunesse. Les questions posées (l’avenir du franc Cfa, la présence des bases militaires, les rapports commerciaux, entre autres) sont légitimes, mais les réponses apportées traduisent une attitude simplette et un art de la critique superficielle. Les actions des autorités politiques contre l’Hexagone ont trouvé, au cours de ces dernières années, des relais puissants sur les réseaux sociaux, avec ce qu’on appelle les influenceurs -le mot me donne un haut-le-cœur. Comme tous les adversaires de l’Occident, ces piètres ambassadeurs du panafricanisme ne font que lantiponner. Ils ne tiennent pas un discours porteur de propositions alternatives et réalisables à même d’amorcer une rupture avec l’ordre ancien. Les mots barbares et anachroniques tels que «néocolonialisme» et «impérialisme» sont psalmodiés comme une antienne. La promotion de la haine (la nécrose) fait le miel des soi-disant nouvelles voix de l’Afrique.
Le 28 novembre 2017, à l’Université de Ouagadougou, au Burkina Faso, le Président Macron, dans sa volonté manifeste de refonder la relation Afrique-France sur de nouvelles bases, avait déclaré vouloir que les «conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain à l’Afrique». Depuis cette déclaration, en gage de bonne volonté, plusieurs œuvres dérobées durant la colonisation ont été restituées aux pays africains. Le Bénin a eu droit à une réparation ; le Président Macky Sall a reçu, en novembre 2019, le sabre dit de El hadj Omar Tall ; la Côte d’Ivoire a récupéré son tambour parleur «Djidji Ayôkwé». Ce 26 août, toujours dans la même logique, Paris rendra à Madagascar trois crânes sakalava.
Lire la chronique – Réinventer l’Apr
Le Président Macron a compris, dès son accession au pouvoir, que la question mémorielle est au cœur de la redéfinition de nouveaux rapports entre la France et ses anciennes colonies. La création de nouveaux imaginaires sans lesquels il n’y a pas d’avenir possible, passe obligatoirement par la reconnaissance et la destruction des infrastructures psychiques engendrées par l’histoire. Cette utopie émancipatrice exige de prime abord la restitution du patrimoine africain à l’Afrique. C’est la raison pour laquelle il fut demandé à Felwine Sarr et à Bénédicte Savoy de préparer un rapport sur les modalités de ce qui fut annoncé dans le discours de Ouagadougou comme des «restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain à l’Afrique». Les chercheurs firent diligence, et leur rapport devint un livre foisonnant (Restituer le patrimoine africain, Philippe Rey et Seuil, 2018) non pas seulement sur le processus de restitution, mais aussi sur le rôle que celui-ci pourrait jouer dans la redéfinition de futures relations entre musées du Nord et du Sud et, partant, entre les différentes économies.
Lire la chronique – Gouverner au milieu des polémiques
Le «combat de l’Afrique pour son art» est aussi un combat pour entamer un nouveau cycle de son histoire avec la France. Croire en toute lucidité au devenir africain du monde tout en s’ouvrant aux apports féconds des autres : tel est le chemin pour garantir une vie décente aux 2, 5 milliards d’habitants qui peupleront le continent d’ici 2050, soit un quart de la population mondiale. Les défis liés à l’éducation et à la disponibilité des ressources sont immenses, et nous avons nécessairement besoin, professe à juste titre Achille Mbembe, des «acteurs proches, ceux avec lesquels l’Afrique a une longue histoire en partage, et avec lesquels elle cherche à bâtir un futur en commun». Puisqu’«il n’y aura désormais de maîtrise de son destin que partagée», ce souverainisme ambiant est une gaminerie que nous ne pouvons pas nous permettre.
Par Baba DIENG

