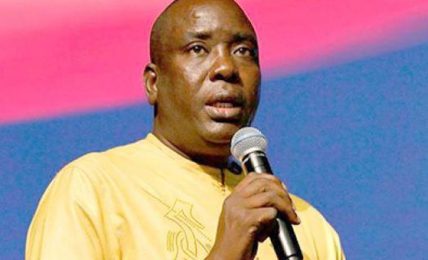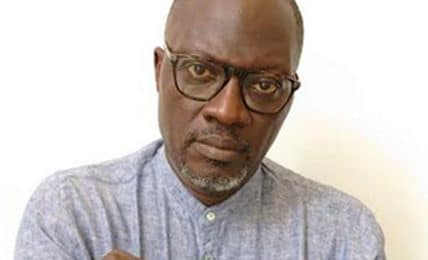Le Sénégal, souvent cité comme modèle démocratique en Afrique de l’Ouest, traverse une période de turbulences où les fondements de son Etat sont remis en question. Deux failles majeures semblent cristalliser les inquiétudes : la perception de l’Etat comme non continu et la faiblesse de ses institutions face au pouvoir central.
I. Une démocratie en perte de mémoire
Depuis quelque temps, l’alternance politique, bien que signe de vitalité démocratique, s’accompagne trop souvent d’une rupture brutale avec les politiques précédentes. Chaque nouveau régime semble vouloir «réinventer» l’Etat, au lieu de s’inscrire dans une logique de continuité institutionnelle.
«L’héritage désastreux d’une gouvernance patrimoniale et kleptocratique freine toute vision à long terme», analyse le professeur Moustapha Kassé, Doyen honoraire de la Faseg.
En effet, l’abandon du Plan Sénégal émergent (Pse) illustre parfaitement cette rupture étatique. La vision du plan Sénégal 2050 aurait dû être une rectification des axes faibles du Pse, en rationalisant les dépenses afin de les orienter dans les secteurs d’activités comme la santé, l’employabilité des jeunes, la formation, le leadership des jeunes, etc.
Cette absence de mémoire institutionnelle engendre :
– Des politiques publiques instables, souvent abandonnées avant leur maturation.
– Une personnalisation du pouvoir, où l’Etat devient le reflet du dirigeant en place.
– Une faible culture de la reddition des comptes, rendant difficile l’évaluation des engagements passés.
II. Des institutions sous tutelle
Dans une démocratie saine, les institutions doivent être autonomes, équilibrées et garantes de l’intérêt général. Or, au Sénégal, leur fragilité face au pouvoir central est préoccupante… «La démocratie sénégalaise est confrontée à un grave tournant», avait alerté la Fédération internationale pour les droits humains (Fidh), après la dissolution du principal parti d’opposition d’alors, Pastef, par le ministère de l’Intérieur. «Le déficit de débat public est l’une des grandes faiblesses de notre démocratie», affirme El Hadj Ibrahima Sall, président de la Commission d’évaluation des politiques publiques.
Cette centralisation excessive se traduit par :
– Une instrumentalisation des institutions judiciaires et législatives, qui s’explique par l’influence de l’Exécutif dans la prise de décision (le vote du projet de loi relatif à l’amnistie sélective).
– Une répression des voix critiques, comme le montre l’arrestation de journalistes pour des contenus jugés sensibles.
– Une Société civile affaiblie, peinant à jouer son rôle de contre-pouvoir.
– Des ministres réduits au silence et incapables de porter la lumière sur certaines questions épineuses juste pour plaire à leur tutelle.
Face à ces constats, des voix s’élèvent pour réclamer un renouveau démocratique. Le Front pour la défense de la démocratie et de la République, la Société civile, etc., récemment formés, appellent à «dénoncer la mauvaise gouvernance, l’injustice, l’arrestation arbitraire et réclamer la libération des prisonniers politiques».
III. Vers un sursaut citoyen et une refondation
Ce sursaut citoyen pourrait être l’amorce d’une refondation de l’Etat, fondée sur :
– La consolidation des institutions.
– La formalisation du débat public.
– La valorisation de la mémoire politique et administrative.
Le Sénégal ne manque ni de talents ni de ressources. Mais pour que l’Etat retrouve sa force, il doit être pensé comme une continuité, porté par des institutions solides, une citoyenneté active couronnée par des valeurs telles que l’éthique et la déontologie…
Pour refonder notre Nation sénégalaise, il ne suffit pas seulement de corriger les failles liées à la gouvernance, c’est aussi réinviter le cordon ombilical entre gouvernants et gouvernés. Et pour y parvenir, l’éthique doit être au centre de nos débats publics afin d’offrir à la jeunesse sénégalaise un nouveau «Mindset».
Gabin Bernard NASSALAN,
Secrétaire Général du Mouvement Contribution Citoyenne
Ronald Christian KANFOUDY