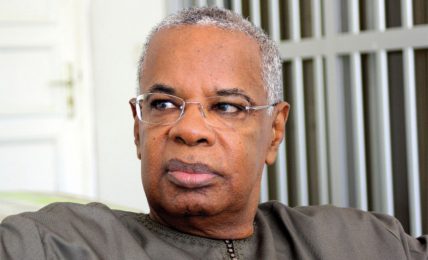Le Sénégal doit réagir avant qu’il ne soit trop tard.
La situation au Mali est aujourd’hui alarmante. Les attaques se multiplient, des villages entiers sont abandonnés, les routes coupées, et l’Etat malien recule face à la montée en puissance du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (Jnim), branche sahélienne d’Al-Qaïda. Ce constat n’est pas seulement inquiétant pour le Mali : il représente une menace directe pour toute la sous-région.
Le Jnim illustre parfaitement la manière dont le terrorisme peut se développer lorsqu’un Etat est affaibli. Né en mars 2017 de la fusion de plusieurs groupes islamistes, il est dirigé par Iyad Ag Ghaly, ancien rebelle devenu figure du djihad sahélien. Son objectif n’est pas seulement militaire : il cherche à instaurer la charia, éliminer les influences étrangères et s’imposer comme le seul acteur légitime dans les zones abandonnées par l’Etat.
Cette stratégie fonctionne : partout où l’Etat recule, le Jnim s’installe, impose sa «justice» et collecte des impôts, mettant en place une gouvernance fondée sur la peur. Les conséquences sont multiples et dramatiques. Sur le plan social, des milliers d’écoles et d’hôpitaux ont fermé, des centaines de milliers de Maliens sont déplacés, et la peur paralyse la vie quotidienne. Sur le plan politique, l’Etat de Transition, pourtant soutenu par Moscou, peine à reprendre le contrôle du territoire. Le départ des forces françaises a laissé un vide stratégique que les djihadistes exploitent. Sur le plan économique, routes et marchés sont paralysés, et des taxes illégales imposées par les groupes armés asphyxient l’économie. Enfin, l’institutionnel s’effondre : préfets, magistrats et enseignants ont fui, laissant le Jnim dicter sa loi. Ces dynamiques ne concernent pas seulement le Mali. La porosité des frontières sahéliennes crée un risque concret pour le Sénégal. Les régions maliennes proches de la frontière sénégalaise, comme Kayes, Nioro et Kéniéba, subissent déjà des infiltrations liées au Jnim.
Si ces zones restent marginales aujourd’hui, elles pourraient demain servir de tremplin pour l’extension de la menace djihadiste vers le Sénégal. La jeunesse désœuvrée et le chômage dans ces régions frontalières constituent un terreau fertile pour la radicalisation. Face à cette menace, l’inaction serait une faute stratégique. Le Sénégal dispose d’atouts uniques, notamment la confiance entre l’Etat et la population, mais il doit agir de manière préventive et coordonnée.
Cela implique de renforcer la surveillance des frontières, d’investir dans le renseignement de proximité et de prévenir la radicalisation à travers l’éducation, les autorités religieuses et la mobilisation communautaire. La création d’un dispositif de veille interrégional, associant Armée, gendarmerie, élus locaux et Société civile, est une mesure indispensable pour protéger les zones vulnérables. Il est clair que le feu qui brûle aujourd’hui aux portes de Bamako ne restera pas confiné au Mali. La défaite de l’Etat malien et la progression du Jnim constituent un signal d’alarme pour tout le Sahel. Pour le Sénégal, la sécurité n’est plus seulement une question intérieure : elle est désormais un enjeu régional vital. Prévenir la contagion terroriste aujourd’hui, c’est protéger la stabilité du pays demain.
Khalifa Ababacar FALL
Juriste spécialisé en relations internationales
Khalifa2013@gmail.com

A LIRE AUSSI...