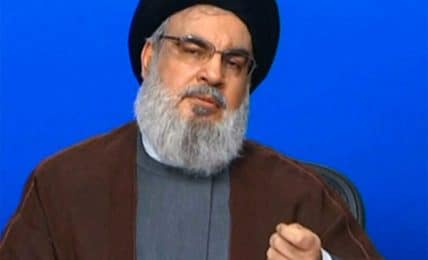Tout l’Occident a aujourd’hui les yeux rivés sur la chancelière allemande Angela Merkel. Sortie vainqueur, mais affaiblie par l’épreuve du scrutin législatif allemand du 25 septembre, saura-t-elle continuer à diriger l’Allemagne, la quatrième puissance économique mondiale, avec le pragmatisme et le calme «olympien» qui la caractérisent ? Nourrie d’anecdotes et de commentaires des proches de la «dame de fer» allemande, la biographie que lui consacre Marion Van Renterghem, journaliste chez Vanity Fair, aide à comprendre l’énigme Merkel et les véritables ressorts de sa «force tranquille».
Désignée régulièrement par le magazine américain Forbes comme la «femme la plus puissante du monde», la chancelière allemande Angela Merkel n’est pas une inconnue de ce côté du Rhin. Depuis sa première élection en 2005, les journalistes français ont beaucoup écrit sur elle, sur son parcours de scientifique dans l’ancienne Allemagne de l’Est, puis de femme politique dans l’Allemagne réunifiée et sa manière discrète et efficace de s’imposer à la tête du pays et de son parti, le Cdu. Or, si les Français connaissaient la légende de celle que leurs voisins outre-Rhin appellent affectueusement «Mutti» (Maman), comprend-on vraiment le comment et le pourquoi de sa longévité politique ou les ressorts réels de sa «force tranquille» qui la distingue de ses prédécesseurs comme de la plupart des autres chefs d’Etat du monde ? D’où l’intérêt de la biographie-portrait de plus de 250 pages que vient de lui consacrer Marion Von Renterghem, l’ancienne journaliste au quotidien français Le Monde et grand reporter depuis un an au magazine Vanity Fair. Admiratrice de l’Allemagne renaissante, de «sa reconstruction politique exemplaire», «sa transparence démocratique, la solidité de ses institutions, son sens civique», la journaliste suit de près la carrière de la chancelière depuis son arrivée au pouvoir et donne des repères utiles pour comprendre sa démarche et ses actions. Elle lui avait déjà consacré une série d’articles dans les colonnes du Monde. L’ouvrage passionnant qu’elle nous propose aujourd’hui est le produit d’une enquête au long souffle qui a conduit l’auteur sur les lieux de l’enfance et de l’adolescence de son sujet en ancienne République démocratique allemande (Rda), mais aussi auprès de nombreux témoins de sa vie d’avant, du mauvais côté du Mur, et son émergence en politique dans l’Allemagne réunie.
«Le dernier défenseur des valeurs humanistes»
Angela Merkel : L’ovni politique raconte les aléas et les secrets d’une vie ordinaire transformée en destin par la force de la détermination, et au contact de l’histoire singulière de l’Allemagne contemporaine. La réunification des deux Allemagne, que séparait beaucoup plus qu’un mur, fut une chance pour cette fille de pasteur, devenue la dirigeante d’une des premières puissances mondiales.
Née à l’Ouest en 1954, mais formée à l’Est dont elle est à la fois le produit et l’adversaire farouche, elle n’était pas attendue dans le club plutôt machiste et conservateur de leaders politiques ouest-allemands qui ont pris en main le destin de l’Allemagne unifiée. Femme dans un milieu d’hommes, «ossie» (Allemande de l’Est), protestante dans un milieu de catholiques, elle a multiplié les obstacles. Mais l’ambition et l’histoire aidant, elle est devenue l’emblème de l’Allemagne réunie, puissante et prospère.
La biographie de Marion Van Renterghem s’ouvre sur une entrevue de cinq minutes que la journaliste réussit à arracher à son héroïne, littéralement entre deux portes, à la chancellerie à Berlin, quelques semaines avant la publication de son livre. La chancelière la remercie pour le long reportage qu’elle lui a consacré dans Le Monde, pas tellement pour avoir parlé d’elle, mais pour s’être déplacée afin d’interviewer les modestes pêcheurs de l’île de Rügen qui fait partie de sa circonscription du Mecklembourg-Poméranie-occidentale.
La rencontre fut brève, mais émouvante, car elle confirme pour l’auteur l’idée qu’elle se faisait de la dirigeante allemande : «Angela Merkel me fascine, écrit la journaliste, parce qu’elle est la seule parmi les grands dirigeants mondiaux à construire sa politique sur des valeurs plutôt que sur une stratégie.» Son intuition est confortée par le New York Times qui écrivait, après l’annonce en novembre 2016 de la candidature de Angela Merkel pour un quatrième mandat à la tête de son pays, qu’elle pourrait bien être «le dernier défenseur des valeurs humanistes de l’Occident». Pour Marion Van Renterghem, comme pour les biographes allemands attitrés de la chancelière, l’approche morale de la politique de celle-ci lui vient de son éducation est-allemande, des trente-cinq premières années de sa vie passée en RDA, de l’autre côté du rideau de fer. L’ouvrage s’attarde sur ces longues années vécues sous le totalitarisme «socialiste», humanisées par l’influence des valeurs protestantes transmises par le père pasteur qui accueillait des enfants handicapés dans sa maison.
Afin de comprendre comment ces années ont structuré la personnalité de la future chancelière, la journaliste est allée à la rencontre des hommes et femmes qui l’ont connue pendant cette période formatrice, notamment son ancien professeur de mathématiques qui a gardé d’elle le souvenir de «l’élève la plus douée en maths qu’(il ait) jamais eu de (sa) vie» et des pasteurs proches de la famille Karsner, le nom de jeune fille de la chancelière.
L’un des plus beaux passages de la biographie est sans doute celui où l’auteur rapporte les retrouvailles récentes de la chancelière avec le pasteur Rainer Eppelmann qui fut élève au séminaire en Allemagne de l’Est du père de Angela Merkel. On est en janvier 2016 lorsque la «dame de fer» allemande subissait encore dans l’opinion publique le retour de bâton de sa décision d’ouvrir les portes du pays aux réfugiés.
Le passage se clôt sur la magnifique phrase de Vaclav Havel que le pasteur Eppelmann cite de mémoire dans l’espoir de réconforter son amie : «L’espoir, ce n’est pas la conviction qu’une chose se termine bien, mais c’est la certitude que cette chose fait sens, quelle que soit la manière dont elle se termine.» Une phrase qui ne pouvait que toucher la chancelière, compte tenu de son éducation religieuse, fondée sur l’interprétation de textes sacrés, commente sa biographe.
Les deux Merkel
Or, malgré l’admiration que la journaliste éprouve à l’égard de sa protagoniste, son portrait d’elle est un modèle d’objectivité, brossant sans complaisance les forces et faiblesses de cette dernière, ses réalisations et ses échecs à la tête de l’Allemagne depuis 12 ans. La biographe revient ainsi avec la même minutie sur la trahison par son sujet de son mentor (Helmut Kohl) que sur l’ouverture des portes de son pays en 2015 aux centaines de milliers de migrants fuyant la guerre et les atrocités en Syrie.
Les revirements et la dureté de la dirigeante sont mis en avant dans les pages qui évoquent la gestion dogmatique de la crise grecque, suivie de la décision inattendue de mettre fin en 2011 à la production de l’énergie nucléaire au lendemain de la catastrophe de Fukushima, alors qu’elle avait fait l’apologie du nucléaire tout au long de sa carrière politique. L’une des caricatures grecques censurées par le Parlement européen. Pour l’eurodéputé Stelios Kouloglo, à l’origine de cette exposition, c’était «tout ou rien». L’exposition a été annulée. Dessin de Dranis/Photo par Laxmi Lota.
Il y a en réalité deux Merkel : la «maman» et la tueuse. D’un côté, comme l’écrit la journaliste, «elle est ce capitaine tranquille, moral, efficace, rassurant» qui inspire la confiance à ses concitoyens malgré ses erreurs et l’usure du pouvoir. De l’autre, «c’est une politicienne redoutable» qui a accédé «à la tête de la Cdu en tuant son mentor Helmut Kohl», faisant preuve d’un «génie machiavélique»… Au point que la famille de Kohl ne voulait pas qu’elle prenne la parole aux obsèques de ce dernier en juin dernier.
«La rue allemande n’est pas non plus sans savoir, explique pour sa part Stéphanie Waetjen, journaliste à Berlin et fine observatrice de la scène politique, que derrière son air de ne pas y toucher, la chancelière Merkel peut être très calculatrice et qu’elle a réussi à écarter tous ses adversaires les uns après les autres». «Ce qui lui vaut d’être parfois comparée, poursuit la journaliste berlinoise, à une araignée malfaisante qui attend son heure pour sauter sur sa proie.» Or, de laquelle des deux Merkel la postérité se souviendra-t-elle ? De Merkel l’araignée ? Ou de Mutti ? Publié une poignée de jours avant la tenue du scrutin législatif allemand du 25 septembre 2017 qui a ouvert la voie au quatrième mandat de la chancelière, sa biographe ne pouvait pas ne pas poser la question. Ce qu’elle fait dans les pages de clôture de son opus, rappelant que les immédiats prédécesseurs de Angela Merkel à la chancellerie ont chacun marqué son temps à sa manière. Helmut Kohl a réuni les deux Allemagne, Gerhard Schröder a réformé l’économie. Quant à la chancelière, rien n’illustre mieux sa singularité, suggère Marion Van Renterghem, que son «ouverture aux réfugiés syriens». Ce geste, guidé par «des valeurs fondamentales», écrit-elle, la distingue des autres dirigeants européens qui, au plus fort de la crise, avaient préféré fermer les yeux au drame des migrants. C’est sans doute ce geste qui fait de la chancelière le «totem» moral de l’Allemagne et d’un Occident en perte de vitesse et… de valeurs.
Rfi