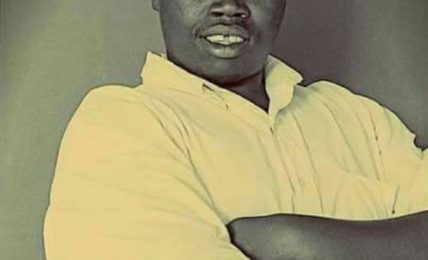L’impact négatif de la traite esclavagiste internationale sur l’Afrique est immense et indéniable. Si l’on se fie à l’historien Ibrahima Thioub, ses impacts sont visibles à plusieurs niveaux : personnel, familial, communal et continental. Amulettes, fêtes et attachement à l’obésité découlent tous de la traite esclavagiste, selon le professeur Thioub. Il a inauguré jeudi dernier au Musée des civilisations noires un cycle de conférences intitulé : «La caravane et la caravelle.»
Outre les millions d’Africains capturés et transportés et le nombre de morts, la destruction économique et environnementale résultant des guerres et des raids d’esclaves ont été aussi immenses. On estime d’ailleurs que la population de l’Afrique est restée stagnante jusqu’à la fin du XIXe siècle. Et à côté du bilan démographique, la traite des esclavages et la résistance des africains à celle-ci ont également entrainé de profonds changements sociaux et politiques. «Les relations sociales ont été restructurées et les valeurs traditionnelles subverties. Finalement, la traite a laissé le continent sous développé, désorganisé et vulnérable à la prochaine phase de l’hégémonie européen, le colonialisme.» Mais bien au-delà, la traite esclavagiste aura eu un impact beaucoup plus poussé sur la manière de penser, de faire, de dire des sociétés africaines. Et ces impacts sont toujours visibles d’après l’historien Ibrahima Thioub.
Invité à réfléchir sur les impacts des traites esclavagistes sur les sociétés africaines, le recteur de l’Université Cheikh Anta Diop (Ucad) a expliqué l’origine de certaines pratiques et croyances très ancrées dans les sociétés africaines, notamment sénégalaises. «Quand vous prenez les sociétés haalpoular par exemple, il y a des tâches exclusivement réservées aux serviles», explique-t-il. En effet, dans cette société et dans bien d’autres, le fait de travailler même équivaut à la servitude. Et étant donné, explique le conférencier, que le meilleur moyen de montrer qu’on appartient à la notabilité, que l’on ne travaille pas et que les tâches sont réalisées par une population servile, c’est de ne pas bouger, d’être obèse. «Dans ces sociétés pour être un notable, il faut être obèse. C’est signe d’aisance. Si vous ne prenez pas du poids, on vous le reproche parce qu’on se dit que vous appartenez à la population servile. Plus vous prenez du poids, plus on est content et on se dit qu’il y a des esclaves à votre service», souligne M. Thioub rajoutant qu’il y a des sociétés même où on vous gave pour vous faire prendre du poids. «C’est justement dans ces sociétés où on a le plus de mal à abolir l’esclavage. Parce que le travail y est synonyme de servitude. Et ça crée même des maladies, le fait que toute femme mariée doit prendre tout de suite du poids. Si elle ne prend pas du poids, elle est indexée. Parce que dans la mentalité, ce qui est resté dans la culture profonde, ce rapport au corps, c’est que prendre du poids c’est appartenir à la notabilité. Et cela signifie avoir des esclaves, des gens à son service.»
Croyances et mentalités
Et il n’y a pas que cela comme impacts des traites esclavagistes sur les sociétés africaines. Sur le plan des croyances et des mentalités, l’attachement à tout ce qui est festif ou bien son expansion, s’explique aussi à travers la traite d’après Ibrahima Thioub. «Avec le développement de la traite et la différenciation sociale, il y a eu un contrôle qui s’est exercé sur la fête», note-t-il. Cependant, cela ne signifie pas qu’il n’y avait pas de fêtes. Bien au contraire, les fêtes existaient avant. Mais avec la traite, elles ont connu une transformation radicale dans leur exercice, soutient-il. Dans le royaume du Dahomey, par exemple, il y avait la fête des coutumes, dans la baie du Biafra, la fête de l’homme riche. Mais après la traite, la fête est devenue une manifestation de l’appartenance à la classe dirigeante qui laisse apparaître la culture de prédation, de destruction. Ainsi les étapes les plus marquantes de la fête étaient l’exposition vestimentaire, une première scène haute en couleurs. «L’épouse de l’homme riche parade en changeant de costumes à chaque tour du village. Une semaine de toilette blanche : vêtements blancs et bijoux en argent, puis une semaine de toilette rouge : vêtement de couleurs et bijoux en or (…) Le héros de la fête lui change de vêtements et de parures 6 fois par jour dans l’enceinte de sa maison», raconte-t-il en soulignant que beaucoup de Sénégalais se reconnaitront certainement dans cette description. «Vous comprenez maintenant pourquoi quand vous faites les baptêmes, on change plusieurs fois de vêtements. C’est l’apparition de l’homme riche qui doit montrer sa richesse et l’exposer.»
Des amulettes pour se protéger
Autre stigmate des traites esclavagistes, les amulettes. Avec la traite, l’historien révèle qu’on observe l’usage astronomique des talismans et gris-gris. «Cette peur qui s’installe avec la traite amène à investir dans ce monde de l’imaginaire pour se protéger parce qu’on est dans un espace où le danger est permanent.» Et donc, si dans certaines familles africaines, les parents interdisent à leurs enfants de sortir au crépuscule, ou juste après la prière de 14h, c’est parce que sans doute les rapts d’esclaves se produisaient à ces heures, selon le Pr Thioub. «Ne vous étonnez pas de voir le dimanche vos lutteurs bardés de toutes sortes de gris-gris. C’est un très long héritage. On rapporte qu’un des rois de la Sénégambie, quand il allait en guerre, l’ensemble de ses gris-gris constituaient une charge de chameau. Il s’agit de Alboury Ndiaye. Une fois, lors d’une bataille, quand il a porté tous ces gris-gris, il ne pouvait plus passer par la porte de la chambre.»
aly@lequotidien.sn