Au pays des Diallobé (suite)
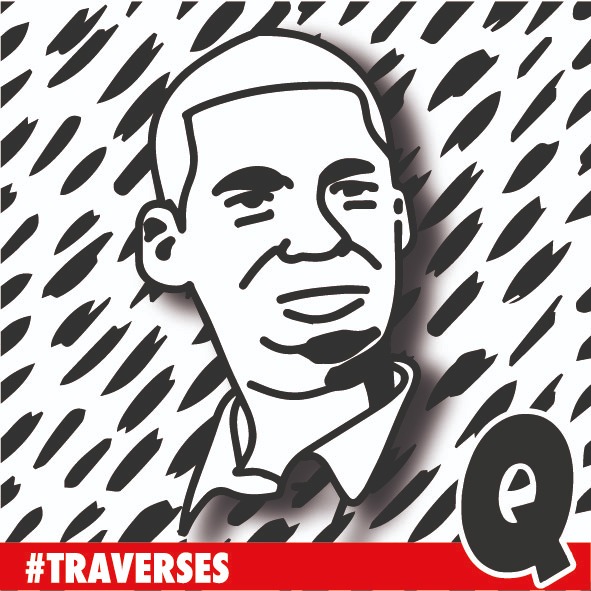
Dans son ultime discours de vœux, François Mitterrand disait : «Je crois aux forces de l’esprit.» Je pense à cette formule ici, sur cette bande de terre bordant le maayo précieux, ce maayo que nous rappellent tous les fleuves de toutes les parties du monde.
N’est-ce pas un hasard plein de sens ? Ici, la cité des ombres, peuplée de nos morts, est un territoire indistinct du Pays des Diallobé. Elle en est même l’arrière-garde, la terre de repli dans les moments de doute ou de divergences entre membres du clan pour y trouver matière à agir, à relier les fils distendus, et à poursuivre l’œuvre d’humanité.
Lire la chronique : Les masses de granit de Senghor
Par la transmission, des générations de Yirlaabé se succèdent et écrivent les lignes d’intelligence, de retenue, de décence et de construction de la Nation pour que jamais les trois couleurs et l’étoile ne perdent de leur éclat, pour que toujours ce pays demeure le phare de l’Afrique et un symbole privilégié de l’aventure humaine pour la paix, la tolérance et le vivre-ensemble. Faire l’histoire. Agir en toutes circonstances pour que la renaissance du Sénégal et de l’Afrique soit la boussole. Ne jamais verser dans la vulgarité et la compromission qui charrient le déshonneur.
Cet héritage est tatoué dans le cœur de chaque enfant de cette partie du territoire. Le Fouta, grenier de céréales et de valeurs pour la consommation nationale, marque au fer rouge sur la peau de chaque nouveau-né ses valeurs qu’on ne saurait perdre en cours de chemin dans la vie. Le pulagu et le ndimagu constituent cet inestimable patrimoine, objet d’anathèmes et de petits reproches sans intérêts, qui fait que ce pays tient encore debout. Car ce qui est appelé à demeurer ne saurait céder aux agressions intempestives du temps et des hommes.
Lire la chronique : De la hauteur dans le débat public
Par le pulagu et le ndimagu, je parle de valeurs, de ces choses invisibles, intouchables, insondables, qui échappent à la sagacité et à la motivation du plus vaillant chercheur. Ce qui est sacré ne saurait être d’une vulgaire matérialité sans substance ni spiritualité. Il faut savoir écouter les conversations de la cité des ombres et être apte à déchiffrer les messages écrits dans la langue du cœur pour espérer être initié aux codes du pays du fleuve.
A Saldé, la petite école reste dressée malgré les menaces du temps, pour perpétuer l’héritage d’enracinement et d’ouverture du terroir. Sur son fronton, le nom de son illustre parrain. Ici, pour forger l’homme, il lui faut être initié aux deux savoirs : auprès de l’instituteur, qui ouvre au verbe arrivé du lointain pays des étrangers dans les valises de la colonisation et auprès du thierno, gardien des secrets du Livre. Il apprend à mémoriser la parole divine, celle dont on nous dit au Fouta, qu’elle seule pourra sauver les âmes là-bas au pays sans fin, quand nous devrons rendre compte à notre Seigneur de notre passage sur terre. Je pense au rapport mystique entre Samba Diallo et Thierno, le maître. C’est pourquoi Maam Oumar Hawa a plusieurs fois insisté pour que son petit-fils arrête l’école française pour se consacrer à la mémorisation de la parole divine afin, disait-il, de perpétuer la longue saga des érudits Yirlaabé, préposés à la direction de la prière et à la conduite des âmes vers la félicité. N’est-ce pas qu’il se raconte encore le soir, l’histoire de l’école de Baba Racky Anne fréquentée par des apprenants spéciaux, des créatures du pays de l’invisible. Les traces physiques de cette école ne se trouvent nulle part, mais ses restes immatériels s’entendent aux aurores quand la voix déclame les versets du Livre.
Au pays des Diallobé (Première partie)
Je suis devant ce fleuve dont la douce musique est composée par les esprits des miens partis rejoindre nos saints. Ce fleuve me fait à nouveau penser aux mots du poète des Rhapsodies fluviales : «En moi le jaillissement sonore des grandes eaux du fleuve. J’eus subitement la nostalgie de mes origines. Silence et émotion. J’ai pensé aux miens, j’ai pensé à Donaye et à Podor.»
Je pense à Saidou Oumar Baba qui a étudié à Saldé au sein du clan, puis à Podor, les savoirs modernes. Il nous livrait les soirs, la voix étreinte par la mélancolie inavouée, les récits du fleuve, là-bas au pays de la magie de l’enfance. Nous entendions parler des «fedde», quand la franche camaraderie du monde d’hier avait encore un sens, quand les hommes n’étaient pas encore les prisonniers consentants des machines à écran qui encombrent leurs poches et les éloignent de l’attention et du souci de la tendresse qu’ils doivent aux leurs.
L’héritage des ancêtres demeure puissant et fait le lien entre les générations par le biais de la transmission. Dieu, la langue et le substrat culturel constituent une sainte trinité pour ce clan dont le destin est lié au Sénégal dans son ensemble.
Traverses : L’école, pour une montée en humanité
C’est pour cette raison parmi d’autres, que la République nous est essentielle, de même que la Patrie et l’Etat, surtout que pour ce dernier nous l’avons bâti. La foi en Dieu diluée en celle de la République ne nous laisse guère le choix. Continuer l’œuvre de service à l’intérêt général, c’est se dresser debout en rempart contre les fossoyeurs dangereux et bruyants de la République. Ce combat ne relève pour nous ni du chic ni du choix. Il est un devoir auquel nous ne pouvons pas nous soustraire. Nos aînés ont bâti la République du Sénégal, il nous revient de continuer à la préserver, à la moderniser et à la renforcer contre les assaillants qui qu’ils soient, et quelles que soient leurs motivations et leur puissance.
La fureur vaine et les procès d’intention foisonnent. Mais il est des esprits qui ne peuvent faiblir devant l’adversité, fut-elle la plus farouche. L’obséquiosité également nous est impossible. Parce que nous savons ce dont nous sommes les légataires et les porteurs aujourd’hui ; nous ne nous inclinons ni devant les privilèges matériels ni devant les menaces, mais seulement devant ce qu’au Fouta nous appelons le tedungal : cet honneur sincère qui nous est fait et que nous savons rendre au centuple. (A suivre…)
Par Hamidou ANNE – hamidou.anne@lequotidien.sn

