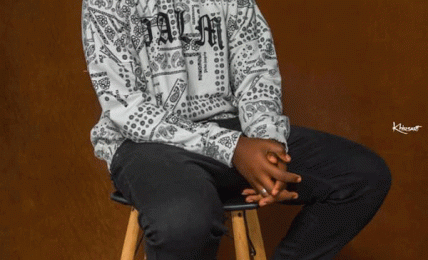Cinéma – «Une si longue lettre» à l’écran : Angèle Diabang sur les pas de Mariama Bâ


Il y a des lettres qu’on n’oublie jamais. Des lettres qui traversent les générations, les consciences, les blessures muettes des femmes, les silences des sociétés. «Une si longue lettre» de Mariama Bâ est de celles-là. Et désormais, cette lettre a une voix, une image, un hommage vivant. Elle a un film. A lire, à voir, à transmettre.
Par Ousmane SOW – Près de 45 ans après sa parution, Une si longue lettre, le chef-d’œuvre de Mariama Bâ, trouve enfin le chemin du grand écran. Adapté par la réalisatrice sénégalaise Angèle Diabang, le film éponyme a été projeté en avant-première presse, ce 2 juillet au Cinéma Pathé Dakar, en présence de l’équipe du film. L’accueil du public ? Déjà bouleversant. Les larmes coulaient dans la salle. Le silence parlait pour tous. Roman culte, lu par des générations d’écoliers, Une si longue lettre avait déjà connu le théâtre. Le voilà désormais transposé au cinéma. Premier long métrage de fiction de Angèle Diabang, le film Une si longue lettre est porté par la performance saisissante de Amélie Mbaye dans le rôle de Ramatoulaye, enseignante et épouse depuis 25 ans, dont la vie bascule lorsque son mari prend pour seconde épouse, Binetou, la meilleure amie de leur fille aînée. Le film retrace son combat pour protéger ses enfants, préserver leur héritage et reconstruire sa vie malgré la douleur et la solitude. «Je rêvais simplement de jouer ce rôle de Ramatoulaye Fall. C’était un honneur, un challenge. Un vrai privilège. Et incarner ce rôle de Ramatoulaye, une femme digne, qui souffre mais qui intériorise, ce n’est pas évident. Mais je précise que ce n’est pas un film sur la polygamie uniquement. C’est un film sur l’amour, l’amitié, le pardon, la famille», confie l’actrice à la fin de la projection. D’une durée d’1h 40, le film réunit à l’écran la comédienne Amélie Mbaye et le Gabonais Serge Abessolo, accompagnés de figures du théâtre populaire sénégalais comme Ndèye Coumba Coulibaly et Cheikh Seck. Le casting met également en lumière une nouvelle génération de talents, donnant ainsi une dimension intergénérationnelle à cette adaptation aussi longue que la lettre de Ramatoulaye.
Douze années ont été nécessaires à Angèle Diabang pour porter ce film. Douze années de travail, d’attente, d’obstacles. «Je dirais que ce sont les aléas de la vie. Faire un film en Afrique, ce n’est jamais facile. Surtout quand on veut parler de nos réalités avec respect, sans dénigrer», a expliqué Angèle Diabang. Et ce n’est pas tout. Elle confie : «Financer ce film était très difficile, parce que si tu ne fais pas attention, on te tire vers quelque chose qui est très négatif. Il m’est arrivé de refuser de très grosses sommes pour ce film parce que je refusais qu’on m’impose un regard négatif sur le Sénégal. Je refuse de dénigrer mon Sénégal. Je veux toujours mettre en valeur ma culture.» Et aujourd’hui, le film poursuit son parcours international.
Une œuvre hommage
Présenté au Fespaco dans la catégorie «Perspectives», sélectionné à New York, au Locarno Film Festival, au Dakhla Film Festival, à la Semaine du centenaire Vieyra à Tours, il est aussi en lice pour six distinctions aux Nisa, prévues le 19 juillet à Abidjan. Une moisson méritée. «C’est un honneur, un plaisir et beaucoup d’émotion de présenter ce film aux Sénégalais. On l’a déjà montré à New York, au Fespaco, au Maroc. Donc, le présenter au Sénégal, c’était une urgence», s’est-t-elle réjouie. A l’écran, Angèle Diabang a situé son film dans les années 2000. Pas par nostalgie, mais par nécessité. «Si je l’avais situé en 2025, on aurait parlé de bagarres, de femmes hystériques. J’ai préféré garder le côté digne», assure la réalisatrice et productrice, qui a inséré dans le film, des clins d’œil, des signes, des hommages. A Mariama Bâ, évidemment, mais aussi à Aline Sitoé Diatta, Annette Mbaye d’Erneville, Safi Faye, Djibril Diop Mambéty, Sembène Ousmane. «Ce sont des placements d’hommages. Mariama Bâ est une femme forte, courageuse, une pionnière avec Annette Mbaye d’Erneville, qui l’a beaucoup soutenue quand elle écrivait son livre. Donc, au lieu de faire du placement de produits, j’ai fait du placement d’hommages et de personnes qui sont importantes. Je veux que les élèves apprennent à travers ce film non seulement le roman, mais aussi l’histoire du cinéma et des grandes femmes du Sénégal», a expliqué Angèle Diabang.
A la marge, dans un souffle, la réalisatrice glisse un regret : son court métrage, Un air de Kora, n’a toujours pas été projeté au Sénégal. «J’aimerais le montrer. J’avais hésité à le coupler avec Une si longue lettre, car ce serait trop long. Mais je me dis que ceux qui ont empêché qu’on montre Un air de Kora ne pourront pas venir interdire Une si longue lettre. Et j’espère que grâce à l’engouement autour de ce film, on pourra enfin organiser une projection d’Un air de Kora», a-t-elle estimé.
ousmane.sow@lequotidien.sn