Cohabitation pêche-hydrocarbures : Faire aussi bien que la Norvège
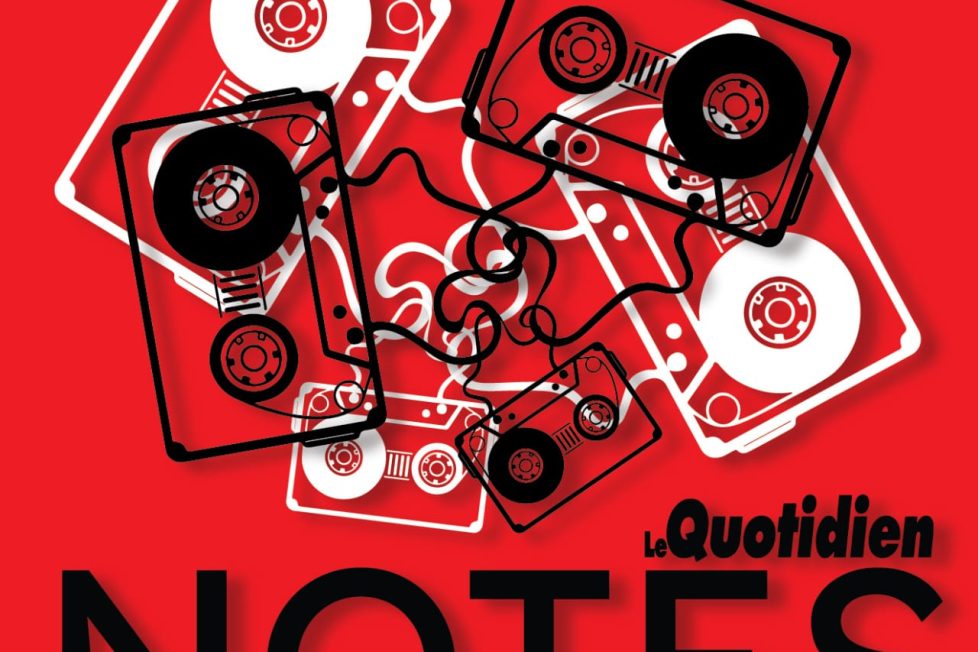
Parmi les explications simplistes de l’actuelle vague de migration clandestine vers l’Europe et les Etats-Unis à travers les pirogues ou en passant par l’Amérique latine, on entend les gens mettre en cause la gestion de la ressource halieutique dans nos mers et nos côtes. Beaucoup de gens indiquent que ce sont des jeunes pêcheurs, désenchantés par le «pillage de nos ressources maritimes par les étrangers, principalement les Européens», qui se retrouvent à prendre la mer, non pas à la recherche de poissons, mais plutôt dans l’espoir d’atteindre un hypothétique eldorado à travers les océans.
Lire la chronique : Développer l’industrie, développer le Sénégal
Ces personnes en profitent pour mettre en cause la gouvernance de l’Etat dans ce secteur, comme dans bien d’autres aussi. Cette assertion pourrait même être renforcée par l’échouage à Guédiawaye, d’une pirogue partie de Bargny, avec à son bord environ 300 personnes. Le hic, c’est que la majorité des personnes embarquées dans cette pirogue, comme dans celles qui avaient pris la mer avant elle, ne sont pas des pêcheurs. Mieux, beaucoup n’ont jamais songé à gagner leur vie en exploitant la mer. Plus, pour une bonne majorité des départs à partir du Sénégal, on enregistre des personnes ressortissantes des localités très éloignées du littoral. C’est dire que tout n’est pas rattaché à la pêche.
Toutefois, cette question de l’exploitation des ressources halieutiques n’en est pas moins préoccupante pour autant. On a tendance à oublier qu’en plus d’être un secteur vital pour de nombreuses communautés côtières -pas seulement les Lébous de la région du Cap vert-, la pêche est aussi vecteur d’un mode de vie et d’une culture qu’il s’agit de préserver.
Le poids économique n’est pas négligeable. Même si les chiffres ne font pas toujours l’unanimité, l’Agence nationale de la statistique et de la démographie a recensé en 2018, 22 356 pirogues dont un peu plus de 15 mille sont immatriculées. Des organisations de pêcheurs parlent elles de près de 50 mille pirogues recensées dans le secteur de la pêche artisanale. A côté d’elles, on trouve plus d’une centaine de bateaux étrangers, notamment européens et chinois.
Lire la chronique : Le patriotisme économique est une aberration
Dans la même année 2018, l’Ansd fait état d’une diminution des débarquements des captures, par la pêche artisanale, qui passe de 396 053 tonnes en 2017 à 360 632 tonnes. La même tendance a été notée pour la pêche industrielle. Le poisson au Sénégal est la principale source de protéines animales. Il est aussi la principale activité économique de près de 600 mille personnes et leurs familles, qui en vivent directement et indirectement. Depuis des années, les acteurs du secteur se plaignent de ce que leur activité se meurt, surtout parce que les pouvoirs publics ne semblent pas prendre au sérieux les signaux d’alarme qui leur sont agités.
Les acteurs de la pêche artisanale, ainsi que certains armateurs nationaux, remettent en privé les chiffres de l’Ansd, les trouvant «trop optimistes», sans pour autant avancer des sources pour leurs chiffres à eux. L’argument sérieux qu’ils avancent est que depuis des années qu’on le lui demande, l’Etat ne veut pas faire un recensement exhaustif de la flotte des navires qui pêchent dans les eaux sénégalaises. Ce qui fait que les pêcheurs artisanaux non plus ne sont pas incités à se faire immatriculer.
En plus des dangers de la surpêche, qui ont tendance à créer des conflits avec des pays voisins, dans lesquels les pêcheurs sénégalais se retrouvent souvent à pêcher sans licence, il y a à l’horizon très proche, la menace de l’exploitation des hydrocarbures. Si les pouvoirs publics assurent que les études d’impact environnemental réalisées par les compagnies pétrolières garantissent que l’exploitation du pétrole et du gaz offshore ne va pas modifier l’environnement de manière sensible, les pêcheurs déclarent que tant que ces hydrocarbures ne sont pas encore sortis de la mer, personne ne peut garantir qu’ils ne vont pas modifier l’habitat des poissons et les contraindre à migrer.
Lire la chronique : Le poids des exonérations fiscales
L’un d’eux explique que la preuve du manque de transparence dans ce domaine est la mise à l’écart des autorités de la pêche dans les décisions concernant l’exploitation des hydrocarbures. L’un d’eux s’interroge : «Avec plus de 30 000 embarcations artisanales et 118 navires de la flotte nationale industrielle, sans tenir compte des bateaux pirates non recensés dans nos côtes, les acteurs de la pêche, le ministère et les secteurs annexes ne sont pas impliqués au plus haut niveau du processus d’exploration et d’exploitation du pétrole et du gaz offshore au Sénégal. Comment dans ces conditions faire confiance aux résultats déclarés des études d’impact ?»
Or, des exemples existent dans le monde, de cohabitation harmonieuse entre le secteur de la pêche et l’industrie pétrolière. La Norvège est l’un des plus importants pays pétroliers d’Europe et du monde. Elle a pu développer son industrie pétrolière sans affecter le moins du monde la pêche au hareng, qui est toujours l’une des plus importantes activités économiques du pays. Cette activité se développe tellement bien que le pays peut se permettre de ne presque pas toucher aux revenus du pétrole, épargnés pour les générations futures. Peu de Norvégiens ont vu leurs conditions de vie changer avec l’arrivée de l’économie pétrolière. Le pays est encore connu pour la préservation de son environnement et une bonne gestion de son secteur de la pêche. Le Sénégal a le défi de ne pas faire moins que les Norvégiens.
Par Mohamed GUEYE – mgueye@lequotidien.sn

