Commémoration du 80ème anniversaire du massacre de Thiaroye 44 en 2024, l’heure de la souveraineté narrative a sonné
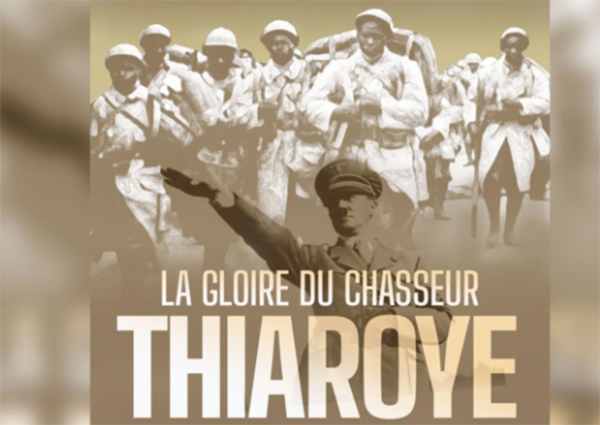
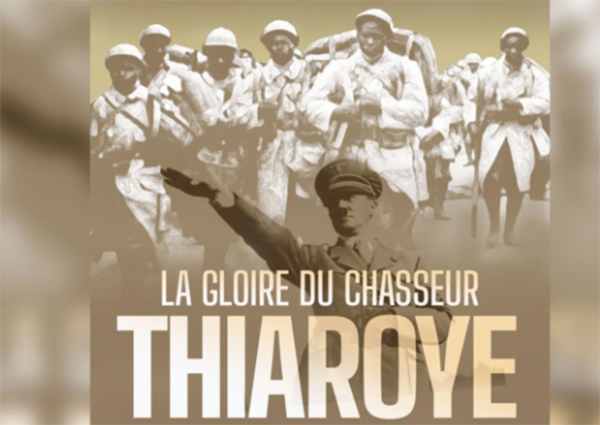
L’information n’existe pas, il n’y a que des mots d’ordre ! Idée deleuzienne. Giles Deleuze applique à l’histoire des Etats, l’idée d’information entre dans le périmètre du narratif. Les uns en construisant un qui n’hésite pas à cacher la vérité. Les autres se devant la vérité et qui ne doivent pas hésiter à aller l’exhumer là où le mensonge l’a inhumée.
Par Moussa Seck – Vingt-neuf. Novembre parcourt ses derniers kilomètres, et sur sa tombe s’élèvera le premier jour de décembre. Deux-mille vingt-cinq qui arrive. Entre 44 et ce nouvel an qu’on espère, le temps aura couru quatre-vingts ans. Décembre, bientôt, et la fraîcheur mordra dans mille et une peaux, dans mille et une faces. Mille et une flammes demeurent cependant mordantes, dans millions de cœurs, dans millions de mémoires, l’évènement de 44 présentant toujours des zones d’ombre. Et parce qu’il y a devoir de Mémoire et de Vérité, Thiaroye se discute au Plateau. Primature. Professeur Mamadou Diouf. Ses collègues. La séquence historique. Et que nul esprit ne se la rejoue en noir et blanc, synonymes de narratif à la française. En couleurs : colorier l’évènement avec une palette d’aujourd’hui. Sénégalais, ce narratif. Parce qu’en réalité, «dès 44, il était établi qu’il s’agissait d’un massacre. Ce qui s’est passé, c’est qu’on a essayé de mettre une chape de plomb autour de ces évènements. Il y a eu un black-out. Le 1er décembre 1944, aucune radio n’a parlé de l’évènement, aucun journal local n’a parlé de l’évènement». Dans le rapport de Louis Mérat, il sera même dit ceci : «Il nous faut construire l’oubli, sur cet évènement.» Ainsi les choses se sont faites, plus d’un demi-siècle. Mais, le Sénégal a envoyé ses fils en France, et qui vont faire parler des preuves de l’époque. Ce, afin que le narratif d’oubli de l’ancien empire colonial, sur ce qu’il a toujours refusé de nommer massacre, soit dépassé. Parmi ses fils, le professeur Mamadou Fall, coordonnateur du Projet Histoire générale du Sénégal, qui a dit les lignes ci-dessus. Et il y avait la professeure Rokhaya Fall. «Les objectifs incluaient la recherche de documents inédits, de documents indispensables à la manifestation de la vérité sur le massacre de Thiaroye et de répondre aux questions qui demeurent, qui jettent un flou, des zones d’ombre concernant cet épisode», dira-t-elle. C’était une mission éclair (du 18 au 28 novembre 2024), mais elle n’a pas été sans résultats. On entendra Pr R. Fall annoncer qu’il a été obtenu «des actes de décès de tirailleurs». «En explorant, poursuit-elle, les registres de décès de Dakar de 45, nous avons relevé beaucoup d’actes de décès de tirailleurs, et je pense qu’un regard approfondi et des verifications sont à faire sur ces actes.»
Des visages sur les ombres
La cheffe de mission des experts allés exhumer, au nom de la vérité, ce qui a été inhumé par le mensonge, fait cette annonce dans une salle de conférence de la Primature sénégalaise décorée d’une image de tirailleurs… sans visages. Décembre 1944, et aujourd’hui novembre 2024, des anonymes patientent dans les ruines de l’histoire, qui attendent de retrouver leur identité. Et que d’ombres, derrière la table d’où s’exprimaient les fils du pays en charge de rétablir les faits ! Beaucoup d’ombres, bientôt peut-être, auront des visages, à en croire ce que rapporte Pr Fall. «La délégation aussi s’est intéressée aux journaux de l’époque. On a des fonds iconographiques, et les journaux tels que Le Télégram-me, l’Aurore ont rapporté des scènes de vie et la trajectoire de prisonniers africains. Ces témoignages ont permis d’ajouter un vécu dramatique aux milliers de soldats, pour la plupart, qui n’ont pas été identifiés. Certaines sources iconographiques ont permis de mettre un visage à certains prisonniers de guerre.»
«La décision de commémorer est une décision politique»
Mission éclair réussie, et bien sûr, un travail qui doit continuer. En avril, le comité officiellement mis en place par le Premier ministre Ousmane Sonko remettra un livre blanc au gouvernement. Aussi, ces premiers pas vers un narratif nouveau de 44 par la découverte de preuves inédites n’ont été possibles que parce qu’il y a eu une volonté politique à la base. Les honneurs, aux nouvelles autorités étatiques. «La décision de commémorer est une décision politique», dira, dans son introduction, Pr Mamadou Diouf. Et, «choisir la commémoration de Thiaroye, c’est effectivement un acte double. Premier élément, c’est que c’est un acte de souveraineté. Et un acte de souveraineté qui repositionne le Sénégal et dans l’espace ouest-africain et dans l’empire français, son histoire et ses répercussions». A l’intention d’un Etat de garder la chape de plomb, il a été imposé la volonté d’un autre de lever, aussi lourde soit-elle, ladite chape. L’Histoire est chose qui se politise, rappelle Pr Diouf : «Un Etat est toujours un Etat historien. L’Etat tente toujours de contrôler le narratif sur ses performances, sur ses origines, sur tout ce qu’on veut…» Et huit décennies, c’est un assez long temps pour bâtir un solide dispositif narratif. S’y complaire, soulignera le Pr Mamadou Fall, c’est courir inéluctablement le risque de ne rien comprendre à ce qui s’est passé. Ou, de ne comprendre que ce que la narration officielle, ici française, veut faire comprendre. «C’est pourquoi, explique M. Fall, nous avons contourné le dispositif de l’Etat central jacobin pour aller vers les communes. Et c’est à ce niveau que nous avons trouvé les véritables données qui vont nous permettre de produire notre propre narratif des faits.» Nous : le comité, où on retrouve Madame Rokhaya Fall et Messieurs Mamadou Diouf, Mamadou Fall, Saliou Ngom, Makhone Touré, Adama Aly Pam.
Cette histoire qui vient…
Ce Sénégal institutionnel, qui décide de commémorer, ainsi que ses fils du comité, qui ont commencé à fouiller le passé, n’ont pas de pensée que pour eux seuls. «Le choix de l’actuel gouvernement sénégalais de commémorer, c’est justement le choix qui explique aussi la nouvelle dénomination du ministère des Affaires étrangères, qui s’appelle ministère de l’Intégration africaine et des affaires étrangères. Donc, Thiaroye, c’est un affichage de la dimension africaine par rapport à toute autre dimension. La deuxième chose, c’est que le comité va investir sur l’idée que nous allons partager toutes les informations avec tous les pays qui ont eu des ressortissants.» Perspective : «En fin de parcours, peut-être l’année prochaine, certainement, la commémoration ne sera plus une commémoration sénégalaise.» Elle sera une célébration panafricaine. «Et cette célébration africaine annonce une histoire à venir, et cette histoire à venir, c’est l’histoire de la région. C’est pour cela que le comité insiste aussi sur la nécessité de promouvoir un programme qui sera un programme d’histoire régionale, mais aussi un programme d’enseignement qui prendra en considération ce lieu de mémoire et ce récit de mémoire et d’histoire sur lequel nous travaillons.»


