Contre les Jihadistes, les populations entre le marteau et l’enclume
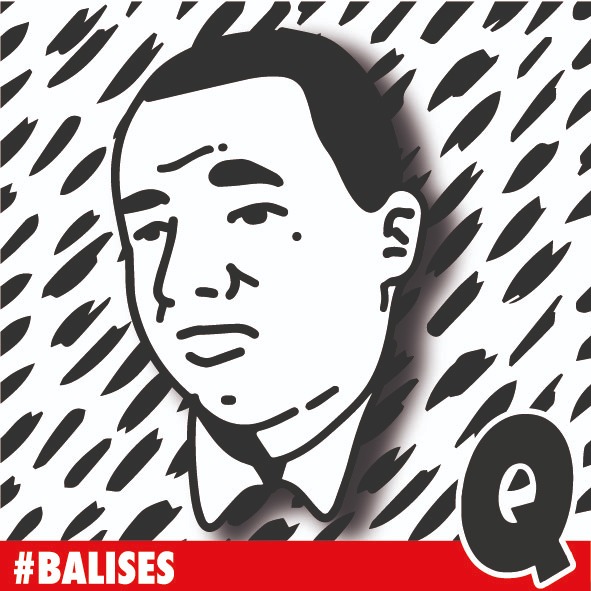
«Pourquoi les hommes donnent ils leur consentement à la puissance ? Dans certains cas par confiance, d’autres par crainte, parfois par espoir, parfois par désespoir. Toujours cependant, ils ont besoin de protection et ils cherchent cette protection auprès de la puissance. Celui qui n’a pas la puissance de protéger quelqu’un, n’a pas non plus le droit d’exiger l’obéissance.» Ainsi parle Julien Freund dans sa préface du livre de Carl Schmitt, La notion de politique. Les populations du Sahel, dont les Etats ont failli ou sont en passe de l’être comme au Burkina, sont confrontées à ce dilemme cornélien. Ces populations sont entre le marteau des armées et l’enclume des jihadistes.
La psychose des populations d’Afghanistan après le retour des talibans et le soulagement des Irakiens et Syriens, libérés de l’emprise de Daesh, montrent que les populations ne donnent leur consentement aux hordes obscurantistes que par «crainte» et «désespoir», quand ces dernières prennent le pouvoir. Ce consentement forcé aux jihadistes intervient toujours après que le consentement placé par confiance en l’Etat soit déçu à cause de l’incapacité de celui-ci à les protéger. Et aujourd’hui, c’est le principal problème de l’Etat au Mali, Burkina et Niger, où les populations sont obligées de jouer sur les deux registres pour avoir la sécurité. Comme le dit Freund, «celui qui n’a pas la puissance de quelqu’un, n’a pas le droit d’exiger l’obéissance». C’est une des conditions les plus importantes du contrat social. Les redoutables armées napoléoniennes, qui avaient réussi à mettre au pas toutes les armées européennes, ont subi une véritable débâcle face à une guérilla de paysans espagnols.
Depuis lors, tous les conflits le confirment : une guérilla en particulier, et des «forces irrégulières» en général, n’ont de chance de réussir qu’avec le soutien de la population. C’est pourquoi les jihadistes manient la carotte et le bâton, pour avoir le soutien de la population. La carotte, quand les jihadistes se substituent à l’Etat qui n’assure plus les services de base, et le bâton, quand ça ne marche pas et que les populations réaffirment leur allégeance à l’Etat ou tentent d’assurer leur propre sécurité.
En se donnant les moyens militaires d’éradiquer le jihadisme sur son territoire ou en les refoulant au Nord Mali, l’Etat algérien a acquis un supplément de légitimité car, en montrant sa capacité à protéger son territoire et ses populations, il est en droit «d’exiger une obéissance». C’est cette «exigence d’obéissance» qui est aujourd’hui le talon d’Achille de beaucoup d’Etats au Sahel. La plus grande urgence au Sahel est de rebâtir des armées capables d’assurer un minimum de protection aux populations qui, pour la plupart du temps, sont obligées de collaborer avec les jihadistes pour avoir la protection que l’Etat n’assure plus.
Le Président Nigérien, Mohamed Bazoum, a raison de comparer les guerres de guérilla, qui ont ravagé l’Amérique latine des années 60-70, à l’assaut des djihadistes dans le Sahel. Il y a cependant une grande différence entre les guérillas latino-américaines et les jihadistes. Les guérillas communistes avaient opté pour une stratégie des dominos (un pays après l’autre), alors que les jihadistes ont lancé l’offensive dans plusieurs pays en même temps, et cherchent à allumer le feu partout au Sahel.
L’Islam est une religion. L’islamisme est une idéologie, comme l’était le communisme. Le projet jihadiste comme le projet communiste, est un projet purement politique, mais c’est connu que la meilleure façon de mettre une cause à l’abri de la contestation est de la sacraliser. C’est pourquoi les jihadistes sacralisent leur projet, qui est purement politique et qui consiste à conquérir le pouvoir. Il ne faut jamais oublier que le renouveau du projet islamiste dans le Maghreb et le Sahel remonte à l’Opa du Fis (Front islamique du salut) sur le pouvoir en Algérie. C’est l’échec de ce projet politique en Algérie, qui les a poussés à délocaliser le projet au Mali, qui était le maillon le plus faible de la zone.
Les chefs jihadistes, qui sont la plupart du temps algériens, ne vont pas de sitôt rapatrier les «dividendes» du projet en Algérie, qui s’est donné les moyens de protéger son territoire et qui n’est pas connu pour être une grande démocratie. Et le jihadisme semble avoir plus «d’affinités électives» avec les démocraties, dont il connaît et exploite les faiblesses. C’est peut-être pourquoi les pays arabes, qui sont le berceau de cette idéologie, sont relativement épargnés.

