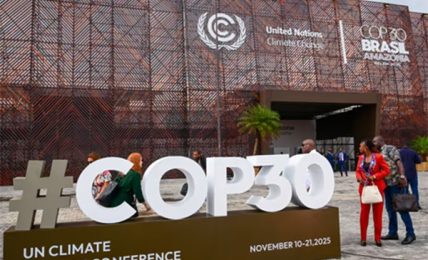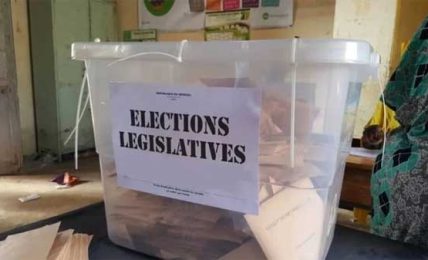Le Ministère de l’éducation nationale (Men) a annoncé la signature d’une convention avec le Haut-Commandement de la Gendarmerie nationale pour la formation des élèves au civisme et à la citoyenneté. «Le protocole d’accord a été signé ce jeudi 11 septembre 2025, en présence du ministre de l’Education nationale Moustapha Mamba Guirassy et de son homologue des Forces armées, le Général Birame Diop, à la Sphère ministérielle Habib Thiam de Diamniadio», rapporte la page officielle du Men.
Cette initiative nous révolte, en tant qu’acteur de l’école, enseignant d’histoire et de géographie en particulier. Si les autorités sénégalaises comptent sur un corps militaire pour former les élèves au civisme et à la citoyenneté, elles ne comprennent rien de l’école, ni la loi d’orientation sur l’éducation nationale, ni les programmes scolaires, notamment d’histoire, de géographie et d’éducation civique.
Le communiqué du ministère affirme que «ce partenariat traduit une vision commune : former des générations conscientes, responsables et résolument engagées au service de la Nation». Cette volonté est déjà très clairement exprimée dans la loi d’orientation, Loi n°91-22 du 16 février 1991, modifiée par la Loi n°2004-37 du 17 décembre 2004. Celle-ci montre que les finalités de l’éducation nationale «consistent à en faire un instrument capable de préparer les conditions d’un développement intégral, assumé par la Nation tout entière, de promouvoir les valeurs dans lesquelles la Nation se reconnaît (…)».
En outre, l’éducation à la citoyenneté et au civisme est bien prise en charge dans nos programmes scolaires, au préscolaire et à l’élémentaire, mais aussi au collège et au lycée, dans plusieurs matières, notamment en histoire-géographie et en éducation civique. Si dans une matière appelée «Education civique», on n’enseigne pas le civisme et la citoyenneté, qu’est-ce qu’on y enseignerait réellement ? L’objet général 2 du programme d’éducation civique du premier cycle (collège) est d’«acquérir un esprit patriotique et de respect des valeurs de civisme, de solidarité et d’ouverture». Dans le programme du second cycle (lycée), les objectifs généraux n°1 et 4 sont respectivement déclinés comme suit : «s’approprier les vertus du civisme», «agir en acteur responsable et en vecteur de développement».
Plusieurs chapitres et leçons de ces programmes insistent sur ces notions. En classe de sixième, le chapitre III est intitulé «Nation, Patrie et Citoyenneté», décliné en 4 leçons : L8-La Nation ; L9-Patrie et Patriotisme ; L10-La notion de citoyenneté ; L11-Droits et devoirs du citoyen. En classe de 5ème, le chapitre I est intitulé Citoyenneté et vie sociale. Au second cycle, le chapitre I en classe de Première porte sur Identité et citoyenneté, en classe de Terminale, il porte sur Etat, citoyenneté et démocratie.
Si l’éducation du civisme et de la citoyenneté est dans nos programmes mais n’apparaît pas dans les comportements des produits de cette école, on devrait se poser les bonnes questions. Les conditions d’enseignement de ces valeurs sont-elles réunies ? Les manquements notés peuvent-ils être compensés par l’intervention d’un corps militaire ? Si le Men s’était posé ces deux questions, il n’allait pas prendre cette décision.
A la dernière question, la réponse est très évidente : ce que les enseignants n’auraient pas réussi à inculquer à leurs élèves, ni les gendarmes, ni aucune autre personne ne pourrait le réussir. La réponse à la première question met en exergue la responsabilité de deux principaux acteurs : la société et l’institution scolaire. Les élèves formés à l’école viennent d’une société, le premier acteur dans le processus d’éducation. Et là, il y a presque une unanimité sur l’échec. Quant à l’échec de l’institution scolaire, il est dû à la législation scolaire qui retire à l’enseignant et à l’administration, le rôle d’éducateur.
Certaines décisions impertinentes expliquent aussi ce problème. Le programme d’éducation civique du second cycle existe depuis bientôt 20 ans (2007 ou 2008), mais il n’est enseigné que par une petite minorité, et souvent sous forme d’exposé. Il ne bénéficie pas d’un crédit horaire dans les emplois du temps et n’est pas évalué au Bac. C’est là qu’on attendait le ministre de l’Education nationale. Au premier cycle, de la 6ème à la 4ème, beaucoup de professeurs ne font pas plus de 4 ou 5 leçons en Ec, durant toute l’année scolaire. Cela est dû à la réduction du crédit horaire en Hg de 4 à 3 heures, par le Men, en 2014. Ainsi, l’heure d’éducation civique est souvent sacrifiée au profit d’Hg, dans le souci d’avoir une progression normale et pouvoir faire les évaluations standardisées au niveau des bassins ou de l’académie.
En outre, en vérité, l’école n’éduque plus, elle instruit. Les autorités ont copié le modèle occidental, en donnant aux élèves des droits et en fragilisant les enseignants et les membres de l’administration scolaire. Il est aujourd’hui plus facile de sanctionner un enseignant qu’un élève. Combien de fois des autorités des Inspections d’académie (Ia) ou des Inspections de l’éducation et de la formation (Ief) ont mis leur véto sur une sanction d’élèves décidée par le Conseil de discipline ?
Quand des élèves d’un collège de Dakar ont cassé les tables bancs de l’établissement à l’occasion d’une jubilation marquant la fin de l’année scolaire, l’inspectrice d’Académie, Khadidiatou Diallo, s’était opposée à leur exclusion. Cette impunité a donné le courage à d’autres élèves, et ces actes sont devenus une tradition dans certaines écoles. Au cours de l’année scolaire 2024-2025, des élèves ont organisé un vaste réseau de fraude dans l’Académie de Thiès. Il avait fallu que les professeurs des lycées Malick Sy et Jules Sagna haussent le ton pour qu’ils soient arrêtés. Après leur relaxe, ils ont nargué les professeurs, ces derniers étaient devenus ridicules.
Si on cite le Prytanée militaire comme un exemple dans l’éducation au civisme et à la citoyenneté, c’est juste parce que cette école bénéficie de conditions qui permettent d’éduquer les élèves. Pourquoi, dans le souci d’éduquer, on devrait permettre à une administration militaire de sanctionner, et le refuser à une administration civile ?
Pour trouver une solution à ces problèmes de civisme et de citoyenneté, il faudra redonner à l’école sa fonction éducative.
Babacar DIOUF
Professeur d’histoire et de géographie au Lycée de Nguékokh