Développer l’industrie, développer le Sénégal
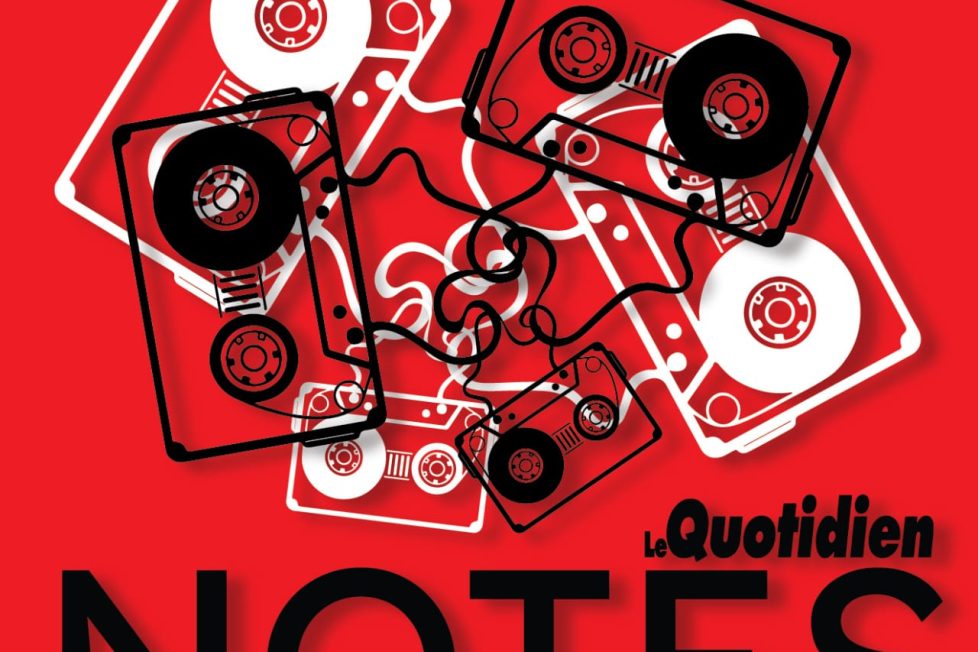
Au début de l’arrivée de Macky Sall au pouvoir, un grand entrepreneur sénégalais, très introduit dans le régime de Me Abdoulaye Wade, au sein duquel il a occupé des fonctions prestigieuses et pleines d’influence, avait «vendu» à un ministre de l’Agriculture, le projet de création d’une usine de sucre en Casamance. En ces années, le chiffre de 60 milliards de francs Cfa avait été avancé, avec la promesse de pouvoir boucler rapidement le tour de table.
Notre entrepreneur est toujours très actif, aussi bien dans les milieux d’affaires, que dans la politique dans laquelle il aimerait bien avoir une influence beaucoup plus grande qu’il n’a actuellement. La question est que, de ce projet de compagnie sucrière, il n’a plus jamais parlé. Et c’est bien dommage, car on ne sait pas si le projet avait même été réellement mûri, ou s’il s’agissait juste encore d’un «coup de pub».
Lire la chronique : Le patriotisme économique est une aberration
Car, au-delà de tout, le potentiel est là pour implanter au Sénégal une autre structure de production de sucre. C’est d’ailleurs paradoxal de voir l’engouement à produire du ciment, où les potentialités sont importantes reconnaissons-le, au point que l’on parle même d’un projet de 4ème cimenterie, alors que l’Etat ne semble pas inciter à l’implantation d’une concurrence à la Compagnie sucrière sénégalaise de Jean-Claude Mimran, où les effets bénéfiques sont aussi importants. Il est souvent entendu, de la part des commerçants membres de l’Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal (Unacois), que la protection de l’Etat garantit à la Css un monopole de fait. Or, ladite Css a toujours proclamé sans être démentie, que l’Etat n’interdit à personne de produire du sucre dans ce pays, tout au contraire. Ce qu’elle conteste, c’est la mauvaise concurrence qui lui est faite de la part des importations sauvages de sucre de contrebande.
Des experts assurent que des terres de la région de Matam, dans la vallée du fleuve, seraient encore plus appropriées pour la production de sucre d’une qualité aussi bonne, sinon meilleure encore que celle de la Css de Richard-Toll. Et lesdits spécialistes assurent que, comme pour l’usine «projetée» en Casamance en 2013, 60 milliards seraient un investissement suffisant pour une usine de taille moyenne. D’ailleurs, il faudrait y songer, car à un moment, la Css ne pourrait pas s’étendre au-delà de son pôle de production, au risque de perdre en compétitivité.
Nous sommes dans un pays où, depuis quelques années, des individus disent pouvoir faire mieux que des étrangers en termes d’investissements productifs. Certains fustigent même l’idée que l’on puisse imaginer exploiter un secteur productif en le confiant à des étrangers. Néanmoins, ce qui a été réussi jusqu’à présent, c’est le délitement des secteurs productifs florissants à la suite d’une libéralisation mal maîtrisée. Cela, de par la volonté de faire une place à des nationaux.
Lire la chronique : Le poids des exonérations fiscales
Si l’on en reste dans l’agro-industrie, on pourrait parler de la filière de la tomate. Pendant des décennies, le Sénégal n’a connu qu’un industriel, qui avait contracté avec des paysans, auxquels il assurait un prix garanti et qui lui fournissaient la matière dont il avait besoin pour produire sur place de la tomate concentrée. Ce partenariat permettait à des paysans de la Vallée de vivre de leur travail et à l’agro-industrie nationale d’afficher les avantages du modèle sénégalais. Il a fallu que les pouvoirs publics cèdent aux chants de sirènes de ceux qui leur promettaient d’augmenter la production nationale en multipliant les producteurs. Ces nouveaux venus assuraient qu’après s’être appuyés sur les importations de triple concentré de Chine, ils allaient favoriser la production locale en établissant, comme la Socas, des usines dans la Vallée. Des années après, le constat est facile à faire. Sur les deux usines de la Socas, une seule survit difficilement, les paysans n’ont plus de prix garanti, car l’industriel doit faire face à la concurrence en recourant aussi aux importations de triple concentré. La libéralisation du secteur par la promotion des importations n’a pas rendu la tomate moins chère pour la ménagère, mais a favorisé le chômage des paysans, qui ne bénéficiaient plus de prix garanti au producteur, et qui en plus, voient leurs récoltes perdre en qualité au fil des saisons, faute d’un bon encadrement technique.
Lire la chronique : Syndicats patronaux et émergence
Ce n’est pas un cas isolé. La disparition du secteur textile sénégalais, l’un des plus florissants et des plus dynamiques de la sous-région, est encore dans les mémoires de beaucoup. Si la Sodefitex peine à augmenter sa production de coton, le manque de débouchés sur le plan local y est pour quelque chose, pour se limiter à cela. Et ne parlons pas de l’arachide, un secteur que le nouveau directeur de la Sonacos, Kibily Touré, connaît bien. On ne peut que lui souhaiter, durant son passage dans la maison, de faire autre chose que le constat d’un échec inéluctable, tellement cette spéculation a été plongée dans un gros marasme.
Il est malheureux qu’à la fin de son mandat, à l’heure de faire le bilan de son passage à la tête du pays, le chef de l’Etat Macky Sall ne puisse exhiber une entreprise industrielle digne de ce nom qui aura vu le jour par son initiative, ou avec son appui. Pourtant, quand on veut créer des emplois, on ne peut négliger le secteur secondaire. Et le Sénégal a longtemps bénéficié d’avantages tels qu’il ne souffre pas d’un manque de ressources, sur le plan humain ou en termes de produits à mettre en valeur. Si l’on peut reprocher plein de choses à l’action des «partenaires» étrangers qui ont voulu conditionner leur appui au développement des secteurs qui arrangeaient le plus leurs économies, on doit aussi objecter que l’économie sénégalaise a atteint, depuis un peu plus d’une décennie, un niveau tel qu’aucun partenaire ne pourrait nous imposer une voie que nous ne souhaiterions suivre.
Lire la chronique : La Bceao contre l’économie
Il n’est pas normal que le panier de la ménagère sénégalaise soit composé à près de 80% de produits d’importation, au moment où, pour une bonne partie de ce que nous consommons, le pays est en mesure de subvenir à ses propres besoins. Mais pour changer le cours des choses, l’Etat devrait d’abord montrer une détermination qui aille au-delà des déclarations d’intention. Encourager les industriels à investir, cela pourrait même commencer à leur donner pour interlocuteur, un ministre de l’Industrie qui sait pourquoi il a été nommé à ce poste.
Par Mohamed GUEYE – mgueye@lequotidien.sn

