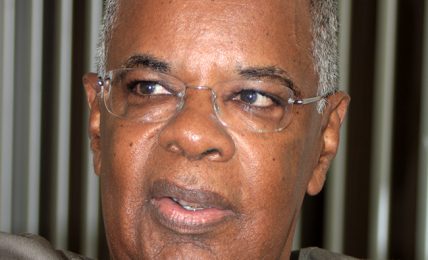(SUITE ET FIN)
La zone culturelle spéciale : un modèle de synthèse
A proprement parler, il n’y a pas de modèle type applicable à tous les territoires et à toutes les spécificités culturelles. Toutefois, des options claires peuvent être faites selon les opportunités que présente tel ou tel territoire ou telle ou telle expression artistique ou culturelle. Sous ce rapport, le «Taaxuraan» pourrait être revisité au Baol, le «Ngoyaan» au Saloum, la tapisserie à Thiès, le «Riiti» à Dara Djolof, le «Kankurang » à Mbour et le «Ndawrabbin» à Dakar. La liste n’est pas exhaustive. Loin s’en faut ! Mieux, par le jeu de diversification d’activités, de localisation et de délocalisation de cœur de métier, de nouveaux territoires seraient promus dans une perspective de construction d’une unité culturelle nationale, synonyme de «dénominateur culturel commun» ; ce qui ne signifie pas l’effacement des différences culturelles (unité dans la diversité).
A titre expérimental et pour être en phase avec la logique du plan, le modèle organisationnel proposé ici prendrait la forme d’une «Zone culturelle spéciale» et Diamniadio serait son lieu d’implantation (territoire). En effet, ce modèle présenté comme une alternative procède d’une synthèse de trois problématiques très actuelles et étroitement liées par l’économie mondiale et ses exigences. Il s’agit de la territorialisation culturelle, de la clusterisation culturelle (clusters/grappes) et de l’économie culturelle.
Cette zone d’un genre assez particulier est caractérisée par son ancrage à plusieurs niveaux :
un territoire bien précis (Diamniadio) compte tenu des nombreuses opportunités qu’il offre en tant que nouvelle ville et nouveau pôle urbain de Dakar ;
une classe créative (l’Etat dans tous ses démembrements, chefs coutumiers, collectivité léboue, acteurs culturels, universitaires, artistes, critiques, collectionneurs, galeristes, patronat, héritage multiculturel, etc.) ;
un produit culturel composite et représentatif de la région naturelle du Cap-Vert (peinture sous-verre, Gumbe, Ndawrabbin, Simb, Kasak, régate, Mbapat, Bàkk, etc.) ;
un évènement d’envergure internationale autour du produit composite (Sen’Art par exemple), prétexte pour faire de Diamniadio un pôle d’attraction et de convergence, selon une périodicité fixe (une fois l’an ou biennale) ;
un marché des arts et de la culture de type nouveau ;
un contexte favorable (nouvelle stratégie politique pour l’émergence, nouvelle ville / nouvelle vocation / nouveau contenu / nouveau hub relié par autoroute / nouvelle dynamique / nouvel indicateur de l’émergence).
Compte tenu des difficultés techniques à reproduire ici et in extenso le modèle organisationnel dans sa version graphique originale (tableau), nous en présentons les grandes lignes.
En effet, la Zone culturelle spéciale pourrait s’intégrer dans l’architecture de la Délégation générale à la Promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac rose comme entité autonome à trois niveaux :
niveau 1 : le Top management de la Zone culturelle spéciale (équipe) ;
niveau 2 : les Départements au nombre de trois rattachés au Top management ;
niveau 3 : les Unités au nombre de deux rattachées au Département chargé des affaires administratives et financières.
Du Top management découlent donc trois grands départements chargés des opérations :
le Département Recherche-action qui regroupe toutes les classes créatives de la zone à savoir :
la classe culturelle ;
la classe juridique ;
la classe sociologique ;
la classe démographique ;
la classe technologique ;
la classe écologique ;
la classe financière ;
la classe commerciale ;
la classe économique ;
le Département chargé des affaires administratives, financières et sociales subdivisé en trois unités :
l’unité de formation aux métiers des arts et de la culture avec une vocation sous régionale ;
l’unité de production qui prend en charge toutes les activités culturelles classiques courantes, l’évènement d’envergure internationale et ses dérivés (in et off) et les diverses activités de diversification ;
le Département de l’action marketing, commerciale et sociale qui a en charge le traitement des informations marketing et commerciales, l’exploitation commerciale d’un site d’hébergement et de restauration, d’un espace polyvalent (multimedia library, conférences, spectacles, expositions, résidences d’artistes, jeux et loisirs, etc.), d’un groupe de communication (bulletin, radio, TV, info en ligne, etc.), les organes sociaux (mutuelle d’épargne et de crédits, mutuelle de santé, mutuelle d’assurances et coopérative d’habitat) et la promotion de la Zone culturelle spéciale ;
La Zone est par essence un espace physique, un faisceau de relations inter organisationnelles, interprofessionnelles et interpersonnelles à partager et à valoriser. Si certaines entités dépendent directement et administrativement sur le plan hiérarchique du Top management de la zone, d’autres gardent leur autonomie dans une logique de clusterisation. Ce qui permet par exemple à un cabinet autonome de prendre en charge les études d’impact de la Zone culturelle spéciale et à une société d’auteurs de veiller aux questions relatives aux droits assujettis à la création.
L’avantage compétitif des zones culturelles spéciales réside dans leur capacité à promouvoir le génie d’un territoire en une unité de lieu, de temps et d’action avec des possibilités réelles de délocalisation de certaines activités.
Ce mode de gestion de la culture ici présenté comme étant à la fois un input (ressource) et un output (produit) contribue à fédérer des communautés humaines (énergies et synergies) autour d’une grappe d’activités (diversification), sur un territoire (label) qu’elles ont en partage, dans le but de réaliser, par l’effet de marketing, des performances économiques et d’aboutir à un mieux-être à moindre coût (coût financier, social, physique, sanitaire, sécuritaire, etc.).
Ainsi compris, le Plan Sénégal Emergent serait assurément dans une perspective culturelle (input) avec une vocation économique (output).
En conclusion, il est important de rappeler qu’ici au Sénégal, comme partout ailleurs dans le monde, aucun projet de développement ne peut prospérer si le paradigme culturel (spécificités territoriales) n’est pas au cœur des stratégies.
Plus qu’un simple «futur désiré» déterminé par un pouvoir politique au bénéfice d’une communauté humaine, l’émergence est un long et sinueux processus à construire avec celle-là, un système de valeurs à partager, une culture à fonder sur la base de nouveaux paradigmes, de nouveaux modes de penser, d’agir, de se comporter et d’appréhender l’avenir du Sénégal, l’épanouissement des Sénégalais d’ici et d’ailleurs et des hôtes.
Dès lors, la mobilisation du capital humain nécessaire à l’émergence procède d’un véritable processus d’acculturation et de mutation très complexe. Le pari ne peut être gagné d’avance si l’on sait que toute innovation est appelée à faire face à des forces de résistance.
La conduite de la stratégie de rupture exige donc la mise sur orbite de leaders transformatifs ayant un niveau de flexibilité maximale pour faire en sorte que le Pse soit effectivement une stratégie à la fois «économiquement culturelle» et «culturellement économique».
«Le Sénégal émergent» est à ce prix.
Sidy SECK
Ancien Directeur général
des Manufactures sénégalaises
des Arts décoratifs (Msad) de Thiès
siidisekk@gmail.com