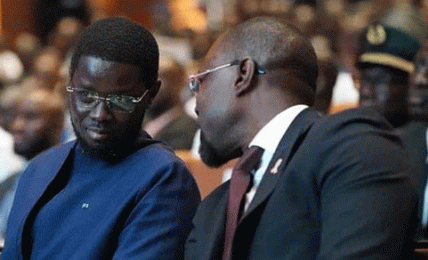«Celui qui est maître de l’éducation peut changer la face du monde.» Leibniz
«C’est l’empyrée immense et profond qu’il me faut, la terre n’offrant rien de ce que je réclame.» Victor Hugo
Historiquement, c’est au Royaume-Uni de Grande Bretagne qu’a été évoquée, pour la première fois, l’idée de «brain drain» pour faire référence à l’immigration massive sans précédent et inquiétante de personnels hautement qualifiés, dans divers domaines du savoir, en particulier vers les Etats-Unis d’Amérique, tout au long des décennies qui suivirent la Seconde guerre mondiale. Depuis lors, et tout au long du XXème siècle qu’ils ont considérablement dominé, les Etats-Unis sont devenus le principal pôle d’attraction des migrations scientifiques internationales.
De tous temps, les hommes de science ont voyagé en utilisant les moyens de locomotion de leur temps, pour aller à la quête du savoir. La circulation de la science a accompagné la circulation des hommes, et quand la circulation était beaucoup moins facile qu’aujourd’hui, à l’ère du numérique où l’information circule à la vitesse de l’éclair, la circulation de la science était même subordonnée à la circulation des hommes. Aussi, dans l’histoire des peuples et des nations, il y eut de grands pôles scientifiques, culturels et linguistiques qui attiraient les savants et tous ceux qui n’étaient motivés que par la recherche assoiffée du savoir.
Quelle que soit l’époque, l’activité scientifique et intellectuelle a toujours été associée à la mobilité. Un bon exemple de la mobilité des savants est incarné par l’humaniste persan Ibn Sina (fin du Xème, début du XIème siècle), connu en Occident sous le nom d’Avicenne. Philosophe, grand mystique, il réussit la synthèse de plusieurs sciences. Ses travaux sur la médecine sont considérés comme étant à la base de la science pharmaceutique, ce qui a été à l’origine d’une remarquable carrière scientifique, marquée par une formidable mobilité faite de pérégrinations et de sollicitations infinies.
L’appel à des savants n’a rien de nouveau. Il est aussi vieux que le monde et la science. Dans l’histoire, lorsque le roi Ptolémée fit édifier la grande bibliothèque et le muséum d’Alexandrie (au IIIème siècle av. J.-C.), il n’existait pas encore, en Egypte, une communauté savante suffisamment outillée pour animer la vie scientifique de ces temples du savoir. Le souverain se résolut alors à faire appel à des connaisseurs reconnus, originaires d’autres pays. C’est ainsi que des spécialistes de beaucoup de domaines du savoir (des mathématiques à la géographie, en passant par la physique, la botanique, la zoologie, jusqu’à la philosophie et la philologie) se retrouvèrent à Alexandrie qui, de fait, devint un pôle scientifique d’excellence et de prestige, incomparable dans le monde méditerranéen. Ce que l’appel à des savants étrangers montre, c’est aussi que l’immigration sélective (privilégiant des personnels hautement qualifiés au détriment de migrants sans aucune formation) a toujours été de ce monde.
Et comment donc ne pas parler de fuite des cerveaux ? Hier, comme aujourd’hui, il y a bel et bien fuite des cerveaux, étant donné que ce qui est perdu par le pays d’origine est récupéré par le pays d’accueil, d’une part il y a «brain drain» et d’autre part, «brain gain». Le talent se déplace vers le lieu où il est le plus productif et le mieux valorisé, là où il se sent plus libre et en sécurité, pourvu qu’il s’épanouisse et que son savoir soit utile. Dès 1712, quelques années avant de tirer sa révérence, comme sentant la fin inévitable arriver, le philosophe allemand Leibniz disait déjà : «J’aimerais mieux voir les sciences rendues florissantes chez les Russes que les voir médiocrement cultivées en Allemagne. Le pays où cela ira le mieux sera celui qui me sera le plus cher, puisque tout le genre humain en profitera toujours.»
La mondialisation et la libéralisation des économies font que les migrations scientifiques internationales ont considérablement évolué au cours des dernières décennies. Mais l’idée selon laquelle il n’y a pas de fuite des cerveaux, qu’il n’y aurait qu’une mobilité des cerveaux au sein d’une communauté scientifique internationale dans un contexte de mondialisation de la science et de l’économie, est sans fondement, étant donné que les résultats et produits de recherche des cerveaux en question ne sont jamais équitablement répartis. Il y a donc bel et bien perte et profit, déperdition des élites d’une part et plus-value d’autre part.
Au fil de l’histoire de l’humanité, les hommes de science et les figures intellectuelles qui durent fuir leur pays sont innombrables. C’est dans l’exil (choisi et assumé ou, au contraire, contraint et forcé) que certaines de ces figures produisirent même nombre de leurs travaux. Parmi les plus importants : pour ne citer que des figures parmi les plus connues, ainsi en est-il de Karl Marx, Platon, le poète lyrique allemand Heinrich Heine, le poète italien Dante, Victor Hugo et last but not least, le penseur américain Ralph Waldo Emerson (1803-1882), profondément inspiré du philosophe anglais John Locke au cours de son exil en Angleterre. A lui seul, Emerson est très emblématique de l’exil de la figure de l’intellectuel engagé, de la circulation du savoir, de sa transmission et surtout du projet de transformation (notamment sociale, politique, culturelle, économique) que porte le savoir.
A son retour d’exil, le discours mémorable que Ralph Waldo Emerson prononce devant l’assemblée de la plus prestigieuse université américaine, Harvard, en 1837, marque ce que l’on pourrait appeler la Déclaration d’indépendance de l’esprit américain et lance de ce fait le processus de décolonisation des mentalités du Peuple américain. En quelque sorte, après l’indépendance politique proclamée en 1776, il était question, pour lui, de semer dans l’esprit de ses concitoyens les graines d’un mode de pensée spécifique au Peuple américain. Il le fit notamment en parcourant son pays pour animer conférences et débats, aussi bien au niveau des élites qu’à la base de la société. Ce mode de pensée (l’American way of thinking) se déclinait en termes de «confiance en soi», «progrès», «progrès inévitable», «optimisme», rejet du fatalisme… Des idées propres à insuffler le courage et à motiver l’action.
Emerson est le plus grand penseur américain du XIXème siècle. Avant William James, Charles Pierce, et plus tard John Dewey, c’est lui qui a porté le courant philosophique du pragmatisme. C’est Emerson qui a enseigné au Peuple américain «que la confiance en soi est le premier secret du succès», que la réussite et l’utilité sont des critères de vérité, que la vérité des idées est dans leur portée pratique, ou encore que «rien n’est plus sacré que l’intégrité de l’esprit humain», que «l’idéal de la vie, ce n’est pas l’espoir de devenir parfait, c’est la volonté d’être toujours meilleur»… En plus, son affirmation selon laquelle même les faits ordinaires de la vie quotidienne du Peuple sont dignes d’avoir une place dans les formes artistiques les plus exaltantes, a posé les bases de la littérature américaine.
Sur le continent africain, l’un des plus fascinants vecteurs de la circulation des savoirs et de la retransmission qu’il nous a été donné d’observer, nous est incarné par la figure de Léonard Wantchékon. A l’analyse, c’est le parcours d’un étudiant à qui rien n’aura été épargné (la torture, le cachot, le goulag) sous le régime despotique en cours dans son pays, le Bénin, alors sous la férule du Général Mathieu Kérékou. Au point que celui qui allait devenir l’un des plus brillants universitaires africains et l’un des fils du continent qui, à l’heure actuelle, rapportent le plus à leur pays d’origine et au continent (en termes de transmission de la connaissance, de circulation des savoirs, de formation des élites), a frôlé le risque grave de rater et sa carrière professionnelle et sa vie. Jusqu’au moment où, n’ayant plus le choix et où il prenait alors le chemin de l’exil pour sauver sa peau, l’homme a failli être capturé par la police secrète du régime Kérékou, à son passage à la frontière nigériane.
Au bout du tunnel, l’exil nord-américain, l’acquisition d’une formation solide en économie, la reconnaissance par ses pairs, la splendeur au sommet de la hiérarchie de l’une des plus prestigieuses universités des Etats-Unis d’Amérique, Princeton university, l’un des bastions de la science économique. En Léonard Wantchékon, il y a celui qui, à terme, aurait pu choisir, en toute liberté et à juste raison, de tourner définitivement le dos à l’amère patrie, mais qui, aujourd’hui, contribue considérablement à la production du savoir, à sa transmission, à sa conversion en valeur ajoutée, non seulement dans son pays d’origine mais bien au-delà.
En retrouvant son pays d’origine, le Bénin, deux bonnes décennies plus tard, en homme libre, on ne peut plus libre, en universitaire de classe exceptionnelle très sollicité, jouissant pleinement de tous les avantages que peut procurer la mobilité indispensable à un intellectuel, le fils du pays ne s’est pas contenté d’être un visiteur plus ou moins régulier, qui viendrait nourrir ses racines. Il est devenu engagé et très entreprenant dans un secteur forcément porteur et productif, celui de la production du savoir et de la formation des élites appelées à conduire les destinées des nations.
Au Bénin, en 2004, Léonard Wantchékon a porté sur les fonts baptismaux l’Ireep (Institut de recherche empirique en économie appliquée). Ainsi que le concepteur et fondateur le définit en ses propres termes, l’Ireep «est un centre de formation et de recherche orienté vers l’innovation, surtout en matière de recours aux outils statistiques dans la conduite d’études d’évaluation d’impact et de recherche scientifique rigoureuse». Sur le bulletin de naissance de l’institut, Wantchékon rapporte que l’accouchement a été laborieux, mais par la persévérance, la rectitude de son fondateur, son parcours académique qui force le respect, l’Ireep est aujourd’hui un institut de référence sur le continent. L’Ireep contribue à l’élaboration de l’index mis au point par Mo Ibrahim pour mesurer la bonne gouvernance en Afrique. En plus, il est devenu un partenaire essentiel du réseau Afrobaromètre des pays francophones, et en même temps celui du centre canadien «Think tank initiative of the international development research center».
La dynamique de la circulation des savoirs est, pourrait-on dire, inscrite dans l’Adn de l’institut : Wantchékon passe, chaque été, six semaines au Bénin et en plus, une quinzaine par mois en décembre, février, ainsi qu’en mai. Des semaines d’une intense activité scientifique à laquelle contribuent grandement ses collègues nord-américains associés, pour consolider la formation et rehausser le prestige de l’institut. En termes de débouchés, nombre d’étudiants diplômés de l’institut ont été recrutés par la Banque mondiale, par des instituts nationaux de la statistique et des think-tanks en Afrique ou en dehors du continent.
Wantchékon observe : «New York est devenu ma retraite et ma base d’opération, le terrain d’opération étant l’Afrique. A New York, je trouve les ressources et l’environnement qui facilitent mes travaux : les étudiants à la pointe de l’information, les bibliothèques, les collègues. En Afrique, je me trouve au cœur des questions que j’étudie, je peux m’imprégner de mille façons de données et de faits que je pourrais ensuite traiter une fois de retour aux Etats-Unis. Un équilibre est ainsi trouvé.»
En 2010, Léonard Wantchékon a mis sur pied l’African school of economics (Ase) sur le modèle de la London school of economics (Lse). Il est vrai que l’enseignement supérieur est depuis longtemps un marché florissant, où l’intérêt financier et économique entre souvent en concurrence avec l’intérêt académique et humain. Mais davantage que la fondation d’un institut et d’une grande école, le réinvestissement de Léonard Wantchékon dans son pays d’origine est porteur d’un projet de transformation sociale, économique et par conséquent, culturelle et politique. Au-delà de la fidélité à ses origines, il y a la marque d’un homme qui a fait le choix de mettre toutes ses ressources au service d’une entité et d’une temporalité qui le dépassent largement. Pour une circulation aussi équilibrée que possible des savoirs.
Abou Bakr MOREAU
Enseignant-chercheur,
Etudes américaines, UCAD