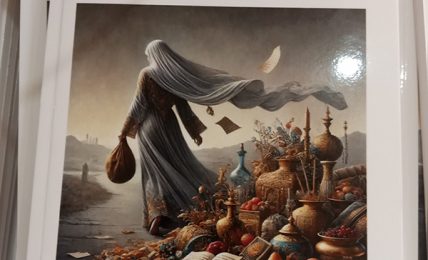50% des Sénégalais actuels n’étaient pas nés quand Moriba Magassouba faisait paraître au seuil des années 1980 son livre Demain les mollahs ? Les grands faits politiques de la décennie décisive de 70 dans le monde avaient rebattu les cartes (choc pétrolier, révolution en Iran, remous autour du jihad en Afghanistan…), mais aucune répercussion de cette vague n’était – a priori – envisageable dans un petit pays comme le Sénégal. Porté par un soufisme triomphant, héritage vénéré d’un syncrétisme entre l’islam et un corpus traditionnel et spirituel, à l’époque l’intuition, la prédiction de Magassouba paraissait à certains farfelues.
Pourtant l’ouvrage, disparu des radars, progressivement dégorgé de son fonds, avait, sinon un caractère prémonitoire, à tout le moins, mis le doigt sur la genèse du puritanisme religieux pour assainir les mœurs et resplendir la morale. Phénomène à la fois importé, mais aussi conforté et produit, car il donnait au corpus religieux une ascendance prestigieuse. Le puritanisme n’est pas le fait de quelques zélateurs marginaux. Il constitue un des socles de prospérité du discours religieux. Fondateur comme ouvrage, malgré le peu de gratitude de la postérité, Magassouba sera salué par Ibrahima Hanne qui confiera avoir eu l’idée de son roman, Errance, après la lecture de ce livre.
Mar Fall ensuite (1987) dans la revue Présence africaine et beaucoup d’autres chercheurs consacreront leurs travaux à l’avancée de ce maccarthysme d’inspiration religieuse. A travers le réseau humanitaire, le financement de lieux de culte, l’offre de formation religieuse dans les prestigieuses institutions orientales, l’influence, comme une anesthésie, produisait ses effets jusqu’à contaminer la traditionnelle tolérance prêtée au soufisme. Il est peu porté à la connaissance des Sénégalais que la cohabitation entre ledit soufisme et les tendances rigoristes, d’extraction saoudienne, ont parfois été belliqueuses sans être tout à fait frontales. La bataille d’influence et l’offre de séduction devaient se jouer entre chapelles interposées. Sur le terrain de la morale ou de la vertu, le puritanisme contestait aux confréries leur primat et dénonçait leur laxisme, accusé de paganisme. Dans cet enjeu, la défense des héritages traditionnels suspects d’impureté était impensable, même pour les confréries, car le risque était grand de ruiner leur crédit, les conduisant ainsi à davantage se réapproprier le discours du moment qu’il n’interférait pas dans leurs affaires familiales ou de succession. De l’autre côté, un rejet assumé du confrérisme les exposait à la furie des disciples qu’ils cherchaient à séduire. Dès lors, un pacte silencieux s’imposait de lui-même. Une convergence pouvant être bénéfique dans la promotion des valeurs religieuses à laquelle les deux nuances concourent.
Les mouvements puritains qui d’ailleurs essaimeront partout dans la sous-région, au Nigeria (Izala), sur les ruines du califat de Sokoto (Boko haram), et de l’empire du Macina formeront un corpus de plus en plus dur, dont certaines exégèses basculeront dans la violence. Il semble donc essentiel de comprendre que le soufisme n’est pas un barrage naturel. Les agendas sont différents, parfois complémentaires et il n’est dans l’intérêt de personne d’affronter l’autre pour en pâtir et in fine écorner l’image d’une religion commune et montrer une fissure dans le front contre l’Occident.
Autre précision importante, le soufisme n’est pas une religion, c’est la somme de pratiques, mais adossées à l’islam, seul générateur du corpus législatif et du dogme qui prescrit la foi. Cette candeur dans l’analyse servait le prêt-à-penser auto-satisfait du récit national : le soufisme sénégalais était nécessairement un rempart contre le wahhabisme salafiste. Couchée sur ses lauriers qui paraissaient immuniser le Sénégal contre toute invasion, la pensée s’est complu dans ce simplisme de l’analyse et a évité d’explorer les complexités.
L’éclatement des faits divers dans le temps long comme dans le temps court éclaire les fissures des équilibres et l’impossibilité d’avoir des analyses dépassionnées et froides entre gesticulations «puritanistes» et héroïsme «libertarien». Qu’il s’agisse de danseuses poursuivies pour dépravations des usages, d’homosexuels pourchassés, de francs-maçons, qu’il s’agisse des tenues vestimentaires jugées indécentes, le nettoyage des voiries sociétales a toujours été la marque d’une longue tradition. Les prêches abondent, bien mis en selle par les médias, avec les mêmes discours incendiaires, sans que ce ne soit du reste l’apanage du Sénégal, car partout, toutes religions mêlées, le dogme ne se met pas à la page du progressisme. Les imams, véhicules de cette nouvelle colère, paraissent bien seuls, quoi que la tunique du méchant policier des mœurs leur soit affublée, car ils sont dans l’architecture religieuse, à un stade intermédiaire, assez peu considérés, où l’enjeu de leur légitimité se joue dans cette implication dans ses sujets de caniveau. Fond dans lequel ne s’abimeront pas l’éclat et la majesté des professeurs véritables du discours moral.
Depuis les années 2000, nombre de leaders religieux qui manient avec un certain talent le vœu de retour à une virginité, accompagnée d’un rejet des influences occidentales, ont balisé le terrain d’un néo-puritanisme qui commence à gagner les cités pieuses et au-delà, avec une promotion des prohibitions plus forte, en adéquation avec l’image souhaitée. Formés dans des instituts modernes et irrigués par la déferlante à la faveur des conflits géopolitiques avec l’islam comme enjeu, l’importation de ces discours chemine désormais avec l’agenda national ; d’où cette crispation ressentie, ce sentiment d’envahissement du tout-religieux qui semble émerger, mais qui en vérité a toujours été constant depuis Magassouba et sans doute, encore plus tôt, avec Vincent Monteil et Donald Cruise O’brien dès les années 60. Il est bien commode alors d’épingler une bande de zélateurs pour en faire les étendards de l’obscurantisme.
En «pathologisant» le phénomène, on refuse ainsi d’en voir les implications et ramifications. De Oumar Sankharé, nous savons que l’excommunication n’était pas le fait d’extrémistes, mais d’un corps social, même intellectuel, qui avait concouru à son bannissement. Les phalanges qui s’affairent à traquer et à hurler pour la censure ne sont pas les cerveaux qui la pensent. A l’interrogation de Magassouba, on peut donc répondre : hier, demain, toujours des mollahs, mais toujours aussi le goût risqué de la liberté.