J’assume : les Mémoires de Béchir Ben Yahmed
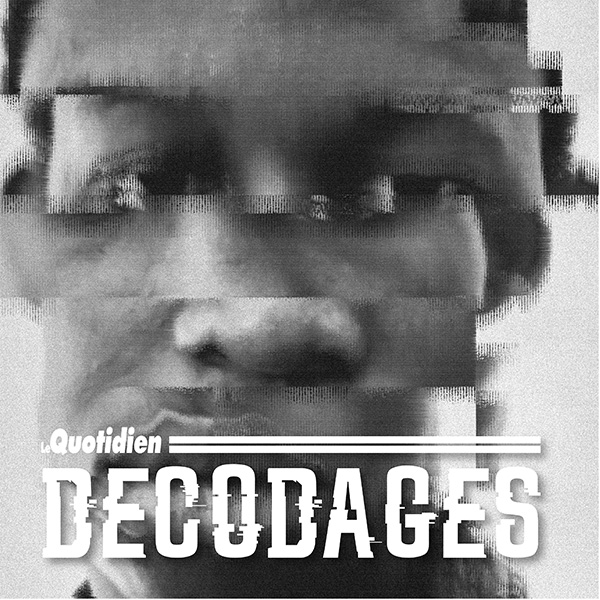
La Journée mondiale de la liberté de la presse, proclamée par l’Assemblée générale des Nations unies en 1993, est une occasion, pour les démocraties, de jauger leurs avancées en matière de protection des droits des journalistes dans l’exercice de leur fonction. Depuis le début de l’année, selon les chiffres de Reporters sans frontières, 15 journalistes ont été tués dans le monde ; 555 autres et collaborateurs de médias emprisonnés. Le travail des journalistes reste donc un brûlot qui anime de vives préoccupations.
Depuis 2021, cette journée coïncide, et fort tristement, avec la disparition de l’un des grands journalistes et patrons de presse africains : Béchir Ben Yahmed (BBY). A cette occasion, je me suis amusé à relire ses Mémoires -J’assume. Les Mémoires du fondateur de Jeune Afrique (Editions du Rocher, 2021)- publiés à titre posthume par son fils adoptif Zyad Limam. Le titre du texte, choisi avant sa mort, est une manière d’assumer toutes les positions et contractions -surtout ses relations parfois tumultueuses avec des chefs d’Etat- qui ont marqué son richissime parcours.
Lire la chronique – La grande plaisanterie des militaires de l’Aes
Au bout d’un récit palpitant de 529 pages, le natif de l’île de Djerba -devenu journaliste sur le tas, après des études de commerce à Hec et à Sciences Po- retrace ses mille et une vies d’entrepreneur, de patron de presse, de militant anticolonialiste. BBY a été un observateur attentif et un acteur majeur des grandes transformations politiques et sociales de l’Afrique postcoloniale. Il est, comme l’écrivent les journalistes Dominique Mataillet et Olivier Marbot, un «Africain dans le siècle».
[themoneytizer id= »124208-2″]
Contrairement à ses camarades du célèbre Collège Sadiki qui furent ministres, hauts fonctionnaires…, il a choisi, malgré les nombreux obstacles et les vaines tentatives de dissuasion du Président Bourguiba, d’embrasser la carrière de journaliste. Pour quelqu’un qui a été ministre de l’Information dans le premier gouvernement de la Tunisie indépendante à seulement 28 ans, la carrière politique paraissait plus commode et radieuse que celle de journaliste.
S’il n’a pas eu la chance de serrer la main du Général De Gaulle et celle de Lee Kuan Yew -l’un de ses plus grands regrets-, BBY s’est particulièrement réjoui d’avoir côtoyé le poète-Président Léopold Sédar Senghor qui, avec Alassane Ouattara et Jean Daniel, fait partie de ses «amis de toujours». Il raconte, avec fascination, la manière dont le plus illustre des Sénégalais, homme de culture par excellence et archétype du savoir-vivre, a volontairement renoncé au pouvoir en décembre 1980. Senghor, contrairement à beaucoup de ses homologues comme Bourguiba et Félix Houphouët-Boigny qui avaient pris la décision irrévocable de mourir au pouvoir, a décidé de donner les rênes de notre pays à un homme dont il a flairé les qualités. Pour lui, ce geste fort et symbolique a posé les pilastres de l’exception démocratique sénégalaise.
Dans ce texte ultime, il rappelle la position courageuse qu’il a toujours défendue au sujet de la question palestinienne. Dans la mesure où les Etats ne déménagent pas et que les peuples juif et palestinien ne vont pas s’évaporer, la cohabitation, pense-t-il, est l’unique solution, pour vivre en paix. D’autant plus que, comme le dit Bismarck, «la géographie est la seule composante invariable de l’Histoire». S’inspirant aussi de son histoire de Tunisien musulman qui a toujours vécu en bons termes avec les juifs, il croit que seule l’acceptation réciproque et sincère peut réconcilier ces deux peuples.
Lire la chronique – De la «tolérance zéro» en démocratie
Béchir Ben Yahmed a écrit, au bout d’un travail d’une décennie, des Mémoires qui constituent une mine d’informations sur l’Afrique coloniale et postcoloniale. Ce texte est une description lucide des mœurs politiques, des servitudes de l’exercice du pouvoir, de la manière dont la détermination d’une poignée d’hommes peut chambarder la trajectoire de l’Histoire des peuples.
Notre pays, qui a une histoire particulière avec Béchir Ben Yahmed, voit une bonne partie de ses médias privés à l’article de la mort. Pastef, qui a déclaré la guerre à une certaine presse dès son accession au pouvoir, a réussi la prouesse d’une journée sans presse au Sénégal en moins d’une année aux affaires. Pression fiscale suffocante (c’est le président de la République lui-même qui a traité certains patrons de presse de «délinquants fiscaux»), résiliation unilatérale de contrats, refus de payer à des médias des prestations pourtant exécutées sont, entre autres, les entourloupes du pouvoir pour se débarrasser d’une presse accusée des dix plaies d’Egypte.
Lire la chronique – Politiques de l’inimitié
Le ministre de la Communication s’est arrogé le droit de fermer manu militari des maisons de presse. Celles-ci seraient dans l’illégalité. Faut-il souligner, pour le dénoncer, la mauvaise image que donne une démocratie quand elle cherche des manœuvres pour torpiller des médias. Il est absurde et dangereux que dans une démocratie, une autorité politique soit en mesure de décider du sort d’un périodique. Pour des raisons politiques, naturellement, il faut s’attendre à ce que tous les canards peu fréquentables soient tout simplement vitrifiés.
Le combat pour une presse libre doit être la préoccupation de tous les Sénégalais. Ce n’est pas l’affaire exclusive des journalistes. Il s’agit d’une lutte permanente pour ce droit non négociable qu’est la liberté d’expression. C’est grâce à celle-ci que nos actuels dirigeants, bénéficiant d’une presse libre, et parfois même trop libre, sont venus au pouvoir. Le défi est de pérenniser cette culture démocratique.
Par Baba DIENG

