Khadim Bamba Diagne sur les flux financiers illicites «Plus de 60 milliards de dollar quittent l’Afrique pour les pays développés»
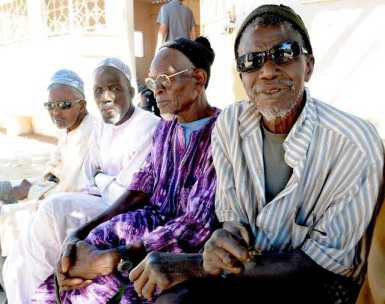
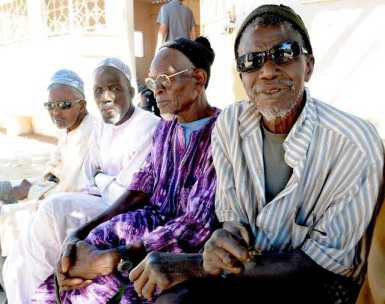
Après les «panamas papers», les «paradise papers» ont récemment fait d’autres révélations sur les pratiques courantes dans les paradis fiscaux. De grandes firmes mondiales et des particuliers ont été cités dans cette affaire. Alors c’est dans un tel contexte que la Fondation Friedrich Ebert a animé, samedi dernier, un débat sur le thème : «lutte contre les flux financiers illicites : situation actuelle et perspectives». Pour camper le décor, l’économiste, Docteur Khadim Bamba Diagne, a d’abord tenté de donner une définition exacte aux flux financiers illicites. Plusieurs définitions ont été données par le Directeur scientifique du laboratoire de recherches économiques et monétaires. Mais il reconnait que «le problème que nous avons avec les flux financiers, c’est qu’on n’a pas encore une définition exacte des flux financiers».
Tout de même, selon lui, la question touche à la corruption, à l’invasion fiscale, à la soustraction fiscale. Dans son exposé, l’économiste a évoqué les conséquences de cette fuite de capitaux pour les pays africains. Il dit : «Chaque année, on a constaté que plus de 60 milliards de dollar quittent le continent africain pour les pays développés. Alors ce fonds est supérieur même à l’aide publique au développement».
En écho, le journaliste en économie, Mohamed Guèye, par ailleurs Directeur de publication du journal Le Quotidien a appuyé l’argumentaire de M. Diagne en parlant du cas spécifique du Sénégal. «Pour le cas du Sénégal, on peut estimer qu’à côté des exonérations fiscales qui sont accordées à plusieurs entreprises surtout dans le domaine extractive, le Sénégal perd environ 660 à 650 milliards par an dans les transactions de ce type là. C’est à peu prés ce qui est traçable sur les flux financiers illicites au Sénégal», dit-il. Et d’ajouter : «Cela démontre une certaine structuration de notre législation. Ça montre que nous avons plusieurs failles qui permettent de nous retrouver dans des situations de faiblesse qui font que nous n’avons pas de prise sur l’argent qui sort de notre territoire».
Et d’après Khadim Bamba Diagne, ces pratiques sont surtout monnaie courante dans les pays comme le Nigéria qui exploitent plus les ressources naturelles. Sachant qu’il est impossible de mettre complètement fin aux flux financiers illicites, M Diagne estime qu’il existe quand même des mécanismes pour les réduire. «On peut protéger l’économie de notre pays en essayant de pousser nos entreprises à entrer dans des maisons de vert. C’est-à-dire que les entreprises maintenant cotées en bourse. Parce qu’une fois que l’entreprise est cotée en bourse, ses états financiers, ses comptes de résultats sont disponibles.La disponibilité de ces états financiers et des comptes de résultat permet à l’entreprise de respecter de gré ou de force quelque part de déclarer en fait tout ce qu’elle a gagné», soutient-il. Et dans quelques années, le Sénégal commencera l’exploitation de ses ressources naturelles. Pour Khadim Bamba Diagne, l’Etat doit d’ores et déjà mettre en place des structures. Pour le cas des institutions de contrôle déjà existantes comme l’Ofnac, l’Itie, selon lui, le choix de leur directeur général doit se faire par appel d’offre. Autrement dit, il doit y avoir des perasonnalités neutres à la tête de ces corps de contrôle. En conclusion, il a fait savoir que ces flux ne font qu’appauvrir davantage l’Afrique quand on sait que cet argent pouvait être utilisé dans des secteurs comme l’éducation, la santé.
msakine@lequotidien.sn

