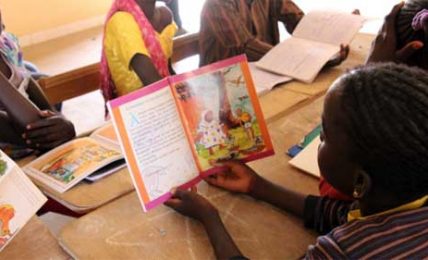La Biennale, l’art du contemporain sénégalais ?

Ma peinture est mon intérieur,
La face révélée de ma vie,
La synthèse de tout mon vécu.
Elle interroge et interpelle,
Elle livre l’essence cachée de l’âme humaine
Et indique les sphères du sublime,
Où seules se déploient les vérités essentielles
Les valeurs éternelles.
Elle renvoie au mystère,
Au caché,
A l’inconnu
A l’irréel,
Mais dévoile à travers les lois d’une connaissance mystique,
Le sens de son existence.
Elle nait écriture,
Et ne mourra jamais parce qu’écriture.
L’intitulé nous dit que la Biennale est une plateforme où l’on expose l’art africain contemporain. Toutefois, ce qu’on voit dans les expositions de la Biennale aujourd’hui n’est pas de l’art africain contemporain, mais plutôt de l’art contemporain africain.
C’est dire que la Biennale nous montre ce que les artistes africains en 2012 font de «contemporain», alors qu’elle devrait nous montrer l’art africain à son stade «actuel», si c’est ce que l’on doit entendre par contemporain, comme le spécifie son intitulé.
La Biennale ne nous dit plus ce qu’est l’art africain aujourd’hui. Elle nous présente seulement l’art qui se fait aujourd’hui en Afrique mais qui n’a pas de racine en Afrique. C’est tout simplement de l’art importé, qui aurait pu tout aussi bien se faire à New York, Paris ou Tokyo.
Qu’est-ce que l’art africain dans sa marche aujourd’hui nous dit ? C’est dans ce sens, à mon avis, qu’il faut entendre l’intitulé de la Biennale.
Si l’on a abouti à ce thème contrefait de la Biennale, c’est peut-être parce que les plasticiens dont c’est la préoccupation, n’ont pas été impliqués dans la définition de son contenu. Si cela avait été le cas, ils auraient peut-être, eux, choisi de montrer autre chose.
Aujourd’hui, à travers cette Biennale, on devrait pouvoir discerner le trajet qu’a parcouru l’art africain pour arriver au contemporain, mais malheureusement les œuvres qu’on a choisi d’y présenter ne nous informent en rien là-dessus. On n’y voit que du mimétisme.
J’ai fait un constat chez les artistes que je résumerai avec les mots de Tahar Ben Jelloun qui dit dans «Moha le fou, Moha le sage» : «Autrefois, c’était les étrangers qui nous déshabillaient, aujourd’hui, c’est nous qui ôtons nos haillons et les jetons dans les fosses de la honte.»
C’est ce qui se passe actuellement dans l’art plastique africain, dans le cinéma, dans la musique et, d’ailleurs, dans tous les secteurs artistiques. J’aime beaucoup le rap. Quand j’écoute des rappeurs africains, j’entends un discours magnifique, mais quand je les regarde, je vois des jeunes américains, et cela me gêne. Cela me désole de les voir s’américaniser ainsi. Il faut refuser ce nivellement de la mondialisation.
Il faut refuser la mondialisation culturelle. Au niveau international, nous ne sommes peut-être pas d’un grand poids économique ni politique, donc sur ce plan, on est peut-être obligés de suivre et de subir, mais sur le plan culturel et artistique, nous avons les moyens et la force de nous défendre.
Et ce n’est pas dans ce sens qu’on s’engage avec cette Biennale. Prenons l’œuvre primée : «Le cri horri», l’œuvre conceptuelle du jeune artiste marocain, c’est une pâle copie de ce que faisait le sculpteur Tinguely. «Cette machine», je la nomme ainsi parce que, pour moi, c’est plus près de l’exploit technique que de l’œuvre d’art, c’est un assortiment de klaxons montés sur deux barres de fer, qui se déclenchent par interaction. C’est du déjà-vu. Cela nous renvoie au sculpteur Tinguely : ses œuvres se décomposaient au rythme d’une musique qui y était intégrée. A la dernière note, toutes les pièces de la sculpture gisaient par terre. On a appelé cela de l’art éphémère. Si aujourd’hui en Afrique, on vient primer un travail qui n’est qu’une pâle copie, c’est grave.
Et c’est ça l’art conceptuel, qui semble vouloir réduire la part de l’émotion dans l’œuvre d’art à 10% et porter l’idée à 90%, alors que ce devrait être le contraire. 90% d’émotions et 10% de talent s’il y en a. Aujourd’hui, pour être artiste surtout en Europe, il faut sortir de l’Ina, être ingénieur de ceci ou cela. Cela semble participer d’une certaine quête occidentale qui semble vouloir tuer l’art.
Il nous faut revenir un peu sur l’histoire du mouvement conceptuel.
Après les années 50, des mouvements qui prônaient la mort de l’art sont nés à travers l’Europe. Ils cherchaient vraiment à désacraliser l’art. Je me souviens d’ailleurs d’un directeur des Beaux-arts de l’école de Dakar, qui avait été membre de «Support Surface», un des mouvements conceptuels les plus en vue dans les années 60. Je dois dire que j’adhère à cette démarche qui ne se justifie qu’au regard de l’histoire de l’art européen. C’était une suite logique à leur parcours social. Je comprends que les artistes aient repris à leur compte les préoccupations sociales. Il répond à une réalité et s’inscrit en réaction à la surconsommation et à ses impacts sur l’environnement. D’où la démarche de César avec ses cannettes compressées : 1000 cannettes de bière réduites en un cube de 20 cm3. Ils cherchaient des réponses à leurs propres questions. Nous ne partageons pas les mêmes réalités. Nos préoccupations sont différentes.
L’art, chez nous, avait d’autres finalités. Il servait à créer, à anéantir, ou était utilisé à des fins thérapeutiques, etc. Là aussi, il y a un problème qui se pose. Les intellectuels qui tournent autour des artistes peinent toujours à définir l’art nègre ou l’art africain. Ils reprennent toujours des formules consacrées à l’art européen, qui n’ont rien à voir avec les nôtres, avec notre conception négro-africaine de l’art. Je ne dis pas cela par passéisme. Je suis un homme du 20ème siècle, qui veut prendre l’avion, avoir une Mercedes pour pouvoir circuler, ou un frigo par commodité. Mais cela n’a pas d’impact sur le Négro-africain en moi. Tous ces concepts d’installation, de conceptuel, si nous voulons nous les approprier, nous devons les prendre seulement comme des outils et instruments par lesquels nous nous exprimons. Si nous sommes en mal de modernité au point d’utiliser des canons venus d’ailleurs, notre génie serait d’en faire des outils. Au 21ème siècle, nous pouvons utiliser la machine, la technologie, seulement en leur donnant notre propre souffle. On ne peut pas vivre en vase clos, mais il faut «digérer» ces apports, ces influences.
Quoi qu’on puisse dire, les artistes d’aujourd’hui sont marginalisés. Michel Ragon était, dans les années 80, le président de l’Association internationale des critiques d’art. Dans son livre «L’Art, pourquoi faire ?», il répondait ainsi à ces mouvements qui prônaient la mort de l’art : «Ils se trompent ceux qui prophétisent que l’art va mourir. C’est nous qui mourrons, l’Art est éternel.»
Les artistes africains d’aujourd’hui semblent n’avoir rien à proposer leur appartenant. Ils s’annihilent et foulent aux pieds leur identité, on a l’impression qu’ils ont une haine de soi. Ils se minimisent, oubliant qu’il y a moins de deux siècles, c’est cet art africain qui a sauvé l’art occidental par la rencontre entre Picasso et la statuette négro-africaine. Ce qui a donné naissance au cubisme. De tous temps, les artistes ont été entourés par des intellectuels contemporains qui, parallèlement ou en complicité, avec les artistes, nourrissaient par des mots et essayaient de déceler et de traduire les enjeux et soubassements intellectuels, sociaux et moraux qui se reflétaient dans leurs travaux.
En 1960 naquit l’Ecole nationale des arts de Dakar. D’ailleurs, je me demande pourquoi Senghor l’a nommée ainsi ? En réaction à celle de Paris ou de New York ? Toujours est-il que, de 1960 à 80, en sort une peinture qu’on a remarquée et appelée «l’école de Dakar».
Des artistes comme Ibou Diouf, Khalifa Guèye et d’autres ont été les acteurs les plus remarqués de cette génération qui a eu le privilège de montrer au monde, grâce au premier Festival des arts nègres, cette «école de Dakar».
C’est d’ailleurs ce qui motivera, au début des années 80, le parachutage d’un directeur coopérant français à l’Ecole des beaux-arts de Dakar. Ce directeur, Cheniaux, était un fervent animateur d’un de ces mouvements conceptualistes qui, à mon avis, n’avait été envoyé ici que pour contrecarrer cet élan spontané qui était la marque de cette école de Dakar, afin d’imposer une autre tendance. L’école de Dakar avait cette caractéristique de l’influence du masque et de la statuette nègre.
Les artistes auraient dû prendre cette école comme un acquis historique, la dépasser, et lui apporter un plus sans l’altérer. Personnellement, c’est la voie que j’ai choisie. Je ne renie pas cette école, mais après Pierre Lods, j’ai fait d’autres rencontres qui m’ont aiguillonné vers d’autres voies de création et m’ont permis de dépasser ce concept d’école de Dakar, qui était un style chargé de trop de motifs décoratifs, je veux dire de folklore. C’est en élaguant ces motifs que je suis parvenu à une écriture picturale qui me rapproche des signes et symboles des hiéroglyphes égyptiens.
Pour rester fidèle au sens et à la définition que je donne à l’art africain dont Malraux disait «qu’il est une puissance de l’imagination et fruit de l’intuition poétique», je cherche à travers cet art une force que portaient jadis nos sculptures pour implorer nos dieux. Comme quand le masque était porté et qu’un batteur de tam-tam jouait des notes codifiées, accompagné par une danse, et qu’il se mettait à pleuvoir.
Je veux que mes œuvres portent cette force qui leur donne une dimension mystique. Je pense que c’est cela le crédo de notre art.
Notre art, émanation constante d’une expression spirituelle, donc civilisatrice, guide nos pas dans notre quête de sagesse et de lumière, comme un flambeau qui nous éclaire dans la nuit des temps.
Cet art, symbole de notre humanisme originel, nous révèle et nous magnifie notre existence d’homme tout court, dans ce qu’il a de concis, total et précis.
Source de vie et de lumière, il nous confirme et nous conforte dans nos intentions et nos propres propositions, participant ainsi à l’édification et à la construction d’un monde meilleur, d’un monde bon, juste et universel. Il réaffirme notre engagement permanent à l’échange et à la participation, élément sine qua non à notre évolution et notre salut.
Les sculpteurs sorciers africains n’ont pas eu besoin des académies pour faire des œuvres d’art achevées. Le changement de matériaux ne doit pas nous empêcher de garder l’âme et la force qui étaient dans nos réalisations.
C’est aussi dans cette quête de réalisation de l’homme que je suis personnellement impliqué. Parce que l’homme est au centre de ce travail. Je veux arriver à retrouver l’homme originel, cet homme dépouillé de culture, pour ne garder que son humanité. Cet homme n’a ni couleur ni culture. Il faut se débarrasser de ces notions pour laisser surgir l’homme originel. Prenons l’exemple de Adam, le premier homme, imaginons qu’on lui donne une toile et un pinceau, quelle serait la part de culturel dans son œuvre ?
C’est en retrouvant cet homme originel que nous dépasserons le facteur culturel, géographique ou historique. C’est ainsi que nous pouvons parler d’œuvre universelle. Ce n’est pas en considérant ce qui se fait à Tokyo, Paris ou New York que nos œuvres sont universelles.
L’universalité est un lieu de rendez-vous ou chacun amène sa partition pour un concert de l’universel. C’est ainsi que nous pourrons échapper à cette globalisation, ou mondialisation, cette standardisation, où se trouvent étouffées, mises au pas nos identités.
Au moment où nous sommes, où la culture chez l’individu est aussi importante que le sang dans l’organisme humain, il est plus que jamais temps pour nous de relever les défis qui nous assaillent, les uns plus difficiles que les autres. Pour ce faire, l’artiste doit descendre des gradins et se projeter dans l’arène pour participer au développement et à l’œuvre de construction d’une plus belle humanité.
Aujourd’hui considéré comme un énergumène, sans utilité pratique compatible aux besoins consommateurs de ces temps modernes, l’artiste se veut pourtant un acteur incontournable du développement et du progrès social. Il est engagé. Un penseur occidental disait «qu’embarqué me paraît plus correct qu’engagé. Il est en pleine mer et doit ramer pour assurer sa survie».
Sur le marché occidental, les artistes africains sont considérés comme des artistes de seconde zone. Nous devons construire le nôtre pour mieux affronter le marché de l’art international.
Voilà qu’aujourd’hui nous venons de boucler la Biennale sans pouvoir comptabiliser des contacts capables de faire sortir notre art de son ghetto africain. Ce que les organisateurs ne savent pas, c’est que jamais Etat et marché n’ont pu faire bon ménage. Le monde ne s’intéressera pas à nous par ce biais. Les seuls artistes qui sortent du lot, qui arrivent à émerger sur le plan international, sont parrainés par de douteux fonctionnaires de la coopération française.
Nous avons besoin, pour faire sortir notre art de nos frontières, d’avoir autour de nous des professionnels de l’art tels que muséologues, curateurs et critiques d’art, qui pourront l’introduire dans des circuits adéquats.
C’est pourquoi je voudrais qu’on arrête la Biennale pour créer, à la place, une Foire internationale des arts. Cette foire impliquerait des galeries et musées de l’extérieur afin de créer des conditions favorables à l’émergence d’un marché de l’art, ce qui aujourd’hui est pratiquement inexistant en Afrique.
ZULU MBAYE
Ancien président de l’Association des artistes sénégalais