La nuit est un vaste pays
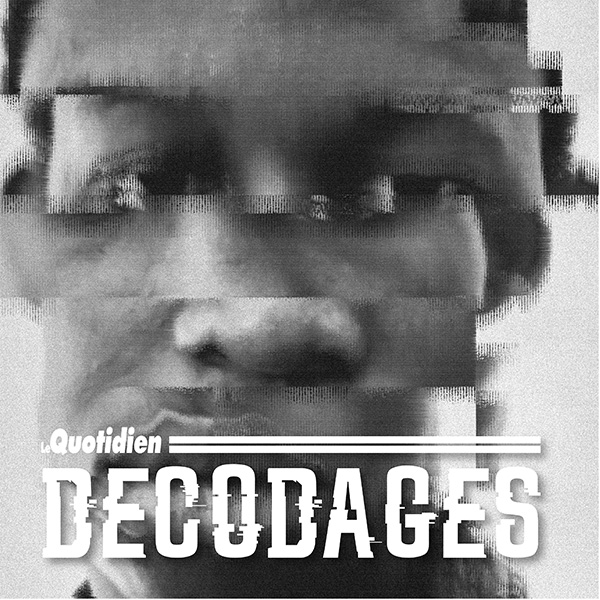
Dans le monde chaotique où nous vivons, chaque fin d’année est une occasion pour espérer que l’année prochaine soit meilleure, que les défis auxquels nous sommes confrontés soient enfin relevés par tous les habitants (passants) de la Terre, que la guerre cesse d’être le sacrement de notre époque, que les Palestiniens puissent enfin vivre librement dans les limites d’un territoire bien défini -au sens de délimiter, établir sans ambages des contours, des barrières plus ou moins perméables selon les mentalités, circonscrire, tracer des frontières, surtout des frontières-, qu’ils soient aussi affranchis des carcans du ressentiment, de la violence et de la haine envers l’Etat hébreu, envers le monde, envers l’Autre, envers soi ; que nous puissions avoir l’intelligence d’enclencher un réel sursaut collectif, car il n’y a pas une autre alternative : c’est prémunir notre paquebot contre le naufrage ou tout simplement périr ; que la guerre de moins en moins froide entre les grandes puissances (la Russie et l’Europe, la Chine et les Etats-Unis) soit totalement refroidie par une once de lucidité ; que la solution nucléaire demeure toujours un simple moyen de dissuasion, et non un instrument de mort, comme elle l’a été au début de la seconde moitié du XXe siècle. Ce sont ces «utopies émancipatrices» vers lesquelles notre monde doit tendre.
Dans notre pays, hélas !, les événements dramatiques auxquels nous assistons ne sont guère rassurants : l’économie est à l’article de la mort du fait d’une cascade de décisions impromptues et loufoques prises par nos gouvernants ; les libertés fondamentales sont bafouées par les écorchés vifs qui nous dirigent ; une crise institutionnelle aux conséquences calamiteuses est à nos trousses ; le pays est noyé dans une crise économique exceptionnelle à cause des politiques à tâtons d’un gouvernement dont l’orientation précise reste (et restera) toujours une énigme, après quasiment vingt-quatre mois aux commandes de notre rafiot. Cette année a été en grande partie très douloureuse pour notre pays ; et on a le pressentiment (peut-être qu’on peut se tromper de bonne foi, et c’est ce qui est souhaitable) que celle qui viendra sera aussi difficile ; que notre pays, non sans honte et acrimonie, va continuer de faire le pied de grue devant les portes de ses partenaires techniques et financiers pour espérer que sa situation inextricable soit enfin résolue.
Les temps sont crépusculaires : il n’y a plus rien sous nos tropiques ; nos maigres ressources ont été bradées, falsifiées, volées, et cetera. La responsabilité de cette situation extrêmement compliquée est imputable au Président Macky Sall et à ses soutiers. Les révolutionnaires de Mars ont hérité d’un pays en ruine. De ce fait, il faut se ceindre les reins, financer avec patriotisme et dévouement le Plan de redressement économique et social (Pres) comme les Américains l’ont fait pour l’Europe occidentale et pour le Japon au sortir de la Seconde Guerre mondiale, car la route qui mène à l’émergence promise en 2050 sera longue, inextricable. Et chacun y laissera des duvets. Nos compatriotes vivent dans une détresse si grande, si suffocante, si fatale. Sans imaginaires de bonheur ou de miracle économique. Et, dans ces conditions-là, on concentre ses énergies sur autre chose (survivre) plutôt que de fêter Noël. Les échos qui me parviennent des miens, naguère si enfiévrés et guillerets à cette période de l’année, donnent une idée sur la crise économique aiguë que traverse notre pays. On me rapporte que, pour cette année-là, on fera le mort, on fera comme si de rien n’était, ou comme si la fête est subitement devenue peccamineuse, ou comme si elle mène au stupre, ou comme si on a oublié sa magie, ses vertus, son humanité, pour montrer que les vaches sont maigres, trop maigres pour être traites ; qu’il n’y a pas lait ni de viande, qu’il n’y a pas beaucoup de victuailles pour organiser des fêtes, lesquelles seront sans doute irresponsables et suicidaires. C’est une situation difficile à imaginer, à accepter, à vivre, et dont même l’évocation suscite de la nostalgie ; mais la conjoncture économique ne laisse aucun choix : c’est la parcimonie ou la mort (engendrée par une famine semblable à celle qui décima la Chine à la fin des années 1950) dans l’indifférence totale de la République. Donc on choisit, on s’adapte, on crée un discours pour que les jeunots et jeunes puissent comprendre les enjeux, et accepter la situation la mort dans l’âme.
Nostalgie, ai-je dit, même si, je l’avoue, elle est mauvaise conseillère ; et, de ce fait, il faut s’en méfier. Dans mon «jardin des pêches», fêter Noël revenait à faire le bilan de l’année écoulée, à prier, surtout prier, à mesurer et à renforcer encore les liens de solidarité, les valeurs que les sœurs et frères ont en partage, à espérer vainement que le futur sera meilleur, que les pouvoirs publics viendraient enfin pour réconcilier leurs laissés-pour-compte avec le récit fondateur de la République -de toute République, aussi inégalitaire soit-elle. Il y avait quelque chose de foncièrement politique dans leurs espérances et conciliabules. A savoir que l’électricité, pour certaines bourgades qui gambadent encore dans la pénombre et dans le Moyen Âge, fût enfin une réalité ; que l’eau potable, la santé et l’éducation irradiassent la vie de tous les campagnards ; que l’on pût, pour une fois dans sa vie, élever son bétail sans risquer d’être dépouillé en une nuit par des brigands armés jusqu’aux dents et infatués, grâce à l’amélioration de la sécurité et le dépassement de la seule loi de criminalisation. L’ambiance était toujours semblable à celle des premiers jours fastes d’une Révolution et de ses grandes promesses de chambardement ou, pour utiliser le mot en vogue, de rupture. On chantait, on dansait, on rêvait.
Et les gens étaient repus comme les arrivistes qui nous gouvernent.
Les miens sont des couche-tôt (la nuit, chez eux, est un Labyrinthe de l’inhumain) et, naturellement, des lève-tôt. A cette heure où les dernières étoiles s’enfonçaient sans bruit (heureusement qu’il n’y a jamais de bruit) dans le ciel, et où la naissance de l’aurore donnait allègrement sa belle lumière, celle que désirent les grabataires et les noctambules attardés dehors, on entendait (ou devinait) les premières énergies du village. Le charivari devenait de plus en plus prégnant, et décorait l’atmosphère. Les vieux, que l’on considère comme des sages du fait de leur âge et non de leur érudition (un vieillard qui trépasse n’est plus une bibliothèque qui brûle, mais juste un gueux en moins, une souffrance écourtée), donnaient les premiers ordres de la journée. Avec autorité, solennité et enjouement. Les hommes étaient chargés d’égorger les premières bêtes (celles que l’on glane dans tout le village, chez les crève-la-faim comme les riches, à savoir ceux qui ont un grand cheptel), de les triturer. Et de s’endimancher. Quant aux jeunes femmes et rombières, comme le veulent les règles violentes du patriarcat, elles devaient défricher la frondaison de la place publique, chercher du fagot, cuisiner, chanter, danser ; elles avaient aussi l’obligation d’être sensuelles, belles, attirantes, nuisibles à la continence, et cetera ; celles qui étaient en âge de se marier (l’âge est un critère dont l’appréciation est relative, un critère avec lequel on peut ruser surtout quand on est un grand amateur de chair fraîche) devaient avoir une tenue parfaite, une retenue proverbiale, une voix plus doucereuse que celle de nos guides religieux ou de nos tartuffes considérés à tort comme des dévots, une bonne mine qui est ostentatoirement mise en exergue par une belle carnation, une chevelure aussi longue que celle du diable, des boucles d’oreilles semblables à des paraboles, des sandales en cuir aussi rutilantes que les voitures neuves de nos gouvernants, une peau aussi lisse que celle du serpent, des poitrines aussi exhibées qu’un butin arraché à un vieil ennemi au bout d’une longue et sanglante guerre, des arrière-trains allègrement libérés des servitudes de la pudeur pour être vus et appréciés (c’était aussi l’occasion, pour les mômes, de s’initier, peut-être inconsciemment, au monde chaotique de la sexualité), puisque le mariage est le stade suprême de leur accomplissement, la voie sacrée qui mène au Paradis de Dieu -croyance avilissante (et saugrenue) que des récits, vieux de plusieurs générations et gardés jalousement par des mégères, ont incrustée au fond de leur crâne.
Les femmes (la violence du patriarcat dépasse les limites de l’entendement) étaient aussi chargées d’aller traire les vaches dont les pis étaient gonflés de lait, et qui savaient bien flageller celles et ceux qui s’approchaient de leur repaire et de leur trésor. Nos femmes, obséquieuses jusqu’à la révérence envers les mâles qui gardent avec violence la clef de leur salut sous leurs pattes, revenaient au banquet par-devers elles des calebasses remplies jusqu’à l’extrémité de la paroi, que les hommes ingurgitaient en distillant des dithyrambes à qui mieux mieux. L’ambiance continuait d’être joyeuse, excitante, et les quelques sages, ceux qui sont toujours en mesure de s’extirper de leur grabat et d’interrompre provisoirement leurs conversations avec la mort, prodiguaient conseils et prières à l’assistance. On avait toujours les mêmes prières -«Si l’année prochaine s’annoncerait calamiteuse, qu’elle fût comme celle qui vient de s’écouler !» – et les espérances de mieux-être que j’ai citées ci-dessus. Repus de lait et de viande comme de bons bergers, et heureux comme des éleveurs prémunis contre les bêtes sauvages et les filous grâce aux redoutables talismans de Cheikh Bara ou à la puissance dévastatrice des harpons, il ne restait qu’à attendre impatiemment la nuit. Laquelle est un vaste pays. (A suivre…)
Par Baba DIENG

