La taxation et ses effets
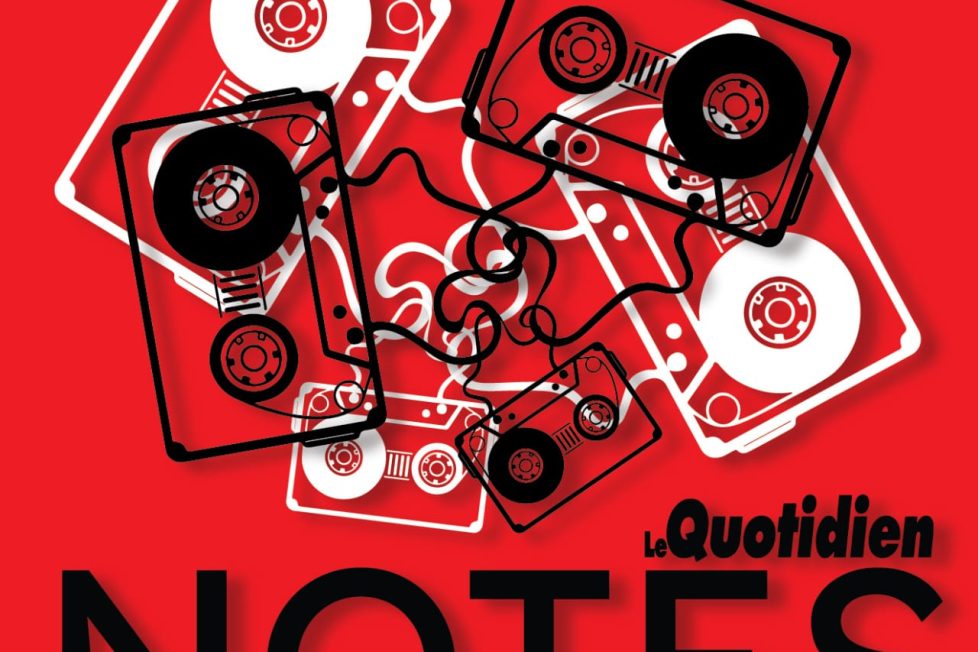
La phase active de la renégociation des contrats a pris son envol. Les différents investisseurs sont assis sur des braises. En plus de revoir des contrats signés depuis des lustres, les autorités ne se gênent pas pour revisiter les taxes imposées -ou non- à certains contrats déjà conclus. Le plus emblématique en ce moment, c’est celui de la société pétrolière Woodside. Le fisc sénégalais réclame à la société australienne, comme part imposable dans la transaction qui a abouti à la cession des parts de la société Far à Woodside, plus de 41 milliards de francs Cfa d’arriérés d’impôts sous astreinte. Cette affaire a été portée en Justice au Tribunal de Dakar. Dans le même temps, Woodside s’est également pourvue auprès du Cirdi de Paris, sur la même question.
Lire la chronique – La politique comme diversion
Mais il ne s’agit pas que de cela. Il y a quelques jours, on a appris que les opérateurs de téléphonie Yas et Expresso s’étaient vu retirer leur licence 5G, au motif qu’ils l’avaient acquise au montant jugé dérisoire de 3 milliards de Cfa. Bien qu’avérée, cette information n’a cependant pas fait l’objet d’une quelconque publicité. Ce qui, depuis un certain temps, semble être le mode de fonctionnement officiel sur certaines affaires. Ainsi, on a vu que la redevance de la société Canal Plus Sénégal a été révisée à la hausse, passant de 75 millions de francs Cfa annuels à un peu plus de 4 milliards.
Lire la chronique – Du 4ème sous-sol aux limousines et jets privés
Ces affaires ne se présentent pas comme des initiatives qui visent à la préservation des intérêts du pays, comme on voudrait les présenter. Il suffit de savoir que, depuis l’ouverture de ce contentieux avec les Impôts et les plaintes en Justice et au Cirdi qui s’en sont suivies, Le Quotidien a appris que Woodside a décidé de geler tous les versements dus à l’Etat du Sénégal. Depuis sa plainte, la multinationale pétrolière aurait déjà provisionné dans ses comptes les moins de 42 milliards de francs Cfa que lui réclame l’Etat du Sénégal, en attendant l’issue du litige. Et toutes les parts du Sénégal dans les ventes du brut de Sangomar sont également gelées. Cette procédure, a appris le journal, est parfaitement légale en cas de contentieux entre deux partenaires, jusqu’à ce que le cas soit vidé. D’une certaine manière, cela revient à dire que les pouvoirs publics, qui ont escompté de nombreux milliards dans leur procédure contre un partenaire d’affaires, sont aujourd’hui réduits à contempler ce dernier utiliser sa part de l’argent du brut du Sénégal, tandis que le pays, qui a tant besoin d’argent, ne peut disposer de sa part.
L’ironie du paradoxe est que depuis un certain temps, le discours officiel est de permettre au pays de disposer en toute souveraineté, de toutes ses ressources du sol et du sous-sol. Il n’est donc pas permissible que des étrangers, quelles que soient les ressources qu’ils peuvent injecter dans l’économie, viennent s’en mettre plein les poches au détriment des enfants du pays. D’où la politique souverainiste de leur faire rendre gorge à tout prix. Et les partenaires qui ne voudraient pas se plier à ces mesures seront contraints de laisser la place à ceux qui accepteraient. On ne sait pas s’ils seront nombreux, à la manière dont les règles du commerce international s’appliquent. Le fait, pour Woodside, d’avoir conduit en Justice son partenaire a rendu méfiants les autres investisseurs, et frileux les potentiels clients des ressources sénégalaises.
[themoneytizer id= »124208-2″]
Tout le monde se demande à l’heure actuelle, si le Sénégal est encore «business friendly», comme l’on dit à l’Apix. D’ailleurs, cette agence de l’Etat, qui prépare son prochain Forum d’investissement au Sénégal pour octobre prochain, a été prospecter auprès de potentiels investisseurs chinois. Notre Premier ministre était allé avec les responsables de l’Apix jusqu’à Hangzhou pour les aider à tenter de «nouer et de renforcer des partenariats dans des secteurs stratégiques comme les infrastructures, l’énergie, l’agrobusiness, la technologie, etc.». On imagine que l’on verra, ainsi que promis, les fruits de cet important déplacement, dans les semaines à venir.
Nos autorités ont voulu nous présenter les partenaires chinois comme des gens avec lesquels il est possible de nouer des partenariats différents de ce que l’on a toujours fait avec les pays de l’Ocde, et qu’à présent, nous en serons à un mode de «partenariat gagnant-gagnant», bien plus bénéfique que ce que l’on nouait avec les pays au capitalisme affiché.
Lire la chronique – Diomaye, un César sénégalais ?
Dans leur enthousiasme d’avoir pu décrocher des partenariats, nos dirigeants se sont félicités d’élargir le business avec des «partenaires du Sud Global», si différents de nos partenaires traditionnels, mus uniquement par le lucre et l’intérêt personnel. Il est vrai que les dirigeants du pays ont sans doute plus d’information que le journaliste moyen. On ne peut toutefois s’empêcher de rappeler que le financement de l’autoroute Ila Touba s’est fait avec des capitaux chinois, levés par le Président Macky Sall. Ce même financement a été finalisé pour continuer la voie jusqu’à Kaolack. Or, à ce que l’on sache, il ne s’agit ici ni de don ni de prêt à taux concessionnel. Le Sénégal s’est d’ailleurs déjà engagé à éponger les plus de 420 milliards de francs Cfa qu’aura coûté cette infrastructure. En plus du contribuable sénégalais, tout usager de ce péage contribue à ce remboursement.
Si les usagers se plaignent de l’état de dégradation de l’infrastructure, et si les employés de la société concessionnaire mise en place avec l’appui de l’Ageroute ne sont pas satisfaits des conditions de travail qui leur sont faites, surtout en comparaison au traitement de leurs homologues qui sont employés sur l’Autoroute de l’avenir Dakar-Aibd, beaucoup ne comprennent pas que le partenaire chinois du concessionnaire n’a d’autre préoccupation que de rentrer rapidement dans ses fonds, quel que soit ce qui pourra advenir à l’infrastructure et au personnel. La solidarité du Sud Global ne semble pas non plus être une préoccupation ici.
[themoneytizer id= »124208-19″]
Mettons de côté les Chinois, pour revenir aux effets de la taxation tous azimuts que l’Etat impose aux privés nationaux et étrangers. Même s’il s’agissait de faire payer à Canal Plus des arriérés de redevance -on ne sait d’ailleurs sur quelle base légale-, l’augmentation à plus de 4 milliards de Cfa par an aura déjà eu des conséquences. Sans avoir à communiquer sur cette taxation confiscatoire, l’opérateur de télévision a non seulement renoncé à une initiative de baisse de ses prix, mais fait passer aussi son abonnement à la hausse. On a vu un célèbre «député du Peuple» s’indigner de cette hausse, sans se demander si cela pouvait être justifié aux yeux de l’opérateur. Le même élu du Peuple ne s’est pas indigné en son temps que Télédiffusion du Sénégal (Tds), l’opérateur national chargé de la collecte, du transport et de la diffusion des contenus audiovisuels numériques au Sénégal, ait retiré à la société sénégalaise Excaf, le droit de gérer la Tnt. La conséquence en est que maintenant, tout foyer sénégalais qui ne serait pas muni de décodeur Canal Plus n’est plus en mesure d’accéder à des chaînes sénégalaises gratuites. Un scandale qui n’émeut pas outre mesure notre «député du Peuple» et ses «honorables collègues».
Lire la chronique – L’économie, seul vrai problème
Par ailleurs, on apprend que toutes les organisations membres du système des Nations unies se prépareraient à délocaliser leurs sièges du Sénégal, pour des pays comme le Kenya, pour une bonne majorité, ou la Côte d’Ivoire et le Rwanda pour d’autres. La raison en serait un contentieux né de l’occupation de la «Maison des Nations unies» à Diamniadio. Cet ensemble architectural futuriste, construit par le Sénégal et inauguré par Antonio Guterres, le Secrétaire général des Nations unies, et Macky Sall lui-même, était destiné à abriter toutes les structures membres du Système des Nations unies sous un même toit. En plus de donner encore plus de vie à la Cité de Diamniadio, qui peine à trouver son souffle, on libérait des bâtiments dans le centre de Dakar, permettant ainsi quelque part de réduire le prix du loyer. Et pour les occupants des nouveaux bureaux, les avantages de se trouver tous dans les mêmes locaux facilitaient les contacts en réduisant les déplacements, entre autres.
Tout était au point pour que les premiers occupants prennent leurs places. Les autorités sénégalaises ont voulu revenir sur l’accord en voulant faire payer un loyer, chiffré à des millions de Cfa, aux organismes onusiens. Une première dans l’histoire des relations entre les Nations unies et le Sénégal. L’intransigeance des deux parties a abouti à la volonté de délocalisation.
Si les Sénégalais ne semblent pas encore avoir pris conscience de la catastrophe à venir, les futurs pays d’accueil, eux, se frottent les mains. La Côte d’Ivoire, par exemple, a pendant longtemps disputé au Sénégal d’abriter le siège de la Fao à Dakar. Abidjan avait mis en avant plusieurs atouts. Il a fallu tout l’entregent de l’ancien ministre Papa Abdoulaye Seck pour que le siège revienne à Dakar. Si la Fao s’en va aujourd’hui, on se demande qui empêchera le maire d’Abidjan de lui offrir son meilleur bâtiment. Ainsi qu’à d’autres.
Lire la chronique – Efficacité vs Réalisme
Dakar va regarder partir plus de 3500 fonctionnaires internationaux, qui ont des salaires plus que confortables. En plus de ces gens, plus de 15 mille travailleurs indirects, fournisseurs, avec des contrats à plus ou moins long terme, risquent de se retrouver au chômage. Ces Sénégalais bon teint ne pourraient pas rejoindre leurs partenaires internationaux dans leurs nouveaux lieux d’installation. Il y a en plus des gens de maison, des gardiens, ainsi que d’autres partenaires dont l’activité dépend en majorité de celle des organisations des Nations unies. Les ressources et les moyens de vivre de ces Sénégalais sont-ils, à la balance, moins utiles au pays que les revenus que l’Etat voudrait tirer de son hypothétique loyer ?
Il ne faut pas oublier par ailleurs que les bâtiments étaient censés être utilisés dans le cadre du Partenariat public-privé avec le constructeur Envol Immobilier. En perdant son locataire, l’Etat du Sénégal sera-t-il en mesure de faire face au loyer dû à son concédant ? Et s’il faisait défaut, n’y aurait-il pas des risques de procès ? A cela, il faudrait aussi se demander l’image que cela reflètera auprès d’autres entreprises opérant à Diamniadio ou ailleurs, en partenariat avec l’Etat. Déjà, le turc Summa serait en train de réduire la voilure sur le Pôle urbain.
Par Mohamed GUEYE – mgueye@lequotidien.sn

