L’Afrique perd la guerre Trump-Chine
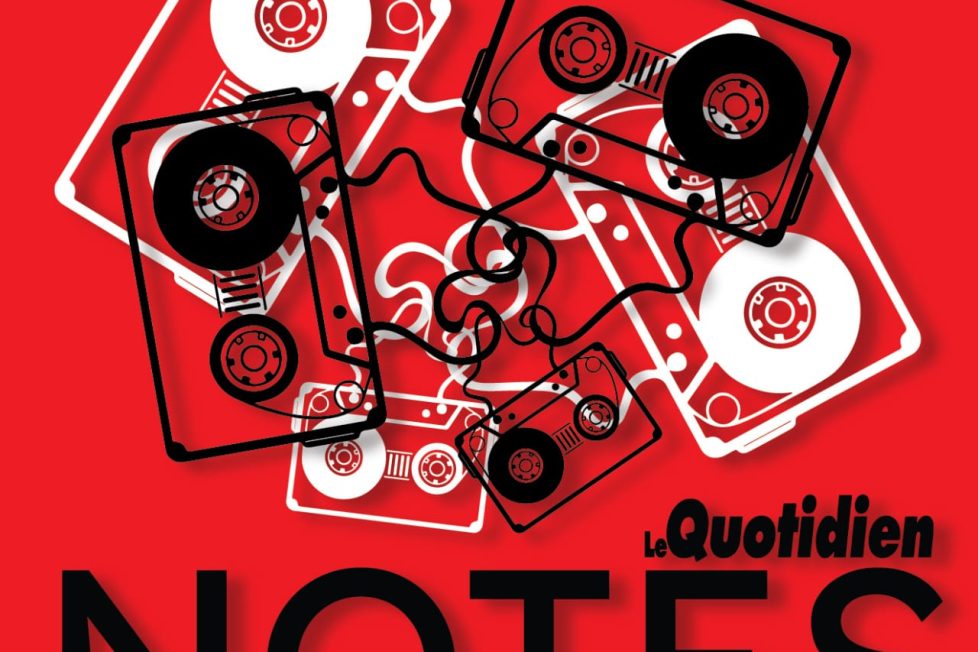
L’économie mondiale est suspendue aux possibles conséquences de la guerre commerciale que le Président des Etats-Unis, Donald Trump, a entamée contre le reste du monde, particulièrement contre sa plus puissante rivale, la Chine de Xi Jinping. La Chine, frappée par les taux les plus élevés jamais subis sur ses produits d’exportation, tente désespérément de trouver la parade avant que son économie, qui repose pour l’essentiel sur ses exportations à l’extérieur, ne s’effondre à plus ou moins long terme. En plus d’élever aussi des taxes sur des produits américains, les Chinois tentent de diversifier autant que possible leurs marchés.
L’«usine du monde» s’est sophistiquée
La difficulté de leur position réside dans ce qui a pendant longtemps constitué leur force dans un cadre mondialisé. La Chine, depuis son entrée dans l’Organisation mondiale du commerce (Omc), a cru malin de se transformer en «usine du monde». Les dirigeants de l’Empire du Milieu ont commencé par attirer les entreprises occidentales avec le bas coût de leur main-d’œuvre et la disponibilité quasi illimitée de leurs matières premières. Les seules conditions posées aux investisseurs étaient de s’établir dans des régions déshéritées, transformées à l’occasion en zones franches économiques. L’autre condition importante a été d’imposer aux Occidentaux un transfert de technologie.
Lire la chronique – Presse, gagner l’amère des batailles
Ces conditions ont permis aux Chinois de développer, en moins de deux décennies, une industrie de transformation des plus sophistiquées, qui a permis à «l’usine du monde» de ne plus se contenter de reproduire des marques conçues à l’étranger, mais d’imposer progressivement sa créativité propre. Elle a atteint un haut niveau de sophistication de son économie. A l’heure actuelle, le pays de Xi Jinping se place même à la pointe du progrès en matière de recherche-développement. Il suffit, pour s’en convaincre, de voir comment les dirigeants américains et européens ont tout mis en œuvre pour bloquer le développement de Huawei dans la téléphonie et celui de la 5G, ainsi que les mésaventures de l’application TikTok, qui ne finit pas de tailler des croupières aux fameux Gafam avec leurs Facebook, Twitter (ou X), WhatsApp et autres Instagram… Même dans la course à l’espace, les ingénieurs chinois ne cessent d’inquiéter leurs concurrents occidentaux. On pourrait même résumer que la guerre commerciale entamée par le Président Trump est l’expression de la peur du «Nouveau péril jaune» qui monte de plus en plus aux Etats-Unis et en Europe.
Dans les années 1960-70, c’était le Japon qui a suscité et alimenté cette peur. Mais très vite, les Occidentaux se sont rendu compte qu’il n’y avait pas de raison de se méfier de l’Empire du Soleil Levant, qui était juste une excroissance de l’Occident. La Chine elle, dont l’histoire millénaire est nourrie de batailles amères menées contre elle par des puissances occidentales, semble avoir intégré que sa puissance ne peut se pérenniser qu’avec une faiblesse durable de l’Occident. Et Donald Trump et ses collaborateurs semblent s’être donné pour mission d’empêcher que cela n’arrive de leur vivant. Et la guerre des tarifs aujourd’hui n’est qu’une première étape de ce conflit.
[themoneytizer id= »124208-19″]
La question pour les Africains, et en particulier les Sénégalais, est de voir comment tirer leur épingle de ce jeu mortel des grandes puissances.
L’Afrique a déjà perdu la guerre sans combattre
Dans leur conflit actuel, les Etats-Unis ont décidé d’agir comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. L’Administration Trump n’hésite pas à frapper ses alliés pour tenter d’affaiblir ses adversaires. Même les Européens tremblent devant les décisions protectionnistes du gouvernement américain, qui ont pour certaines conséquences d’affaiblir des partenaires parmi les plus fiables. Si ces alliés estiment que ces décisions «erratiques» du chef de la première puissance occidentale aboutissent à les affaiblir tous, le théoricien du «Make America great again» ne voit que son objectif et se préoccupe peu des moyens d’y parvenir.
Lire la chronique – Comme lettre à La Poste
Le plan de riposte commerciale chinois a commencé en mettant en avant la valorisation de sa propre production auprès des consommateurs locaux. Ainsi, la jet set chinoise, accro, comme le reste du monde, aux produits «made in Usa», même quand ils ont été fabriqués dans les arrière-cours de Shenzhen ou de Wuhan, est incitée à consommer autant que possible le «made in China». Ce qui ne se limite pas qu’aux produits de la mode, mais aussi et surtout aux produits alimentaires.
Ainsi, tous les produits qui ont fait le fort de la balance commerciale chinoise se retrouvent de plus en plus dans l’assiette des Chinois. Le poisson, les fruits de mer ou les fruits, naturels ou transformés, dont raffolent beaucoup de par le monde, n’auront plus besoin de franchir les frontières de la Chine pour faire le bonheur des consommateurs.
Lire la chronique – Mabouba à hue, Serigne Guèye à dia
Le ministère américain de l’Agriculture a évalué à 20 milliards de dollars américains la consommation chinoise de poisson et de produits halieutiques transformés. Et une bonne partie de ces produits provenaient de l’étranger. Les Etats-Unis, à eux seuls, ont exporté près de 2 milliards de dollars de fruits de mer et autres mollusques et crustacés, comme les crevettes, les homards. Pré-conditionnés et faciles à préparer, ces produits sont particulièrement prisés par une clientèle qui a, depuis plusieurs années, adopté le mode de vie à l’occidental, ainsi que ses habitudes alimentaires. La guerre commerciale qui oppose les deux pays ne va pas la contraindre à changer ses habitudes alimentaires, tout au plus à réduire certaines dépenses. Et c’est là que l’on voit que les Africains ont raté le coche.
Bien qu’ayant les côtes parmi les plus poissonneuses du monde, ainsi que d’autres atouts sur le plan agricole, nos pays ne vont pas être en mesure de suppléer l’une ou l’autre puissance économique du monde dans leur guerre sans merci.
[themoneytizer id= »124208-2″]
Le Sénégal, par exemple, a laissé péricliter ses infrastructures halieutiques et n’est plus en mesure d’attraper, même dans ses propres eaux, suffisamment de poissons ou des produits de la mer pour les transformer sur place avant leur exportation. Les nombreuses poissonneries qui se sont implantées dans le pays, dont certaines depuis plusieurs décennies, ont mis la clé sous le paillasson ou se sont converties en usines de fabrication de farine de poisson pour nourrir les unités aquacoles de l’étranger. Et même ces usines n’appartiennent pas au capital sénégalais. C’est dire que le fait d’avoir «expulsé» la flottille européenne de nos eaux n’a pas encore vraiment modifié la donne. Et ce qui se passe dans les eaux n’est pas différent de ce que vivent les paysans.
Transformés à l’étranger, consommés en Afrique
Les autorités politiques se sont rendu vite compte qu’il était illusoire de penser changer la vie et les conditions de travail des producteurs agricoles en un claquement de doigts. Les gens qui nous ont promis une production de riz et d’arachide record n’ont même pas pu couvrir les demandes de certaines huileries locales. Et quand une partie de la production nationale d’arachide n’a pu trouver preneur, on a été supplier les exportateurs chinois de nous la prendre telle quelle, pour éviter de la voir pourrir dans les champs des paysans.
Lire la chronique – Le temps d’un tourisme réellement endogène
Tout cela, parce que, depuis bien longtemps, le pays s’était spécialisé à l’exportation de son huile, aux conditions fixées par les négociants français, qui se sont évertués, des années durant, à dévaloriser notre produit pour l’acquérir à bas prix. Aucun décideur sénégalais n’a jamais songé, à ce jour, à installer sur place une unité de transformation de nos produits agricoles. Notre classe moyenne est toute fière de payer au prix fort l’huile d’arachide venant de l’étranger, en ignorant qu’elle a été transformée à partir de la récolte made in Sénégal. On peut dire la même chose du beurre d’acajou, ou même de caramels tirés de ce produit et importés avec un package bien accrocheur. C’est le cas du cacao consommé à Abidjan ou du café bu à Accra…
Combien sont les produits venant du Sénégal -ou même d’autres pays africains- que l’on aurait pu reconditionner sur le continent et les vendre à l’étranger à meilleur prix ? C’est autant d’argent perdu, autant d’occasions ratées dans la guerre commerciale dans laquelle le monde est entré, et dont nous partons déjà vaincus.
Par Mohamed GUEYE – mgueye@lequotidien.sn

