László Krasznahorkai et le spectre du boit-sans-soif qui lit
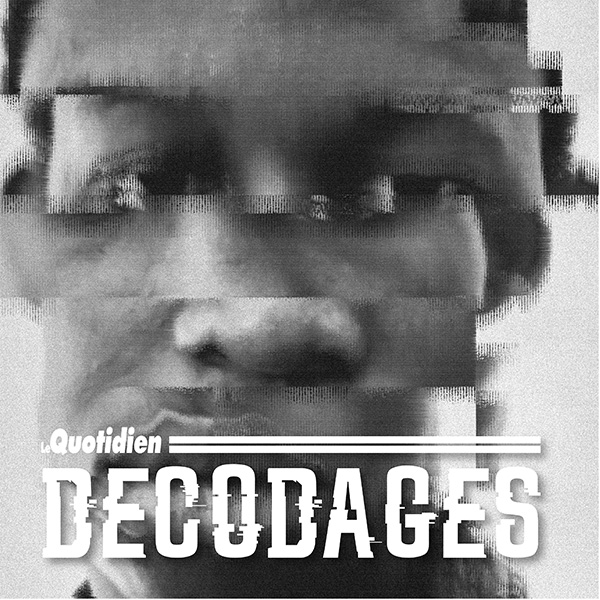
Le romancier hongrois László Krasznahorkai est le lauréat du prix Nobel de littérature 2025 -la distinction ultime pour un écrivain. Selon plusieurs bookmakers, cités par le journal français Libération, il faisait partie des grands favoris, avec l’écrivain japonais Haruki Murakami, l’éternel «presque». Le romancier et cinéaste, âgé de 71 ans, est présenté comme un «maître de la dystopie», cet art d’imaginer un futur sombre et apocalyptique, construit au moyen de l’actualité chaotique du présent, pour avertir les hommes des dangers qui les guettent. L’Académie Nobel de Stockholm a salué une «œuvre convaincante et visionnaire qui, au milieu d’une terreur apocalyptique, réaffirme le pouvoir de l’art».
De cet écrivain que je n’ai jamais rencontré, je garde un souvenir de la mort. Ce que j’appelle «rencontrer», c’est la lecture ; lire quelqu’un, c’est le rencontrer, l’accueillir chez soi dans le silence et la solitude, dialoguer avec lui selon le mot de René Descartes, lui donner les clés pour qu’il entrebâille les portes de son intimité ; c’est aussi l’écouter (l’écoute est une forme d’hospitalité, de respect, de savoir-vivre), l’accepter ou non. Un souvenir de la mort, ai-je dit. Car l’évocation de l’œuvre de cet écrivain, qui m’est tout-à-fait étrangère pour le moment, me rappelle un oncle décédé. Sa vie est un roman. Une tragédie. Et la littérature, m’a-t-il confié un jour, lui permettait de vivre, de sauver sa peau, de s’éloigner de la folie, fût-ce pour se donner bonne figure, pour feindre un bonheur imaginaire. Ses mains fiévreuses et maculées de goudron tenaient toujours un livre. Celui-ci était son ultime repaire, dans un monde qui avait fini par l’anéantir, par le dégoûter. Ses yeux globuleux témoignaient d’un homme qui a beaucoup lu.
L’on raconte, dans ma famille, que Ousmane avait une belle vie. Une vie réussie, selon la manière dont notre société conçoit la réussite sociale : une maison, une femme, une voiture et, probablement, des enfants ; la richesse matérielle, en un mot. Il avait tout cela. Après de brillantes études de commerce, à Paris, il décida de rentrer au pays. Son retour fut triomphal, et sa carrière professionnelle une ribambelle de succès. Dans sa maison, racontent certaines sources familiales, Ousmane avait des montagnes de livres : des romans, des pièces de théâtre, de la poésie, des nouvelles, des essais, etc. Sa culture fascinante lui permettait de tenir une conversation des heures durant. Les gens le tenaient souvent sur le tapis. Mais, au début des années 1990, sa vie bascula. Sa femme, mère de deux enfants, mourut brutalement en couches. De cette épreuve inextricable, Ousmane, en dépit de toutes ses grandes lectures et de sa vaste culture, ne se remit jamais ; il était totalement anéanti. Même ses enfants n’avaient pas réussi à lui donner une bonne raison de s’accrocher à la vie. Il décida contre toute raison, pour se consoler, de devenir un boit-sans-soif qui lit. Un corps sans âme.
Après avoir perdu femme et enfants, et que sa vie citadine devint invivable, ses proches décidèrent de l’amener au village pour que la vie rustique lui redonnât une nouvelle envie (ou raison) de vivre. En réalité, et je l’ai compris sur le tard, cette manœuvre visait tout simplement à congédier un dandy devenu un indésirable. En 2005, si mes notes sont bonnes, il posa ses balluchons dans notre bourgade. J’ai grandi en le regardant se débarrasser difficilement de son quant-à-soi et des oripeaux de sa vie d’antan. Après plusieurs années interminables d’adaptation et d’efforts, il avait réussi à se fondre dans l’environnement bucolique, où les chants des coqs rythment le matin et les travaux champêtres la journée. Sa passion pour la lecture ne l’a jamais quitté néanmoins, dans un milieu où celles et ceux qui lisent sont regardés avec fascination et, parfois, avec dédain. En quittant Dakar et le spectre de ses désillusions, il avait emporté, dans sa minuscule valise, ses amis de toujours dont László Krasznahorkai. Et le souvenir de ses enfants perdus, d’une bonne partie de sa famille qui l’a allègrement abandonné.
Chaque soir, à cette heure où les bougies guidaient nos pas et nos cœurs –c’était bien avant la grande découverte de l’électricité, grâce aux politiques sociales du Président Macky Sall-, il prenait congé de nous, pour aller lire ses livres entassés dans son baluchon rougeâtre, sous une lampe à pétrole vieille de plusieurs générations. Il m’arrivait parfois de le suivre, par simple curiosité, pour voir ce qu’il faisait. Il lisait toujours, et la lecture était, pour moi, une activité extraordinaire. Fasciné et les yeux écarquillés, je ne le quittai jamais avant qu’il ne finît de lire jusque tard dans la nuit. Un jour, toujours par simple curiosité, j’avais pris entre mes menottes un de ses livres. Sur sa couverture bariolée, je pouvais ânonner, au bout de quelques minutes, un nom effarouchant, qui m’était totalement étranger : László Krasznahorkai. Lorsqu’il m’aperçut jouer avec le livre, sa voix enrouée bafouilla des mots que je me permets de traduire en ces termes : «C’est un grand écrivain, l’auteur de ce livre ; c’est mon écrivain préféré. J’ai lu plusieurs de ses livres.» J’ai découvert plus tard que sa petite bibliothèque, qui constituait l’unique vestige de sa vie citadine, ne contenait que des livres de Krasznahorkai. On comprendra si je regrette, le cœur lourd, de ne pas avoir préservé ces livres des barbares. Pour les lire, pour que nous puissions, éventuellement, partager les mêmes émotions…
Mon oncle est mort quand j’ai commencé à lire. Dans sa vie rurale, son rapport avec l’alcool restera toujours une énigme. Mais, dans un milieu où même la mention de cette addiction est un sacrilège, on peut supposer qu’il était devenu sobre malgré lui. Durant tout son séjour au village, en tout cas, l’ancien banquier était un valétudinaire et un lecteur assidu de László Krasznahorkai. Les miaulements, aboiements et coassements ne l’empêchaient pas de lire au quotidien, et profondément, son marchand de rêves. Il lisait toujours les mêmes livres à l’infini, le village n’ayant pas de librairie, loin s’en faut. Si Ousmane était toujours dans ce monde, il serait heureux de voir l’écrivain hongrois, qui l’a tenu par la main dans le labyrinthe de la vie plusieurs années durant, décrocher la récompense suprême. C’est cela aussi la promesse de la littérature : tisser des liens.
Par Baba DIENG

1 Comment

Belle plume !