L’automne du père de la désenghorisation
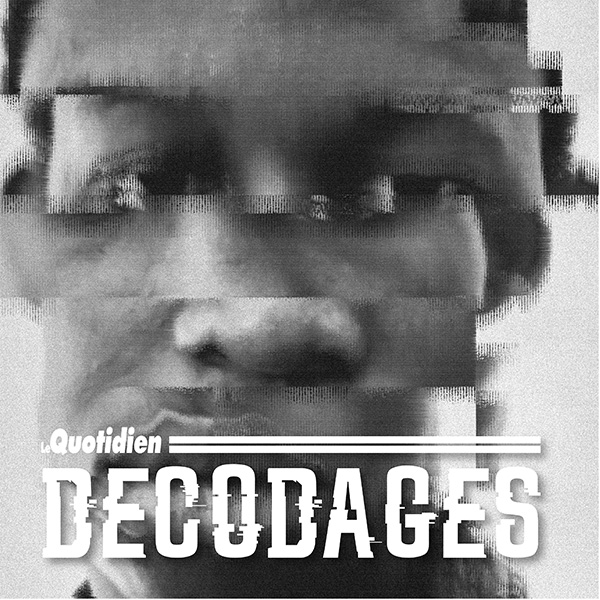
Le Président Abdou Diouf avec qui je n’ai pas tellement d’atomes crochus, fête ses 90 ans, ce 7 septembre. Il reste tout de même une figure politique incontournable -je ne dirais pas passionnante, pour des raisons objectives- de l’histoire politique contemporaine de notre pays. Premier ministre incapable de lorgner le fauteuil présidentiel de son chef pendant 10 ans, et président de la République 2 décennies durant, notre Etat chemine avec son effluve.
Lire la chronique – Restituer le patrimoine africain
Dauphin constitutionnel du poète-Président, il lui succède, après que le plus illustre des Sénégalais, en décembre 1980, a pris la décision inédite de quitter le pouvoir de son propre chef. Il va sans dire que son pedigree n’est pas à la mesure des prédispositions intellectuelles et politiques de son mentor, intellectuel absolu et archétype du savoir-vivre. C’est un produit de l’Administration, obséquieux jusqu’à la révérence envers son maître, qui n’a aucune influence dans les instances du Parti socialiste (Ps) au moment d’être catapulté à la magistrature suprême au détriment des «barons», lesquels pouvaient le bouffer comme un trait d’arbalète, n’eussent été les manœuvres et la protection de Jean Collin – le «bandit», écrit-il, dans ses Mémoires (Seuil, 2014), pour lui rendre un hommage bien mérité. En dépit de son illégitimité dans le gotha socialiste, Diouf, madré, n’est pas un benêt qui prend des décisions politiques à la godille. Il n’est pas un politicien, au sens classique du terme ; il lui emprunte cependant certains de ses défauts : le calcul froid et le cynisme, avec une patience sans limite. Diouf savait aussi user au besoin de ce vieux droit de «tuer» qu’est la souveraineté (Michel Foucault).
Lire la chronique – Du souverainisme au kémalisme
Le Sénégal sous Abdou Diouf a été aussi marqué par l’approfondissement de la démocratie, avec, entre autres reformes fécondes, l’essor de la presse privée (1) et l’adoption du multipartisme intégral, continuant ainsi le processus institué, en 1974, par le Président Senghor. Il faut dire aussi que les demandes -celles des partis d’opposition, des syndicats, des étudiants, des groupes politiques agissant dans la clandestinité et de nos partenaires extérieurs, etc.- ont été décisives pour retrouver le bouillonnement politique et médiatique de la société coloniale. Retrouver, ai-je dit, car, dès la fin du XIXe siècle, ce pays -grâce à l’adoption, en France, de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, appliquée dans les Quatre Communes à travers l’article 69-, a vu naître des médias souvent éphémères et assez virulents envers l’Administration coloniale : Le Réveil Sénégalais puis Le Petit Sénégalais, à partir de 1885 ; L’Afrique occidentale, journal créé, en 1890, par Louis Huchard, un mulâtre de Gorée ; La Démocratie au Sénégal, journal sensible aux combats politiques de Blaise Diagne, fondé, en 1912, par Jean-Baptiste Alexandre Daramy dit Oxoby ; les journaux L’AOF (qui sera acheté plus tard par Lamine Guèye pour le mettre à la disposition de Galandou Diouf), L’Intransigeant et La Tribune menèrent un combat au profit de François Carpot, grand rival de Blaise Diagne aux Législatives de 1919.
Lire la chronique – Condamnation
Sur le plan économique, le «Président de l’article 35» a «passé tout son temps à faire des ajustements structurels». A la fin de son règne, il avoue avoir «gouverné dans la lecture». Les Programmes d’ajustement structurel (Pas), imposés par les institutions de Bretton Woods, ont surtout conduit notre pays à sacrifier son école (la fameuse Ecole nouvelle), à liquider son tissu industriel assez consistant hérité de la colonisation (2), à brader des avoirs nationaux… Qui plus est, ces programmes ont empêché l’Administration centrale, très affaiblie par la perte de ses agents les plus qualifiés en raison de la réduction drastique de l’effectif de la Fonction publique, surtout du fait des «départs volontaires», d’avoir une vision prospective. Conséquence assez terrible, car, à la différence de l’économie de subsistance dont parlent les anthropologues, les économies modernes, caractérisées par le souci de la productivité et de la compétitivité, reposent sur la prospective.
[themoneytizer id= »124208-2″]
La mauvaise ambiance économique, qui a rompu le train-train clientéliste, a participé au déracinement du baobab socialiste (3). En effet, Diouf et ses collaborateurs ont vite compris que le principal risque de ces injonctions des bailleurs de fonds était de les priver de l’usage des ressources nécessaires au clientélisme politique, lequel fut à la base du modèle senghorien. Donal Brian Cruise O’Brien l’appelle le «contrat social sénégalais» (4), c’est-à-dire l’ensemble des équilibres et canaux intermédiaires entre les différentes élites -politiques et religieuses, notamment les confréries soufies-, qui permettent de garantir une contexture sociale aux dépens, généralement, des performances économiques. Ce contrat clientéliste -qui est une fabrique de la colonisation, élaborée, précisément, par l’administrateur et érudit Paul Marty- a vécu ses plus beaux jours dans les années 1970, avant d’être remis en cause à partir des années 1990 en raison de l’émergence d’une conscience citoyenne et politique favorisée en grande partie par les médias privés.
Lire la chronique – Le Dérèglement du monde
Le Président Diouf est aussi le père de la désenghorisation. De l’antisenghorisme qui est hélas devenu un sport national, pratiqué par les «ploucs maniérés à la préciosité surfaite» dont parle Ibou Fall. Dès son accession au pouvoir, Diouf a pris le plaisir de démolir toute l’œuvre -surtout culturelle- de son prédécesseur. Même s’il prétend le contraire, dans ses Mémoires, en écrivant, non sans fallace, qu’«il n’y avait au Sénégal ni désenghorisation ni dioufisation, qu’il n’y avait que la construction du pays». Toujours est-il qu’on a bricolé le «sursaut national» pour enterrer définitivement le galimatias de la Négritude ; l’Ecole des arts a été profanée ; on a transformé le Musée Dynamique à Dakar en Cour de cassation ; les artistes, figures de proue de la politique culturelle de l’académicien, ont été clochardisés et exclus du projet national.
[themoneytizer id= »124208-19″]
On retiendra peut-être du Président Abdou Diouf son choix -ou les choix qui lui ont été imposés- de bifurquer la trajectoire du Sénégal senghorien vers l’aventure de l’austérité et de la sécheresse culturelle. Mais la fondation des pilastres assez solides de notre bel Etat est l’œuvre de femmes et d’hommes dont le patriotisme ne peut pas être remis en cause. Pour cette raison, nous leur devons respect et reconnaissance, en dépit de toutes les déconfitures et tragédies qui ont émaillé leurs actions politiques.
Par Baba DIENG
NOTES
(1)La thèse de doctorat en sciences de l’information et de la communication de Moustapha Sow, soutenue le 19 novembre 2016 à l’Université de Lorraine, Médias et pouvoirs politiques au Sénégal : étude de la transition d’une presse d’Etat vers un pluralisme médiatique, détaille avec justesse l’archéologie de cette avancée démocratique majeure. Celle-ci s’est concrétisée, avec la naissance, au cours des années 1980 et 1990, de groupes de presse assez indépendants tels que Sud Communication, Wal Fadjri ou 7 Com.
(2)Voir, à ce propos, le livre de l’économiste Moustapha Kassé : L’économie du Sénégal : Les 5 défis d’un demi-siècle de croissance atone, L’Harmattan, coll. «zoom sur», 2015.
(3)Voir Aminata Diaw, Momar-Coumba Diop, Mamadou Diouf, «Le baobab a été déraciné : L’alternance au Sénégal», Politique africaine, n°78, juin 2000.
(4) «Le contrat social sénégalais à l’épreuve», Politique africaine, n° 45, mars 1992.

