Le mensonge du mariage heureux
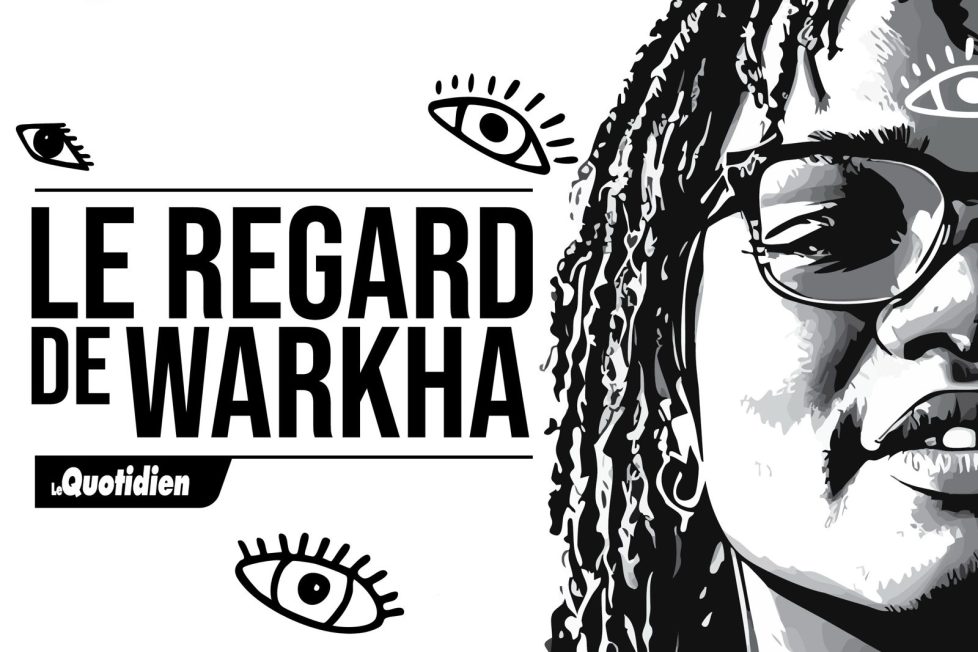
Le Sénégal s’est réveillé, une fois de plus, devant un drame qui glace le sang : celui de Nogaye Thiam, 23 ans, retrouvée morte après des heures dans la chambre qu’elle occupait avec son bébé, un enfant qu’elle allaitait encore, au cœur de la maison familiale où elle vivait avec sa belle-famille.
Très vite après l’annonce, les thèses se sont multipliées : disputes familiales, tensions conjugales, isolement volontaire, malaises répétés, et même cette expression malheureuse d’«attitude de casanière» lancée pour minimiser l’inadmissible. Les récits se contredisent, se déforment, circulent avec une facilité effrayante. Mais dans toutes les versions, un point demeure, brut, implacable : Nogaye était isolée. Mise à l’écart. Invisible dans son propre foyer.
Cet isolement explique la découverte tardive de son décès, mais il dit surtout quelque chose de plus profond : dans nos sociétés, l’isolement des femmes mariées est un mécanisme social, une punition silencieuse devenue si banale qu’elle passe pour normale.
Je ne m’attarderai pas ici sur les détails précis de ce cas, par respect pour la vérité, par prudence, et surtout parce que je refuse de réduire ce drame à une histoire individuelle. Ce qui est arrivé à Nogaye n’est pas une exception : c’est l’expression extrême d’un système qui frappe les femmes précisément parce qu’elles sont des femmes dans une société patriarcale.
Ce n’est pas un accident ; c’est un symptôme. Et c’est précisément ce qui explique l’avalanche de témoignages apparus sur les réseaux sociaux depuis l’annonce du drame : des femmes qui racontent leur propre enfer domestique, leurs nuits sans sommeil, leurs journées de labeur, leur solitude au milieu d’une maison pleine. Elles disent qu’elles restent parce qu’elles n’ont pas le choix : absence de revenus, dépendance financière, absence de soutien, peur de perdre la garde de leurs enfants, chantage affectif, menace sociale du statut de «femme divorcée».
Elles restent parce que partir signifie perdre leur dignité aux yeux d’une société qui continue de juger les femmes à l’aune de leur capacité à tout supporter.
Et pourtant, au-delà du bruit des témoignages, il y a ce silence entre les lignes, celui des femmes qui n’osent pas parler, celui des nuits où l’on ravale ses larmes pour que personne n’entende, celui de toutes celles qui survivent en attendant que quelque chose change. Ce silence-là en dit plus sur notre société que mille discours.
Ce système repose sur une structure familiale profondément inégalitaire, un modèle hiérarchisé où chacun connaît sa place sauf l’épouse, assignée partout et nulle part. Qu’elle soit première, deuxième ou quatrième épouse, épouse de l’aîné ou du cadet, la hiérarchie masculine demeure la même, et les femmes, malgré leurs différences, partagent la même servitude : être les travailleuses invisibles de la maison familiale.
Et parce que rien n’arrive par hasard, il faut regarder le système en face, dans sa froide architecture : celui qui façonne les comportements, qui distribue les rôles, qui fabrique l’endurance féminine comme une vertu et la souffrance comme une obligation.
Dans cette pyramide du pouvoir, l’homme trône au sommet, sa famille juste en dessous, et l’épouse ferme la marche. Elle doit nourrir, veiller, anticiper, s’épuiser. Sa disponibilité doit être totale, son dévouement illimité. On attend tout d’elle, sauf qu’elle existe pour elle-même. Et si, un jour, elle décide de dire non à ces attentes, elle devient aussitôt la «sorcière», la «maudite fille», la femme ingrate qu’on condamne sans procès. Pourtant, aucune des personnes qui la jugent ne se propose jamais de porter les charges qu’elle refuse enfin de porter seule.
Dans ces conditions, comment pourrait-elle se réaliser ou même simplement rêver ? Le travail domestique invisible, incessant, épuisant repose entièrement sur ses épaules. Elle devient le pilier affectif, l’infirmière en chef, la cuisinière, la psychologue, la médiatrice, la femme à tout faire.
De nombreux hommes, aujourd’hui, n’épousent pas seulement une compagne : ils cherchent une aide-soignante familiale, une assistante domestique intégrée, une belle‑fille opérationnelle. C’est là que réside l’une des violences les plus invisibles du mariage patriarcal : la charge émotionnelle. Celle d’anticiper tout, de gérer les tensions, d’absorber les colères, de panser les blessures des autres, sans jamais avoir le droit d’exprimer les siennes.
La femme devient le thermostat affectif de la famille : si elle flanche, tout s’écroule ; si elle tient, personne ne s’en rend compte. Ce modèle transforme les femmes en ressources : reproductives, affectives, ménagères. Jamais en sujets porteurs d’ambitions, de désirs ou simplement de limites humaines.
Le mariage tel qu’il se pratique aujourd’hui, n’a rien du conte de fées qu’on nous vend depuis l’enfance. Il n’est pas cette promesse de bonheur, de sécurité ou d’élévation. Il est, dans les faits, une institution où l’inégalité est programmée, ritualisée, normalisée.
Derrière le romantisme mis en scène, se cache une mécanique sociale qui profite largement aux hommes, souvent au détriment des femmes. La jeune épouse quitte son environnement pour entrer dans un foyer où elle n’a ni pouvoir ni voix. Son travail domestique est perçu comme naturel, donc non rémunéré, non reconnu, non valorisé. Sa souffrance est minimisée. Ses besoins passent après ceux des autres. Son isolement est présenté comme une vertu : «douce», «calme», «discrète».
Dans ce modèle patriarcal, la femme n’existe que par ce qu’elle produit, porte, supporte. Jamais par ce qu’elle désire. Jamais par ce qu’elle rêve.
Voilà pourquoi le mariage, tel qu’il est vécu ici, ressemble moins à une promesse qu’à une arnaque sociale emballée dans les rubans de la tradition.
On promet aux femmes la stabilité. On leur livre l’épuisement. On leur promet le respect. On leur sert la vulnérabilité. On leur promet une famille. On leur retire souvent leur réseau social. On leur promet une place. On les enferme dans un rôle.
Le mariage n’est pas seulement un engagement affectif : c’est un système de répartition du pouvoir où le corps, le temps, l’énergie et même l’imaginaire des femmes sont mobilisés pour servir les autres.
Tant que nous valoriserons un modèle conjugal qui exige tout des femmes sans jamais les protéger réellement, ces violences structurelles continueront d’être rebaptisées «accidents» ou «tragédies individuelles».
Le patriarcat a cette particularité : il se dissimule derrière le quotidien, derrière les habitudes, derrière ce que l’on appelle «normal». C’est ce camouflage qui le rend si efficace, si durable, si meurtrier.
Et la vérité, aussi tranchante soit-elle, est la suivante : tant que le mariage sera pensé comme un lieu de service et de sacrifice, il ne pourra jamais être un lieu de sécurité pour les femmes.
Le mensonge du mariage heureux n’est pas une exagération : c’est la façade derrière laquelle se joue, depuis des générations, l’épuisement silencieux de millions de femmes. Et tant que nous refuserons de le questionner, les femmes resteront exposées, isolées, fragilisées par une institution qui prétend les protéger, mais les abandonne.
Par Fatou Warkha SAMBE

