Le pouvoir du hashtag : quand Discord et TikTok façonnent le destin politique du continent
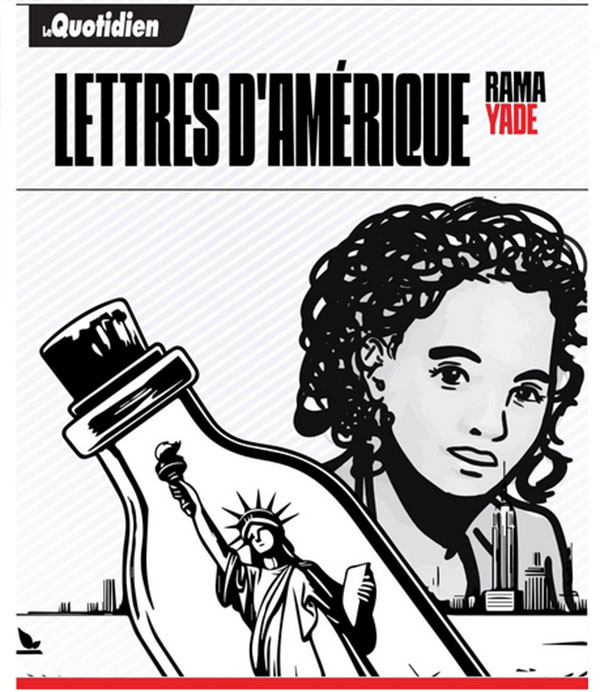
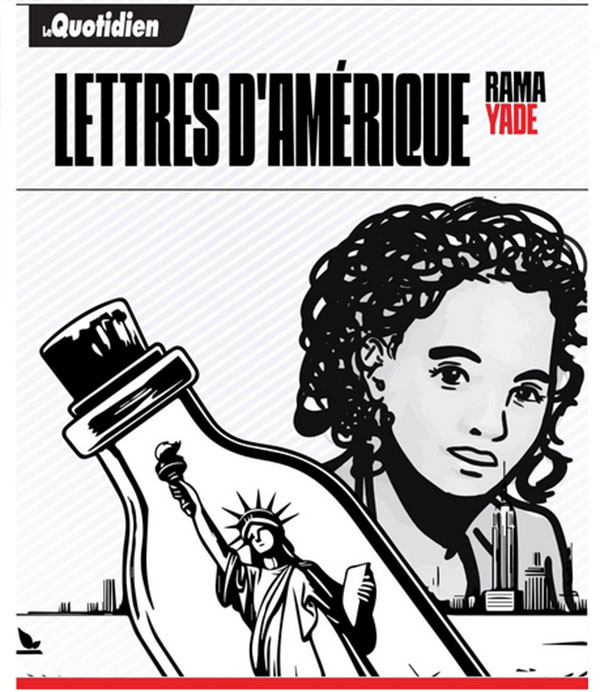
L’Afrique subsaharienne vit une révolution silencieuse, mais profonde. Derrière les débats dans les salons diplomatiques sur la gouvernance et le développement, se dessine une dynamique nouvelle : celle d’une jeunesse connectée, qui utilise les réseaux sociaux non seulement pour s’exprimer, se mobiliser et même renvoyer des présidents. Facebook, X (anciennement Twitter), WhatsApp, TikTok, Telegram et Discord sont autant d’espaces où l’opinion publique se forge, où se créent des communautés et où s’organisent les mobilisations citoyennes.
Cette génération numérique n’attend plus passivement que les choses changent. Elle agit, souvent avec créativité et audace, pour faire entendre sa voix et obtenir des résultats concrets. Les mouvements des dix dernières années montrent que les hashtags et les vidéos peuvent se transformer en manifestations de rue, en campagnes de sensibilisation et parfois même en changements politiques significatifs. La jeunesse malgache vient ainsi avec éclat de chasser du pays son Président, Andry Rajoelina, comme hier la jeunesse tunisienne, aux balbutiements de Facebook, avait fait partir le vieux Zine el-Abidine Ben Ali.
Des mouvements qui ont marqué la dernière décennie
Au Nigeria, le mouvement #EndSARS reste emblématique. Lancé en 2017 contre les violences de la police spéciale Sars, il a rapidement pris de l’ampleur grâce aux réseaux sociaux. Les jeunes ont utilisé X, Instagram et WhatsApp pour organiser des rassemblements dans tout le pays, partager des témoignages en temps réel et attirer l’attention internationale sur la brutalité policière. La pression populaire a conduit le gouvernement à dissoudre l’unité controversée et à promettre des réformes, illustrant le pouvoir de mobilisation que peuvent avoir les communautés numériques.
Au Kenya, les campagnes #RejectFinanceBill et #OccupyParliament ont mobilisé des millions de jeunes contre de nouvelles taxes et certaines priorités budgétaires. Les mobilisations ont commencé en ligne, puis se sont étendues dans les rues de Nairobi et d’autres grandes villes. Ces mouvements ont montré que les réseaux sociaux ne sont pas seulement des plateformes de débat, mais de véritables instruments d’organisation et de coordination.
En Ouganda, le hashtag #KampalaPotholeExhibition a transformé une plainte locale sur les infrastructures en un débat national sur la gestion publique. Les jeunes ont utilisé la satire et l’humour pour dénoncer l’inefficacité des services municipaux, contraignant les autorités à réagir publiquement et à engager des réformes ponctuelles. De manière similaire, au Zimbabwe, le mouvement #ThisFlag a mobilisé les citoyens contre la mauvaise gestion économique et la corruption, donnant naissance à des rassemblements pacifiques largement organisés via Facebook et WhatsApp.
D’autres exemples récents incluent Madagascar, où des protestations contre les coupures d’électricité et l’inégalité sociale, en 2023, ont été largement organisées sur TikTok, Telegram et X, et ont exercé une pression politique réelle sur les autorités locales. En Algérie et au Soudan, les jeunes ont joué un rôle central dans les mouvements de contestation qui ont abouti à des changements politiques ou à des débats nationaux intenses. Même au Sénégal, le mouvement citoyen #Y’enMarre a utilisé les réseaux sociaux depuis 2011 pour dénoncer la corruption et mobiliser la jeunesse lors des élections présidentielles.
Ces exemples montrent une réalité claire : les réseaux sociaux ne servent plus seulement à diffuser des informations. Ils créent un pouvoir collectif, capable d’influencer la gouvernance, de construire des identités politiques et d’exercer une pression internationale sur les autorités.
Une diplomatie par le bas
L’activisme numérique ne transforme pas seulement la contestation. Il modifie profondément la manière dont la gouvernance fonctionne. Les jeunes citoyens peuvent contourner les médias traditionnels, créer des communautés de débat et imposer de nouvelles narrations sur la politique, la corruption ou la répartition des ressources.
Sur le plan international, ces mobilisations imposent une nouvelle forme de «diplomatie par le bas». Les diplomates et partenaires étrangers doivent désormais observer non seulement les institutions officielles, mais aussi la conversation numérique des jeunes pour comprendre la stabilité et la légitimité des gouvernements africains. Les images, vidéos et témoignages partagés sur les réseaux sociaux peuvent influencer l’opinion mondiale et orienter les décisions des organisations internationales.
Transformer l’essai jusqu’au Palais présidentiel
Mais ce nouveau pouvoir citoyen comporte des défis. Le fossé numérique laisse encore une partie de la population à l’écart. La répression numérique, par la surveillance ou les intimidations ciblées, demeure une réalité. Enfin, la désinformation et la polarisation peuvent fragiliser ces mouvements. Et surtout, lorsque la révolution arrive, que le président parte, ce ne sont jamais ces jeunes qui entrent au Palais pour gouverner le pays, mais souvent des militaires, comme c’est le cas du Mali et de Madagascar. Comme si, à force de refuser d’être représentés ou même d’avoir un leader, un visage, les mouvements de jeunesse se révélaient, au bout du compte, incapables de transformer l’essai. C’est bien la leçon de cette révolution politique digitale : la politique ne se décide pas sur un écran, elle doit, à un moment ou un autre, s’incarner pour durer.
Directrice Afrique
Atlantic Council

