Leçons d’Amérique
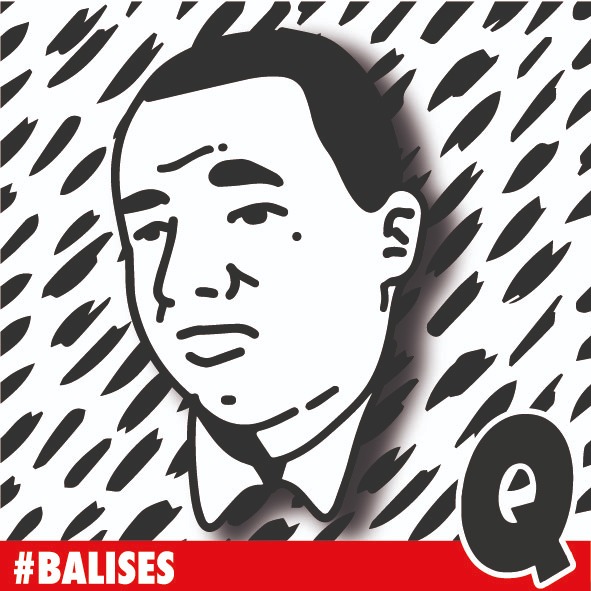
Chaque fois que j’arrive à New York, ma première pensée se tourne vers Héraclite, qui disait : «On ne se baigne jamais deux fois dans un même fleuve.» New York n’est jamais la même ville. A l’image du fleuve Hudson, New York n’est jamais le même. Et l’un des meilleurs endroits pour s’en rendre compte est de l’autre côté du fleuve, à West New York dans le New Jersey, quand on voit l’Empire state building en couleurs de la France, pour célébrer l’entrée de Joséphine Baker au Panthéon. New York se renouvelle tout le temps. Toujours en mouvement. Toujours en mutation.
C’est peut-être d’ailleurs ce qui explique la grande nostalgie qu’expriment les œuvres du grand peintre New Yorkais, Edward Hopper, qui a voulu figer une certaine idée de son New York, qui semblait lui échapper avec le changement permanent de la ville. Hopper figea, avec réalisme dans ses tableaux, la nostalgie d’une Amérique passée. C’est aussi tout le charme de New York, cette belle ville qui est comme la femme du poème de Verlaine, «qui n’est, chaque fois, ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre». C’est pourquoi les soupirants de New York, comme Woody Allen, sont si anxieux et angoissés.
C’est dans cette ville où la neige s’annonce timidement malgré un soleil intermittent, dans ce pays qui a élu et réélu quelqu’un qui s’appelle Barack Hussein Obama, dont le père n’est même pas Américain, que parviennent les échos des excès de Gaston Mbengue sur les Dias. Avec Obama, les Américains ont donné au monde une leçon d’ouverture. Si Obama était Français, tout le débat aurait porté sur son nom et ses origines, et surtout le fait que ses prénom et nom ne soient pas assimilables, ou tout simplement il serait présenté comme l’exception en matière d’intégration.
Ne parlons pas du Kenya, où on l’aurait renvoyé à l’ethnie de son père ou à son manque d’indigénéité, comme le fait Gaston Mbengue avec Dias, oubliant que la Nation est un commun de vouloir de vie commune, mais aussi «le partage d’un antique cimetière», comme dit Péguy. De ce côté-ci de l’Atlantique, on ne demande pas aux immigrés de s’intégrer ou s’assimiler. Au contraire, on leur demande de rester eux-mêmes, garder leurs cultures, qui sont considérées comme des diversités qui enrichissent l’Amérique car, dès qu’on est Américain, on n’a plus besoin de donner des preuves d’intégration ou d’assimilation. Le communautarisme, considéré comme une menace en France, est valorisé ici, où coexistent harmonieusement Chinatown, Little Senegal…, et des quartiers latinos.
Celui qui a eu l’idée d’appeler New York, Empire state, a eu une intuition géniale, parce que New York est un véritable empire qui, par définition, n’a pas de frontières. Toutes les nations sont dans les rues de New York, où on parle toutes les langues et l’on voit tellement de drapeaux dans les rues, pas seulement au siège des Nations unies. Etre Américain, c’est simplement avoir la nationalité et l’esprit américains. C’est cette ouverture qui est le grand avantage de l’Amérique dans la compétition mondiale et qui lui permet d’aspirer autant de talents, qui viennent du monde entier et deviennent plus Américains que les Natives, parce qu’on ne leur demande jamais de justifier leur américanité ou ne leur impose une querelle des allégeances entre leurs origines, leurs cultures d’origine, leur religion et l’Amérique, comme le fait la France de Zemmour et Le Pen.
Il y a deux semaines, j’étais en France, où sévit le débat passionnant sur le déclin et le grand remplacement, alors qu’aux Etats Unis, le débat porte sur comment faire encore de ce siècle, un autre siècle américain. La différence entre les deux pays se trouve entre leurs révolutions. Les Français ont fait une révolution pour l’égalité, alors que l’Amérique a fait sa révolution pour la liberté. Liberté d’entreprendre, surtout de prospérer. L’Amérique est le premier pays à avoir constitutionnalisé «la poursuite du bonheur», à côté du droit à la vie et à la liberté. Et la ville de New York est l’incarnation de cette idée de poursuite du bonheur. «Les deux régimes de la vie humaine, que sont la démocratie et l’aristocratie, sont comme deux humanités distinctes», disait Alexis de Tocqueville, qui était lui-même si «aristocrate par instinct et démocrate par raison».
New York est aussi à la fois si aristocratique et si démocratique, qu’on y vit en permanence le rêve américain de rejoindre un jour l’élite, à force de travail dans la poursuite du bonheur. Ce bonheur que, dans la plupart des pays, on attend de l’Etat providence ou socialiste, mais que les Américains, qui ont un Etat minimal, cherchent dans la vocation au travail, qui est le secret de la prospérité américaine car, pour Max Weber, «lorsque l’imaginaire d’un Peuple entier a été dirigé sur les grandeurs purement quantitatives comme aux Usa, le romantisme des chiffres exerce sa magie irrésistible sur ceux des hommes d’affaires qui sont aussi des poètes». Ces poètes de la démesure, comme Carnegie, Rockefeller, Vanderbilt, qui «ont fait l’Amérique», après que les pères fondateurs ont eu l’idée lumineuse de constitutionnaliser, non pas le bonheur, mais la «poursuite du bonheur». Et quand un pays se mobilise pour la prospérité ou l’émergence, il n’a pas de temps et d’énergie à perdre sur le débat sans fin sur les institutions, car la Grande Bretagne, le Japon et les Etats-Unis montrent, tous les jours, qu’on peut avoir des institutions archaïques qui remontent au Roi Jean sans terre pour la Grande Bretagne (1166-1216), à l’ère du Meiji pour le Japon (1868) et à la révolution américaine de 1776, et avoir une grande efficacité économique et industrielle.
Yoro DIA – yoro.dia@lequotidien.sn

