Les chiffres qui crient : les violences sous toutes leurs formes
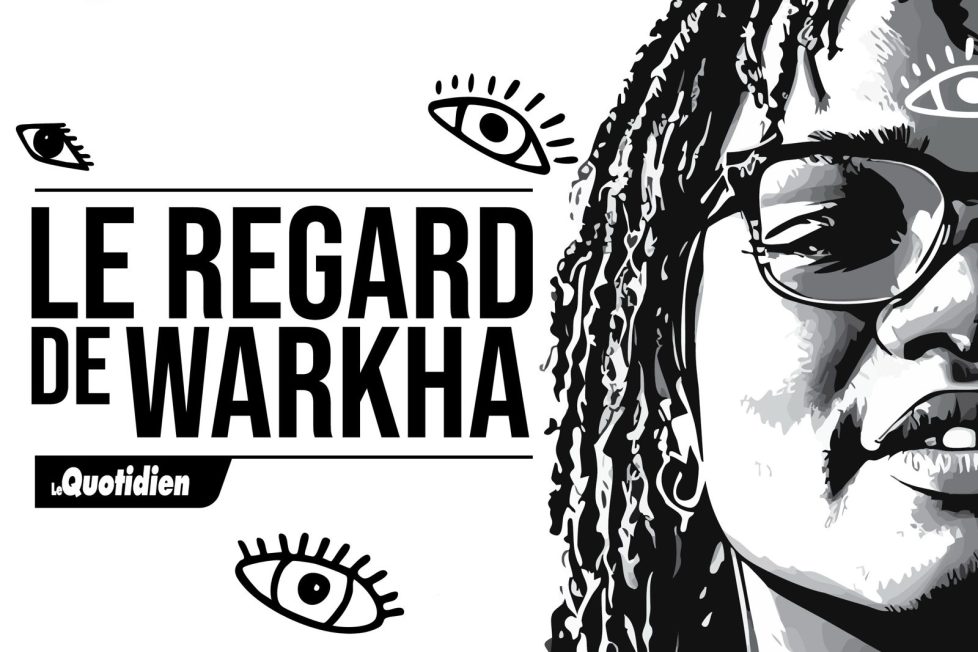
L’Enquête nationale de référence sur les violences faites aux femmes et aux filles (Enr-Vffs 2023-2024) est une initiative inédite menée au Sénégal pour comprendre, mesurer et dénoncer les violences subies par les femmes. Près de trois femmes sur dix ont subi au moins une forme de violence, qu’elle soit physique, psychologique, sexuelle ou économique, au cours des douze derniers mois ayant précédé l’enquête. Ce taux de prévalence de 31, 9% n’est pas un simple indicateur : il révèle une urgence sociale et politique. Il met en lumière la réalité brutale d’un pays où la violence s’immisce dans les foyers, les rues, les institutions. Ces chiffres ne sont pas abstraits : ils parlent du quotidien des femmes sénégalaises, de leurs corps surveillés, de leurs voix étouffées, de leurs droits bafoués. Ils rappellent que la violence n’est pas une exception, mais une norme que l’on a trop longtemps tolérée. Et pour celles et ceux qui s’y intéressent de près, féministes, militantes, travailleuses sociales, rien de surprenant : ce constat, nous le voyons, nous l’entendons, nous l’accompagnons chaque jour. Mais le fait qu’il soit aujourd’hui mesuré, documenté et reconnu, c’est déjà une brèche ouverte dans le mur du déni collectif.
Jusque-là, les enquêtes démographiques et de santé n’effleuraient qu’à peine le sujet, abordant les violences comme un simple indicateur parmi d’autres. Cette fois, l’Enr change de paradigme : elle adopte une approche globale, lucide, implacable, qui prend en compte les violences physiques, mais aussi les violences économiques, politiques et numériques, ces formes nouvelles et insidieuses par lesquelles le patriarcat se modernise sans se remettre en question.
Les violences économiques privent encore de nombreuses femmes de leurs droits fondamentaux : travailler, gérer leurs revenus ou participer aux décisions du foyer. Elles organisent la dépendance sous couvert de protection ou de tradition. En 2025, elles persistent : 29, 1% des femmes hors union ont subi au moins un acte de ce type, 25, 1% avant 18 ans, et 3, 7% au cours de la dernière année. Dans le cadre conjugal, près de deux femmes sur dix en sont victimes.
Les violences politiques rappellent que l’espace du pouvoir demeure excluant : 6, 5% des femmes ont été victimes de violences pendant les Législatives de 2022, qu’il s’agisse de pressions pour s’abstenir ou d’intimidations dans les bureaux de vote. En ville, elles sont 6, 8% contre 6, 1% en milieu rural. Même dans l’acte de voter, les femmes affrontent encore des barrières invisibles.
Les violences numériques représentent la version contemporaine du contrôle patriarcal. Harcèlement, diffusion d’images intimes, menaces : ces pratiques touchent surtout celles qui prennent la parole. Avant 18 ans, 20, 4% des femmes en ont subi, plus souvent en ville (23, 1%) qu’en zone rurale (16, 4%). Plus de 80% des femmes y ont déjà été confrontés, et 8, 1% durant l’année écoulée.
Ces violences ont mille formes. Trois femmes sur quatre ont été frappées avant 18 ans, souvent par ceux censés les protéger : père, frère, mari. Huit femmes sur dix ont été humiliées, insultées, dénigrées. Dix-sept pour cent ont subi une agression sexuelle presque toujours par un homme qu’elles connaissaient. Et pendant que certains frappent ou violentent, d’autres retirent l’accès à un revenu, à un compte, à la parole. La dépendance économique reste une prison à ciel ouvert. Trente pour cent des femmes urbaines ont été privés du droit de décider pour elles-mêmes. Et dans un monde connecté, la violence a trouvé un nouvel asile : 8, 1% ont été harcelés ou exposés en ligne. Même la sphère politique n’échappe pas à l’ombre du contrôle : 6, 5% ont été intimidés, dissuadés de voter ou d’agir.
Ce que disent ces chiffres, c’est que la violence a plusieurs visages, mais un même auteur : un système. Le patriarcat n’est pas seulement une affaire d’hommes, mais un mécanisme social transmis, parfois par les femmes elles-mêmes, élevées à obéir et à reproduire l’ordre établi. 99% des violences sexuelles sont le fait d’hommes ; 62% des violences psychologiques viennent de femmes. Ainsi se perpétue la hiérarchie : par l’éducation, par le silence, par la peur.
Cependant, l’étude laisse aussi entrevoir des angles morts préoccupants. Elle ne dit rien, ou presque, des féminicides qui continuent d’endeuiller des familles, ni des jeunes filles poussées au suicide après un mariage forcé ou une grossesse imposée. Ces tragédies, pourtant bien réelles, échappent encore aux statistiques. L’absence de données sur les violences gynécologiques et obstétricales, vécues dans les hôpitaux ou les structures de santé, témoigne également d’un silence institutionnel autour de la souffrance des femmes face au pouvoir médical. En ignorant ces réalités, on invisibilise une part essentielle de la violence systémique : celle qui s’exerce sur le corps féminin jusque dans les espaces censés le protéger.
L’Etat a la responsabilité de transformer ces chiffres en actions concrètes : légiférer, protéger, éduquer, réparer. Il lui revient de créer les conditions d’une société où les violences ne sont plus tolérées, ni justifiées.
Cela passe par des politiques publiques ambitieuses, des budgets dédiés, des mécanismes de suivi, et une éducation qui déconstruit les modèles de domination dès l’enfance. Il faut cesser de penser la violence comme un problème privé : elle est une question publique, un enjeu de justice sociale et de dignité nationale. Ces constats imposent une réponse : que l’Etat tienne son rôle, que les institutions se mobilisent, que chaque citoyen et chaque citoyenne prenne part à ce combat. Parce qu’au-delà des chiffres, il y a des vies. Parce qu’aucune société ne peut prétendre au progrès quand la moitié de sa population vit sous la peur. Ces violences se produisent ici, sous nos yeux, et c’est ensemble que nous devons les rendre impossibles.
Par Fatou Warkha SAMBE

