Les leçons d’Odessa
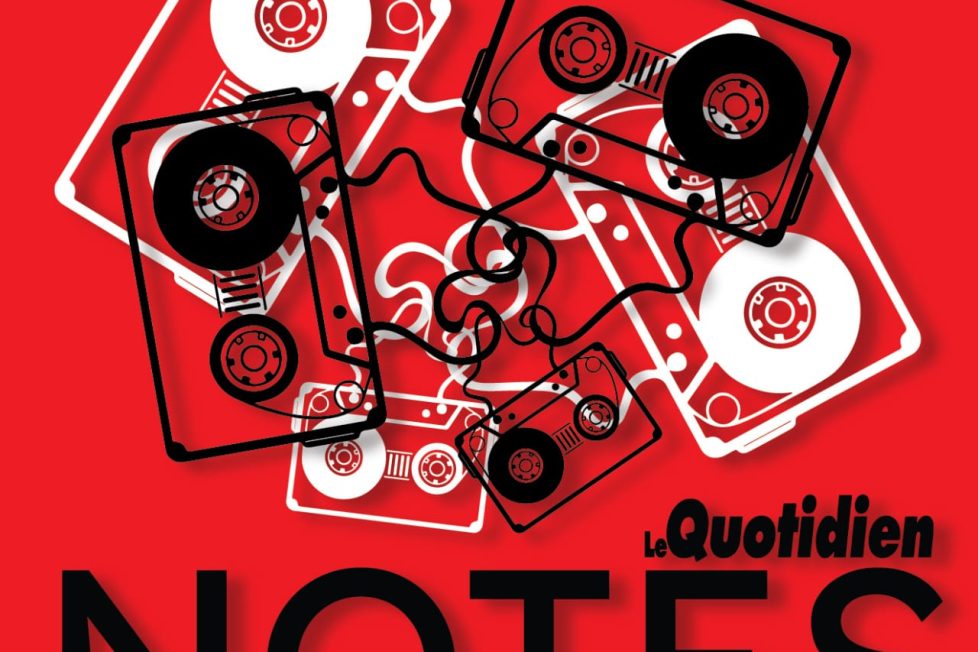
La Russie a fini par mettre en exécution sa menace de ne pas renouveler l’accord sur l’importation des céréales de l’Ukraine, appelé Black Sea Grain Initiative (Initiative de la Mer Noire sur les céréales). Dès que la décision du Président Vladimir Poutine a été rendue publique, c’est un concert de lamentations qui a éclaté de différents coins du monde. Cela a commencé par les ennemis européens du chef d’Etat russe. La Commission européenne a publié un communiqué dans lequel elle «condamne sans équivoque la décision de la Russie». Elle ajoute que ce faisant, «la Russie exacerbe la crise alimentaire mondiale qu’elle a contribué à créer». La Commission de l’Union africaine de son côté, par la voix de son président, Moussa Faki Mahamat, s’est fortement désolée de cette décision. Sans doute s’est-il rappelé qu’il avait été avec Macky Sall à Sotchi en Russie, en juin 2022, pour plaider la sortie des céréales et d’engrais de l’Ukraine et de Russie. Le Président russe, qui avait été jusque-là intransigeant sur la question, notamment quand il s’adressait aux Occidentaux qui venaient d’alourdir les sanctions contre son pays, avait eu la grâce d’accéder aux demandes des dirigeants africains d’assouplir le blocus des ports ukrainiens, notamment d’Odessa, où passait l’essentiel des produits ukrainiens d’exportation dont le blé et les engrais.
Et il était plus que temps. La guerre en Ukraine avait eu pour conséquence de plonger dans la misère des populations africaines déjà fortement affectées par les effets du Covid-19. Les échanges commerciaux qui avaient fortement ralenti, s’ils ne s’étaient pas concentrés vers les pays riches au détriment des autres, n’avaient pas totalement retrouvé leur rythme d’avant-Covid. Le gouvernement sénégalais avait tenté d’enrayer la hausse inexorable des prix des produits de première nécessité en se privant d’importantes ressources financières tirées des taxes et autres droits d’accises. Ainsi, pour la farine de blé, les importations entraient sur le territoire sénégalais sans plus s’acquitter d’aucune sorte de taxe. Hélas, le blé restait toujours cher car en plus de la hausse des prix du produit lui-même, le coût du fret maritime vers le Sénégal, comme tous les autres pays africains, connaissait une hausse importante.
La tonne de blé atteignait les 350 000 francs Cfa en juin de l’année dernière à Dakar, contre près de 200 000 Cfa deux mois auparavant. L’Etat n’avait plus aucune marge de manœuvre, d’autant plus que le pain n’était pas le seul produit à connaître une hausse des prix. En fait, avec la crise du Covid et la guerre des Slaves, les Sénégalais découvraient que rares étaient les produits du terroir qui faisaient l’ordinaire des ménages, surtout dans les grandes villes. De manière abrupte, on se rendait compte de l’échec des décennies des programmes d’autosuffisance alimentaire.
Bien avant les programmes d’ajustement structurel de triste mémoire, le pays s’était lancé dans des programmes d’import-substitution, qui visaient à encourager la production au niveau local de ce que nous consommons. Mais si le Sénégal a connu un succès retentissant et dignement salué dans le domaine de l’aviculture, partout ailleurs, le constat est à l’échec. Nous avions démontré dans ces colonnes la semaine dernière, comment la volonté politique n’a jamais réellement accompagné les milliards déversés dans la production des spéculations comme le riz ou l’arachide dont les rendements ne cessent de régresser en dépit des fortes sommes qui leur sont consacrées.
S’agissant du blé, qui sert essentiellement à fabriquer du pain, une institution du ministère de l’Agriculture, l’Institut de technologie alimentaire (Ita), a réussi depuis plusieurs décennies, à en réduire la part dans du pain de qualité par l’apport du maïs, du mil, du sorgho ou d’autres céréales produites localement. On parvient à produire du pain très riche en nutriments et facile à digérer. Malheureusement, faute de soutien des autorités, la vulgarisation de ces produits ne se fait pas de manière à pouvoir les imposer au public. Ce qui fait qu’ils sont devenus des produits de niche, destinés à une clientèle aisée.
De passage à Dakar en mai dernier, un gros fermier français, membre du Medef, ne comprenait pas la décision du Sénégal de chercher à produire du blé ici. Il disait que si le pays voulait se lancer dans ce domaine, il ne devait pas sélectionner 2 variétés, mais plusieurs dizaines, pour être sûr d’avoir le produit qui conviendrait parfaitement. Néanmoins, pour lui, la culture de blé ne devrait pas se faire au détriment des céréales locales. Les efforts et ressources consacrés à acclimater le blé sous nos cieux, ne devraient-ils pas être plutôt consacrés à promouvoir nos produits locaux et à les adapter à notre mode d’alimentation actuelle ? Ce serait ainsi que l’on aurait assimilé les leçons du blocus d’Odessa ?
Par Mohamed GUEYE – mgueye@lequotidien.sn

1 Comment

C’est l’inverse. On a plutôt forcé la Russie à se retirer. Ce sont l’Occident collectif et leur valet et despote ukrainien qui n’ont pas respecté les intérêts russes obligeant ainsi la Russie à se retirer de l’accord. Sachez aussi que l’Ukraine ne représente que 5% des exportations de blé, loin derrière la Russie qui pèse 20%.