L’exercice de la responsabilité
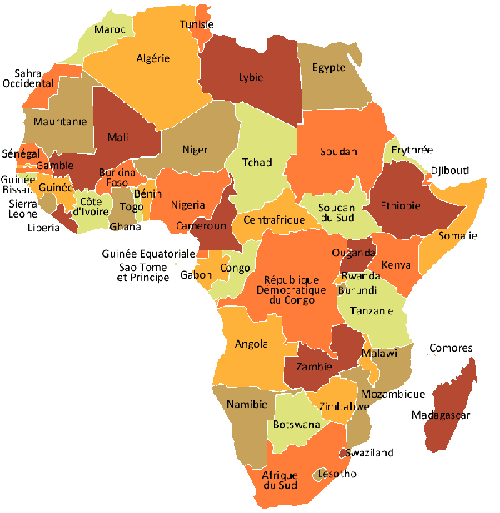
Les Etats africains et leurs intellectuels nourriciers ne pourront plus s’y dérober pendant longtemps. Ils devront faire face à leur responsabilité. Etre comptables de toutes les situations de souffrances qui fragilisent leur Peuple et par lesquelles se rongent l’estime de soi, l’abandon de dignité, de leur population. Assumer. Endosser. Ne pas affubler à l’outre-Atlantique la tunique du cadavre. Porter les habits d’un mot – responsabilité – que l’on chante, sans jamais l’exercer. Par Etats, il ne faut pas seulement entendre les hommes politiques, mais aller au-delà, et inclure les producteurs de savoirs et les usagers, masse inclusive qui aura, à dessein, préféré le désir incantatoire de responsabilité à l’exercice réel de responsabilité. La quête irrépressible d’une indépendance réelle couvre de son ombre la réalité d’une irresponsabilité sur la parcelle d’indépendance déjà conquise. Le regard ainsi borgne se borne à voir l’horizon d’une souveraineté absolue, en même temps qu’elle passe sur l’échec immédiat, curieusement attribué à la première.
Il y a dans le vent de l’histoire qui souffle un parfum de conscience qui pique le nez. L’Occident qui offrait une commode diversion ne pourra plus servir de «causalité première idéale», d’une part – il faut l’admettre – parce que le chaos de l’histoire coloniale a dévié véritablement à jamais une trajectoire et, d’autre part parce qu’il exonérait la classe dirigeante de comptes à rendre. On dira comme Césaire dans le Discours que les masses s’éveillent au rythme lent et savant du savoir, que la tromperie qui avait excuse de l’ignorance n’aura plus le même effet. Les fora bruissent du désir de savoir. Du soleil des indépendances, nous retenons souvent, dans une sélection qui nous arrange, la nervosité virtuose d’un Kourouma. Il nous faudra désormais le relire et entendre dangereusement le procès qu’il faisait des soleils – éteints – des indépendances. L’exercice de la responsabilité est la première condition d’un huis clos où les citoyens d’un pays se réfèrent à leurs dirigeants, seuls, sinon premiers comptables de la vie de leur pays. L’exercice de la responsabilité, c’est de fait s’extraire de la litanie de la victimisation, de bipolarisation Nord-Sud, et la consécration d’agendas locaux qui n’invitent pas de tiers dans la conversation nationale, ni pour jouer le rôle d’arbitre ni de bienveillant, encore moins de malveillant. L’exercice de la responsabilité, c’est une invitation à réfléchir sur la notion du même nom, dont l’absence dans un pays comme le Sénégal est l’explication première d’une impression de chaos, de disqualification de l’Etat et d’un écrasement brutal de la responsabilité individuelle.
Il y a une indécence à observer la vie sociale, culturelle sénégalaise, et à conclure que l’essentiel des problèmes des populations serait le fait de la colonisation. De l’indécence on passe vite à la mauvaise foi. Cette défausse qui s’est emparée du champ intellectuel africain fédère d’ailleurs un spectre large de populations. De l’afrocentriste au théoricien du complot, en passant par le décolonialiste, la figure religieuse, l’idée d’une main extérieure invisible qui administrerait le cours des affaires était reposante. En externalisant la responsabilité, il y a un confort à se complaire dans une situation de «victimat», ou pour aller plus loin, entendre avec Kamel Daoud que l’on entretient un commerce de la colonisation. Cette externalisation interdisait ainsi toute responsabilité locale, l’incombant à un ailleurs avec lequel on entretient une relation schizophrénique. L’actualité offre à ce titre quelques illustrations éloquentes. Du ballet de chefs d’Etat africains pour commémorer Charlie en janvier 2015, en passant par la Libye en 2017 (toujours en cours), jusqu’aux enchères actuelles de virilité avec Trump, il y a une inexplicable propension chez les dirigeants africains à disserter sur l’ailleurs, souvent occidental. L’ailleurs devient le seul sanctuaire du débat où leur éclat reste possible, parce qu’il se joue sur des enjeux de postures, de phrases, d’images, et bien loin de leurs prérogatives premières : la gestion du quotidien et des intérêts de leurs populations.
Un effort constant doit être consenti à ce que la responsabilité ne soit plus un désir, qu’elle commence par être le procès de quelques générations qui ont échappé à l’inventaire de leur véritable apport. Il y a un enjeu qui se situe précisément dans cette ligne de crête entre la responsabilité individuelle et le bénéfice collectif, où l’ensemble d’une société est mise en face de ce qu’elle produit comme drames, inégalités, profonds déséquilibres. Dans le champ sénégalais, de la situation des handicapés, en passant par les talibés ou le déficit de justice, en autres faits sociaux notoires, la difficulté de la tâche de l’Etat tente de sous-traiter avec les intermédiaires, en attribuant la responsabilité à un registre moral et superstitieux qui parle aux imaginaires locaux. La fabrique du consensus qui est la caractéristique principale du débat national suppose toujours trois temps : l’irruption d’un fait divers tragique, le tollé des indignations et l’entente presque cordiale par la suite dans une concorde où toutes les responsabilités sont ensevelies. La réflexion sur le fait social sénégalais doit se mobiliser autour de ce préalable de l’exercice de responsabilité, car c’est la condition vers une réelle indépendance. Il faut fructifier ce qui est déjà acquis, cet usufruit sera naturellement le tremplin.
Exercer la responsabilité, c’est s’inviter au cœur de sa propre vie, régir sa propre temporalité. Et refuser de déléguer, car la délégation et la procuration, même si elle ne se fait que principalement dans l’accusation de l’autre, de l’histoire, c’est s’exclure et subordonner la libération à la magnanimité de l’autre. La victimisation devient ainsi une seconde consécration de la défaite, car l’acteur devient un sujet secondaire. L’exercice de la responsabilité se pose ainsi comme la seule manifestation de l’indépendance, car elle ne se proclame pas. Elle se vit.




