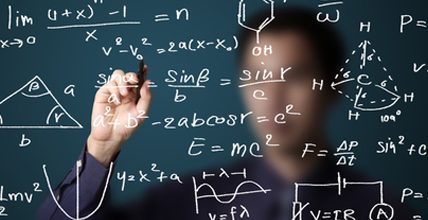Nicolas Mathieu signe un récit politique universel

Ces dix dernières années, de nombreux écrivains ont façonné ma vision du monde, orienté mon parcours intellectuel et nourri ma conscience politique, déjà ébauchée à l’adolescence grâce au rap d’Iam, de Mc Solaar, Kery James, Rapadio, Diam’s, Youssoupha… Parmi ces éclaireurs qui m’ont conduit vers plus de sensibilité aux réalités sociales et politiques, de sens critique et d’humanité, figure le lauréat du prestigieux Prix Goncourt 2018, Nicolas Mathieu. Comme le rap de ces grands frères entendus à travers les cassettes et les lecteurs Cd, la littérature de Nicolas Mathieu est un puissant relais de pensée, car elle éclaire des réalités sociales. Né à Epinal, dans les Vosges, cet écrivain français de «l’entre-deux» est l’un des auteurs dont la découverte m’a profondément bouleversé. Je l’ai écouté avant même de le lire. C’était un matin d’hiver 2020, dans le Rer A qui me conduisait au neuvième arrondissement de Paris, où je servais, en bon soldat du capitalisme, à la direction des études économiques et financières d’une banque, au sein d’une belle équipe. Nous sommes tous des enfants du capitalisme, car nous naissons et grandissons dans un monde structuré par ce système qui façonne nos modes de vie et nos désirs. Comme le disait Marcel Mauss, sous une autre forme, le capitalisme peut être considéré comme un «fait social total».
J’ai découvert tardivement Nicolas Mathieu, à travers l’émission culte La Grande Table, présentée à l’époque par la brillante Olivia Gesbert, où il venait parler de son chef-d’œuvre Leurs enfants après eux (Actes Sud, 2018). Son premier roman, Aux animaux la guerre (2014), est un polar social, suivi de Connemara (2022).
Lors de cette conversation, qui suivait l’obtention du prestigieux Goncourt, Nicolas Mathieu évoquait la France des petites villes, des faubourgs, ces territoires en marge de la mondialisation souvent oubliés par les politiques publiques et les médias mainstream. J’ai été bouleversé bien avant d’ouvrir une seule page du livre : ses mots et ses silences étaient d’une justesse rare. Lorsque j’ai enfin lu le livre, ce que l’auteur disait sur les ondes de France Culture prenait une dimension encore plus forte, renversante, politique et universelle.
(Il en est dont il n’y a plus de souvenir,
Ils ont péri comme s’ils n’avaient jamais existé ;
Ils sont devenus comme s’ils n’étaient jamais nés,
Et, de même, leurs enfants après eux.
Siracide, 44,9)
C’est avec ces mots provenant de l’Ecclésiastique, l’un des livres sapientiaux de l’Ancien Testament, que débute Leurs enfants après eux, un roman de 425 pages. Dans ce livre dense mais passionnant, Nicolas Mathieu nous saisit par le col en nous montrant, au premier plan, les politiques, celles et ceux qui sont censés changer la vie, et les destins figés de nombreuses personnes.
Ce roman est à la fois une fresque générationnelle et universelle. Il suit principalement trois personnages : Anthony, Steph et Hacine. Ils grandissent dans une ville de l’Est de la France marquée par la désindustrialisation et le chômage, ce qui influence profondément leurs trajectoires de vie.
Nicolas Mathieu montre que les conditions sociales, économiques et culturelles façonnent les choix et les possibilités de chacun. Ces jeunes, notamment Anthony, fils d’ouvrier, et Hacine, fils d’immigré marocain, sont issus de familles dépourvues de capital, au sens bourdieusien du terme, et sont capturés par le déterminisme social, ce qui n’est pas le cas de Steph, issue de la bourgeoisie, voire d’une catégorie plus aisée. Malgré cela, ils tentent, avec les moyens du bord, de tracer un chemin dans un monde en mutation. Leur quête est simple mais universelle : accéder à une vie douce, ponctuée de bonheur, ces choses simples qui devraient être accessibles à tous, quelles que soient leurs conditions de naissance.
Dans ce roman, Nicolas Mathieu présente une vallée marquée par les stigmates de la fermeture des hauts-fourneaux, fleuron industriel qui permettait autrefois à de nombreux pères de gagner leur vie et d’assumer leurs responsabilités. Avec la disparition de ces usines, beaucoup de familles basculent dans la précarité, souvent déjà présente, ce qui exacerbe un sentiment d’abandon et de fatalité sociale.
Cette vallée perdue quelque part dans l’Est de la France, à Heillange, ville fictive créée par l’auteur, est une métaphore mondiale. Il ne s’agit pas seulement d’une chronique de la Lorraine, mais d’une méditation sur l’adolescence, les rêves et les difficultés de s’émanciper de sa condition sociale. En fin de compte, c’est un récit sur la condition humaine, entre désir d’avenir et poids du passé, légué par les parents. En cela, ce livre a une dimension universelle. Dans les régions américaines frappées par la désindustrialisation (Rust Belt) ou dans les zones minières sénégalaises, notamment dans la région de Thiès, ville où j’ai eu mes premières émotions, on retrouve les mêmes fractures, les mêmes jeunesses en quête de sens et d’avenir.
Les usines ferment en laissant des foules entières au chômage, sans parler de la pollution et de son lot de conséquences sur les corps déjà fragilisés par les maux de la vie. La situation de Anthony, de son cousin, de Hacine, est la même que celle de Pierre, Omar, Thierno, Moussa dont les destins sont tristement fixés à Lam-Lam, Taïba, Matam. La vie de ces oubliés de la République révèle les illusions méritocratiques et les limites de l’ascension sociale dans un monde globalisé mais fermé, à l’aune du populisme et du rejet de l’autre. Au regard de ces vies minuscules, sans perspectives ni avenir, je puis dire sans réserve que la République n’a pas tenu sa promesse : garantir à tous ses citoyens l’égalité, nonobstant le hasard de la naissance. Pour moi, la promesse républicaine signifie ceci : chaque citoyen, indépendamment de son origine sociale ou de son lieu de naissance, doit pouvoir accéder à l’éducation, à la santé, à la justice et à l’égalité des chances.
Le style et la langue de Mathieu me touchent profondément. Son écriture, qualifiée parfois de balzacienne, est à la fois précise, déroutante et sensible, le tout dans une humanité bouleversante. Influencé par la trajectoire du Prix Nobel de littérature Annie Ernaux, Nicolas Mathieu est un transfuge de classe qui ne donne pas de leçons. Comme elle, il transforme le vécu ordinaire en matériau littéraire et politique. Tout au long du livre, il refuse, dans une érudition dont lui seul a le secret, le discours moralisateur ou militant de gauche pour donner à voir, presque sociologiquement, les vies marquées par la désindustrialisation et l’héritage social.
Son roman est éminemment politique dans sa dimension la plus nue, par le choix du terrain, du style, de la focalisation sur ces vies minuscules. Je le dis avec une joie immense : Nicolas Mathieu fait partie des écrivains qui sont dans mon panthéon personnel. En rendant visibles ces vies invisibles, il nous rappelle que la littérature peut être aussi un levier d’émancipation. Comme le morceau intemporel Nés sous la même étoile d’Iam ou Dundu Gu Dée Gun de Rapadio, ce roman de Mathieu met en scène une jeunesse en colère, tentée par la violence, mais cherchant surtout à exister et à être entendue. Sur ce registre, le rap et le roman partagent ici la même vocation : donner une voix à ceux que l’histoire officielle oublie. Le titre, à lui seul, méritait déjà le Goncourt. Il évoque la question de ce que l’on transmet à la génération suivante, dans un monde qui s’efface. Le lauréat du Prix Goncourt 2018 souligne brillamment la reproduction des destins Leurs enfants après eux pris dans les mêmes impasses que leurs parents.
Entre désillusion, colère, résignation, amour, errances et avenir nuageux, une interrogation existentielle et politique centrale surgit : que peuvent encore espérer les enfants d’ouvriers, d’agriculteurs, de pêcheurs, bref, de prolétaires ?
Birane DIOP
Spécialiste en stratégie et gouvernance de l’information, s’intéresse aux liens entre culture, institutions et transformations économiques et numériques. Ses réflexions croisent politique, littérature, économie et gouvernance de l’information.