Paix en Casamance, gestion des ressources naturelles, affaire Salif Sadio, Grpc… : Le cours d’histoire de Ibrahima Ama Diémé
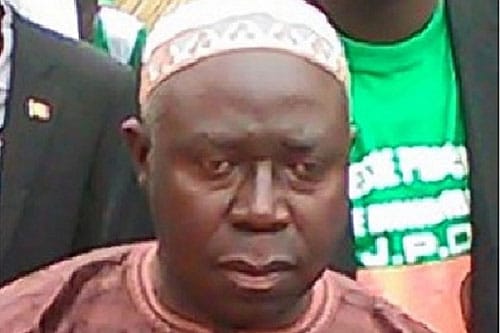
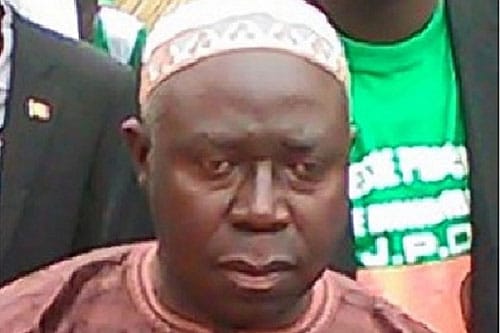
Témoin de la crise casamançaise et membre aussi bien du Collectif des cadres casamançais (Ccc) que du Groupe de réflexion pour la paix en Casamance (Grpc) dirigé par Robert Sagna, Ibrahima Ama Diémé livre ses vérités sur la gestion du dossier casamançais et toutes les questions de l’heure qui entravent le retour d’une paix définitive dans cette région. Dans cette interview, le professeur d’Histo-Géo à la retraite, ancien chargé de mission du médiateur de la République, parle du cas Salif Sadio, de la problématique de la gestion des ressources naturelles…
En tant que témoin de la crise casamançaise et acteur engagé du processus de paix, quel est le niveau actuel du dossier casamançais ?
Nous tous, qu’on soit Casamançais en particulier, Sénégalais en général et même habitant de la sous-région ouest africaine, devons nous réjouir de la situation actuelle et rendre grâce à Dieu qu’on ait pu arriver à cette accalmie que tout le monde constate et dont tout le monde profite. Et ce, quelles que soient les positions que l’on occupe du reste. Que l’on soit membre des forces de sécurité, autorité administrative ou politique, Ong, des citoyens tout court, des étrangers venant ou vivant en Casamance, tous doivent rendre grâce à Dieu de pouvoir profiter de cette accalmie qui constitue déjà une paix qui frappe à la porte de notre pays.
Qu’est-ce qui a rendu possible cette accalmie ?
Là il faut reconnaître les efforts des uns et des autres. Je vous disais il y a quelques années qu’on a senti de la part du président de la République sa volonté de résoudre cette crise. Il l’a manifestée à plusieurs occasions, avec trois séjours à Ziguinchor en dehors des séjours réguliers comme les Conseils des ministres décentralisés voire les campagnes électorales à travers le Sénégal. Pour Ziguinchor en tout cas, il est venu ici à trois reprises pour montrer sa volonté à accompagner le processus pour que le Sénégal, dans son intégrité, puisse vivre la paix. Il y a aussi de l’autre côté les responsables du Mfdc qui, avec l’avènement de Macky Sall, ont manifesté leur désir de marquer un temps d’arrêt pour voir un peu ce qu’il va leur proposer. Il y a enfin les acteurs du processus parmi lesquels le Grpc auquel j’appartiens en plus d’autres agents, des bonnes volontés, des Ong qui, dans l’ombre, travaillent à ce que la paix revienne. Tout cela a amené les résultats que nous vivons aujourd’hui. Et il faut magnifier cela et souhaiter que tous nous nous engagions à consolider ces acquis parce qu’aucun d’entre nous n’a intérêt à ce que cette situation se détériore et qu’on revienne à la case de départ, c’est-à-dire à ces périodes de violence, de velléité, de braquage par-ci par-là, et de tentatives de mettre fin aux accords, etc. Retourner là-dedans, c’est retourner à nouveau dans un cycle de violence dont on ne peut pas mesurer les limites. Voilà le cadre campé : l’Administration fait ce qu’elle peut, l’Etat en tant que tel fait ce qu’il peut, les combattants du Mfdc font ce qu’ils peuvent et nous autres du Grpc qui sommes des facilitateurs du processus continuons à travailler dans ce qui est notre mission ; à savoir conseiller les deux protagonistes. Aux combattants du Mfdc, on leur fait savoir que la seule issue valable pour chacun c’est d’arriver à s’asseoir autour d’une table avec leurs interlocuteurs qui sont à la tête de l’Etat ; l’Etat qui, le moment venu, va envoyer des délégués pour discuter avec le Mfdc. Et c’est autour de cette table maintenant que toutes les questions seront posées et les réponses seront apportées dans la mesure du possible et de l’acceptable. Voilà un peu comment le processus devrait se dérouler.
Où en sont concrètement les contacts entre l’Etat et le Mfdc ?
Je voudrais préciser d’ailleurs au moment où nous parlons que le président de la République a mis une structure de dialogue qu’il appelle le Comité ad hoc et à la tête duquel se trouve l’amiral Sarr. Ce dernier discute avec les éléments du Mfdc auxquels il a accès, en attendant qu’il puisse accéder à tout le monde pour que justement les discussions s’engagent. Et nous au Grpc, nous travaillons à préparer les documents au moins qui pourraient faire l’objet de consensus ; entre d’abord les différents segments du Mfdc, mais également entre les différents segments du Mfdc et le reste de la population casamançaise. Parce que quand même il s’agit là de discuter de l’avenir de la Casamance. C’est dire qu’il n’y a pas aujourd’hui quelqu’un qui peut se prévaloir d’un mandat de discuter tout seul de l’avenir de la Casamance. Il faudrait donc qu’on aille vers la réconciliation des Casamançais. Ce qui va permettre de faciliter le processus de renforcement du retour de la paix. Donc c’est ce travail là que nous sommes en train de faire et qui se poursuit avec l’espoir que très certainement les différents segments du Mfdc, ceux armés comme politiques, de l’intérieur comme de l’extérieur, s’accorderont sur la nécessité qu’il n’y a pas de crise sans solution, de crise sans fin. Et nous ne sommes pas des extra-terrestres, nous les Casamançais, pour que notre situation soit celle qui sera la seule que le monde n’arrivera pas à voir résolue. On a connu des crises en Amérique latine avec les Farc, mais c’est terminé aujourd’hui et on ne parle plus de la crise en Colombie comme on en parlait dans le temps. Il faudrait aujourd’hui que les Casamançais acceptent qu’il faut savoir mettre fin à une situation. Et autant il a fallu un courage pour s’engager dans le maquis afin de vouloir défendre des idéaux, autant il faut plus de courage pour aller vers la fin de la crise parce qu’aujourd’hui tout le monde veut que cette crise là connaisse sa fin.
Est-ce à dire que vous ne cautionnez pas la démarche solitaire de Salif Sadio qui avait commencé à organiser des fora pour s’adresser aux populations casamançaises ?
Là aussi, il faudrait dire que de tous les chefs du maquis, Salif s’était distingué pendant certaines années comme étant quelqu’un de très favorable à la nécessité de trouver un consensus autour de la problématique de la Casamance. Et il est resté, à mon avis, dans cette logique, car il faut rappeler que malgré ce qu’on peut dire de Salif Sadio, c’est lui qui a accepté le premier de discuter avec le Comité ad hoc par Saint Egidio interposé et c’est lui qui a accepté d’envoyer des émissaires à Saint Egidio pour discuter avec les interlocuteurs de l’Etat.
Qu’est-ce qui s’est passé par la suite ?
Je ne suis pas dans le secret des envoyés de Salif, mais je crois savoir que leurs discussions ont buté. Sur quoi elles ont buté ? Eux seuls le diront. Mais brusquement au moment où les autres segments du Mfdc ont enclenché leur processus d’unification de leur mouvement afin d’aller à la table des négociations tel que proposé par le Comité ad hoc, on assiste à des tentatives de sortie de Salif, des tentatives que je considère à la fois heureuses et malheureuses. Malheureuses parce que la première fois qu’il a sorti un communiqué pour une communication à Koundioughor afin de dire aux Casamançais et à l’opinion quel est l’état des négociations entre lui et le Comité ad hoc à Saint Egidio, personnellement j’ai applaudi, car je me disais que maintenant on va savoir qu’est-ce qu’ils se sont dit à Saint Egidio, quelles sont les difficultés, si difficultés il y en a, et quelles sont les étapes à franchir. Mais malheureusement, on constate qu’il n’a pas été lui-même à Koundioughor. Il a envoyé à sa place des représentants et lesquels, au lieu de parler des contours de la rencontre de Saint Egidio, sont revenues sur les attitudes qui ont précédé l’éclatement de la violence dans la région. Finalement, je me suis dit est-ce que c’est ça que les Casamançais attendaient, est-ce que c’est ça que l’opinion attendait ? Est-ce que c’est la non négociabilité de l’indépendance de la Casamance que les Casamançais attendaient ? Non ! Ce qu’ils attendaient, c’est de dire que nous avons été à Saint Egidio, nous avons discuté de tel et de tel problème, voilà où on s’est entendu et voilà les points de désaccord. C’est pourquoi tout le monde est resté sur sa faim après la sortie de Koundioughor. Et brusquement encore, on apprend que ça va se passer à Thionck-Essyl et après Thionck-Essyl, Diouloulou.
Cela ne s’est pas bien passé à Diouloulou et à Kagnobon comme Salif l’avait planifié…
Si Salif (Sadio) pense que l’Etat du Sénégal est son interlocuteur, lorsqu’il veut aller dans une localité quelconque, il faut qu’il s’adresse au moins à l’autorité de cette localité. Et que celle-ci lui dise oui tu peux ou tu ne peux pas. Et si l’autorité de la localité donne un avis défavorable, je ne pense pas – et si c’est un conseil qu’il va prendre en bien ou en mal et il est libre de le faire – que ça soit raisonnable de sa part de dire qu’il va organiser par la force son Assemblée générale. Ce qui a amené ce qu’on a connu à Diouloulou et à Kagnobon. Parce que de toutes les façons, il n’est pas allé tout seul à Saint Egidio, mais il est allé avec des représentants de l’Etat. Il n’est pas allé tout seul pour discuter d’une question crypto-personnelle, mais plutôt d’une question qui intéresse à la fois les autorités du Sénégal, son groupe à lui et les autorités locales des villages des communes dans lesquelles se trouvent les villages. Il faut qu’il tienne compte de l’opinion de tous ceux-là. Mais au finish, on a constaté que ça s’est terminé à Kagnobon avec la dislocation de la tentative de réunion ponctuée par des interpellations et par la suite des procès au Tribunal. A mon avis, ce fut un procès d’apaisement, car les juges qui avaient en charge ce dossier n’ont pas eu la main lourde. Ce qui était d’ailleurs la meilleure attitude, car il fallait que les gens sentent que de part et d’autre il y a encore cette volonté d’accalmie, de renforcer cette accalmie et de rechercher la paix non pas par la force, mais par un processus de dialogue. Et qui dialogue dit capacité d’écoute des acteurs, volonté d’écoute des acteurs. Quand quelqu’un dit que je veux faire ceci et que l’autre répond que ce n’est pas possible, essayons alors de voir sur ce que l’on peut s’accorder et on avance.
Salif Sadio demeure-t-il toujours cet élément incontournable dans ce processus de paix, comme vous le prétendiez il y a de cela deux ans ?
Oui jusqu’à présent et compte tenu de ce qu’il a été dans le maquis et dans le Mfdc en général, il faut que Salif (Sadio) reste un élément qui va compter dans le processus de négociations. Maintenant, il faut que lui-même soit convaincu qu’il faut qu’il évolue dans le sens de la situation actuelle. Et celle-ci est que les gens veulent la paix, ils veulent connaître cette Casamance pacifique, accueillante, qui intègre tout le monde et qu’il soit l’exemple même de ce que les Sénégalais rêvent d’être, un Etat où il y a toutes les civilités, toutes les conditions de cohabitation pacifique sans tenir compte ni de l’appartenance ethnique, religieuse, etc. On se félicite souvent qu’à Ziguinchor nous avons un cimetière qui est à la fois pour les chrétiens et pour les musulmans, et nous sommes dans une région où, à la limite d’une forêt sacrée, on enterre et les catholiques et les musulmans et les animistes, etc. Une région cosmopolite à tout point de vue, où il y a tous les noms de famille que vous trouvez au Sénégal et dans la sous-région. Donc, il ne saurait y avoir d’exclusion pour dire que X n’est pas ceci et Y est cela. Et malheureusement, c’était ça qui avait amené la crise qui s’était posée ici au-delà des éléments matériels qui étaient des objets de revendication des populations en son temps avant 1982 d’ailleurs, à savoir les questions d’ordre économique, social, de développement, de scolarité, de santé, etc. Cela a fait donc un ensemble de revendications et malheureusement les gens se sont engouffrés dans l’exclusion et c’est cela qui a créé cette crise que l’on a connue, mais qui, dieu merci, est en train de s’éteindre progressivement avec une gestion plus responsable. C’est pourquoi j’interpelle tout le monde à voir ce qui est l’intérêt de tout le monde. Une chose est de décider d’aller dans un processus de guerre, une autre chose est d’être certain qu’on ne maîtrise pas quand est-ce cette guerre sera terminée. Donc il vaut mieux ne pas aller dans cette guerre et essayer de maîtriser tous les éléments qui peuvent concourir à un apaisement définitif que de vouloir remettre en cause cette paix-là que nous vivons et dont nous profitons tous.
Comment en est-on arrivé d’ailleurs à cette crise qui hante encore le sommeil des populations ?
Parce qu’il faut dire du point de vue historique, si la conquête qui a permis la création de l’Etat du Sénégal s’était terminée dans la plupart des superficies du Sénégal, notamment du Nord et à l’Est en 1900, en Casamance, à cause des difficultés d’accès dans certaines zones qui constituaient des zones refuge, la conquête ne s’est pas parachevée jusqu’au moment de l’indépendance. Il y a eu des zones où les gens ont résisté jusqu’à l’indépendance. C’était d’ailleurs normal, car à l’époque il n’y avait pas d’entités qui résistaient ou pas, mais c’était quelques groupuscules voire même des tribus. C’est vrai que lorsqu’on parle du royaume d’Affilédio Manga, à l’échelle des grands Etats, ce royaume ne peut être considéré comme une tribu des Bandial. Tout comme quand vous allez dans le Oussouye, le roi n’a de pouvoir que dans Oussouye et aux alentours, mais pas au-delà. Vous allez à Mlomp, le roi a là-bas également son pouvoir juste autour de Mlomp, idem à Calobone, etc. Donc il faut que les gens connaissent leur histoire. Un village casamançais, qu’il soit diola, balante, manjacque ou autre, était un village qui se suffisait comme juste un Etat, une République. Et les litiges étaient déjà entre ces villages. Et ils étaient à l’état latent parce que justement le processus de création d’un Etat beaucoup plus grand, multiethnique, multiracial n’était pas terminé chez nous. Et la crise arrive ! Dès qu’elle a éclaté en 1982, en moins de 22 ans d’indépendance du Sénégal, l’Etat n’était suffisamment pas bien construit dans la région. L’autorité qui représentait à l’époque l’Etat et qui s’appelait le chef d’arrondissement ou à la limite le chef de village n’avait pas encore tous les égards, tout le consensus de ceux qui étaient censés être ses administrés. Tout cela a contribué à fragiliser davantage la région avec l’éclatement du conflit. Du coup, ceux qui avaient des problèmes personnels avec un chef de village se sont engouffrés là-dedans ; ceux qui avaient des problèmes personnels d’héritage, des problèmes de terre à l’intérieur d’une même famille se sont engouffrés là-dedans ; ceux qui avaient des problèmes de frontières entre leur village et celui d’à côté se sont introduits là-dedans. Tout cela fait un ensemble de problèmes qu’il faut absolument gérer et qui ne seront même pas définitivement gérés même si la crise se terminait. Dans tous les Etats du monde, si on suit l’actualité, se posent des problèmes de terre ; une terre pour l’habitat, pour l’exploitation et une autre qui a un statut qui varie selon les moments, selon les régimes. Et c’est cette terre qui nous donne tout et où nous retournons.
Vous semblez donc indexer l’incapacité des politiques à faire face aux crises latentes. Et quid de la responsabilité de l’Etat ?
Mais aujourd’hui, les débats d’ordre politicien c’est qu’il y a du minerai quelque part. Ceux qui habitent disent que c’est notre terre à nous donc notre minerai à nous. L’Etat dit que c’est son minerai, car il est propriétaire de tous les minerais, des mines qu’il y a dans son territoire. Et les populations locales, poussées par d’autres forces oppositionnelles qui plaident pour le droit de propriété, s’opposent. Le cas du zircon de Niafrang est là. Certains disent que c’est le zircon de Niafrang, personne ne doit l’exploiter, etc. Alors que du point de vue de la loi actuelle, les minerais appartiennent à l’Etat et c’est à l’Etat de décider de les exploiter ou pas. Et il le fait en conformité avec ce qui est de son intérêt, mais également avec l’intérêt des populations qui vivent dans la zone parce que c’est le seul représentant légal des populations, qu’elles soient du sud, du nord, de l’est ou de l’ouest. Ce débat, il faut qu’on l’engage, que ces populations qui sont dans ces zones, que ce soit à Niafrang, Cap Skirring, Falémé, Diogo, Mboro, etc. sachent qu’elles n’existent parce que l’Etat leur apporte une certaine garantie de droit et de liberté. Parce que s’il n’y avait pas cet Etat, cette stabilité, on aurait des situations vécues ailleurs. Je ne vais pas citer de pays, mais vous savez que tous les matins on entend qu’il y a des attaques par-ci avec tant de morts, des attaques par-là avec son lot de victimes, des mouvements de ceci et de cela, etc. Mais ici au moins, la stabilité est garantie par l’Etat qui garantit à tous les citoyens la libre circulation à l’intérieur du territoire, et donc leur égalité. Maintenant rien n’est donné, tout se conquiert et il faudrait donc que les gens tiennent compte du fait que l’Etat garantit à tout le monde le minimum. Par conséquent, nous devons reconnaître à l’Etat le droit et le devoir de prendre en compte justement certaines de nos préoccupations, notamment un environnement décent, l’accès à l’école pour tous les enfants qui vivent dans le territoire sénégalais, l’accès à la santé, etc. Mais tout cela demande beaucoup de moyens et l’Etat doit investir. Et il ne peut investir qu’à partir des ressources qu’il y a d’abord à l’intérieur du territoire national. Donc c’est à l’Etat de dire si j’exploite tel minerai, telle richesse que le Bon Dieu a mis à la disposition de mes populations. Ça me rapportera ceci et en contrepartie cela va me permettre de faire différents types d’investissements. Les gens réclament des routes, de l’électricité, de l’eau ; et tout cela c’est de l’argent. Et nous sommes dans une région où malheureusement, à la faveur de la crise, les populations ne payent plus d’impôts. Alors d’où viendront les ressources qui vont permettre aux collectivités territoriales de pouvoir prendre en compte un minimum d’investissement ? Or les maires on les a élus pour qu’ils fassent des investissements.




