Politiques de la détestation
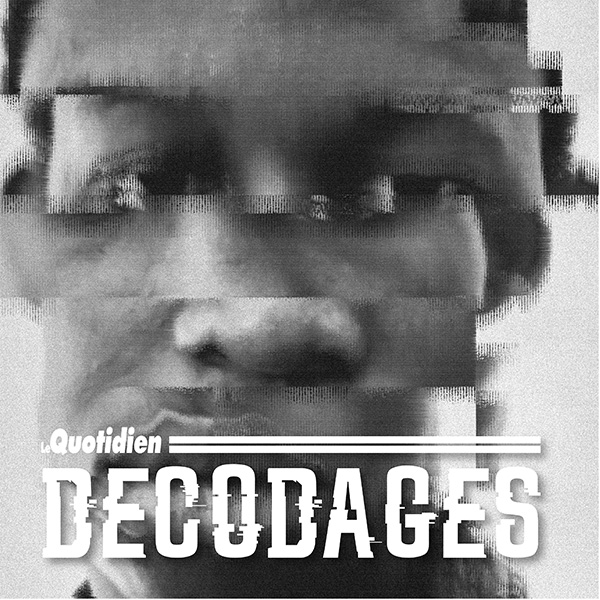
Après sa condamnation historique dans l’affaire du financement libyen de sa campagne électorale victorieuse de 2007, le Président Nicolas Sarkozy, lors de sa réaction à chaud, a déclaré, tel un conquérant tartare, que la «haine n’a donc décidément aucune limite». Chez nous, hélas !, depuis l’avènement de Pastef, la haine -ce «sentiment du raté», écrit le Général De Gaulle- a franchi toutes les limites. Elle est devenue, sous nos yeux, une manière d’être, de se donner une identité, de proclamer à l’envi son patriotisme, sa différence, en désignant non pas un adversaire, mais un ennemi avec lequel on ne peut pas discuter, car sa place est inéluctablement en prison, au fond d’une oubliette taillée sur mesure pour lui. C’est aussi admettre qu’entre lui et nous, il n’y a aucune part commune, aucun fond symbolique, c’est-à-dire les liens que nous avons en partage, définis soit par la nécessité de garantir la pérennité de la communauté politique, soit par la Nation et son exigence de contexture.
L’ennemi, et non l’adversaire, en raison de ses idées ou des épithètes concoctées de toutes pièces qu’on lui colle à tort, est à combattre non pas avec des arguments politiques, mais suivant des critères moraux, c’est-à-dire le choix entre le bien et le mal. Il s’agit précisément de la moralisation de la vie politique dont parle la philosophe politique belge Chantal Mouffe dans L’illusion du consensus (Albin Michel, 2016). Par moralisation, précise-t-elle, il ne faut pas en déduire que l’activité politique est devenue plus morale, ou même que la morale est en train de supplanter la politique, mais que les combats politiques se jouent désormais sur un terrain moral. Pour désigner et dénigrer l’autre (l’ennemi), on définit l’«Axe du Mal», les renégats, les amoraux, alors que l’autre parti, celui que l’on défend, grouille de gens honnêtes, désintéressés, soucieux de l’intérêt général, de quasi dévots dont les valeurs morales sont déclamées et présentées comme une arme, pour revendiquer une victoire (différence) sur la vermine.
Il est vrai qu’en démocratie, la ligne de démarcation séparant les différentes formations politiques est nécessaire. Elle permet, en effet, aux citoyens, conscients des enjeux, et devant une gamme de projets politiques hégémoniques, de choisir lequel répond le plus à leurs aspirations. Cette différence que l’association politique démocratique doit préserver pour empêcher la prolifération des discours populistes (notamment ceux de droite), doit néanmoins se dessiner clairement conformément à des considérations politiques à même de reconnaître la légitimité de tous les partis en conflit. Car, quand on considère l’autre comme un ennemi, ses points de vue sont illégitimes, et avec lui, il ne peut y avoir qu’une relation sans désir et brutale, marquée par une violence sans nom et sans limite.
Pastef a réussi à faire de la politique un espace où l’on fabrique des antagonismes, et désigne des ennemis à étêter par tous les moyens. La haine est devenue un instrument politique. Pour s’en convaincre, il suffit juste de voir ce qui se passe dans ces espaces de désintégration du lien social que sont les réseaux dits sociaux. «Le procureur de la République n’a qu’à prendre ses responsabilités», «comment se fait qu’Untel continue de vaquer librement à ses occupations, malgré ses crimes» ?, «la Justice est le talon d’Achille du «Projet»», «il faut effacer les juges de la Cour suprême» : telles sont, entre autres, les revendications et déclarations musclées des factotums de la révolution. Le discours du l’actuel Premier ministre a toujours été marqué par la recherche d’ennemis ou de boucs émissaires. Devant une jeunesse friande d’utopies créatrices et émancipatrices, horripilée par les ratages des élites politiques, il est facile de leur vendre un discours haineux et radicalisé : votre indigence s’explique par la corruption du Système et de ses serviteurs -journalistes, entrepreneurs, patrons de presse, etc.-, et que la solution viendra à coup sûr des hommes honnêtes et incorruptibles que nous incarnons. Dans l’imaginaire de ces jeunots et jeunes, donner sens au vacuum de leur existence revient naturellement à nourrir une inimitié viscérale envers celles et ceux qui ont réussi. La réussite n’est plus le fruit du travail, mais la revendication éhontée et offensante de son pacte de corruption avec les élites politiques. Quand on réussit désormais, et quels que soient ses mérites, on a mille et une chances d’hériter d’une épithète de voleur ou de corrompu. La richesse, semble-t-il, est criminalisée, instaurant ainsi un climat des affaires assez effarouchant pour tout investisseur.
On peut aisément constater que le discours de Pastef, des hauts responsables jusqu’aux roquets, reste marqué par une terminologie belliqueuse, d’inimitié. On nomme l’autre avec des mots on ne peut plus péjoratifs, pour lui refuser toute forme de légitimité, de vérité et de droit de vivre. Il doit choisir entre raser les murs, ou être «effacé» tout simplement par la loi impitoyable des majoritaires. Des voix du parti, et non des moindres, clament à tue-tête l’obligation, pour les révolutionnaires, d’éradiquer les ennemis de la révolution. Ou les opposants milliardaires. Le Premier ministre Ousmane Sonko lui-même a déclaré qu’il croisera le fer avec les médias et voix qui lui sont hostiles. C’est ainsi que Pastef compte gouverner : judiciariser son mandat qui s’effiloche lentement mais sûrement.
Face aux menaces et purges, il faut se réfugier dans ce repaire fabuleux qu’est l’Etat de Droit dont la Justice est l’un des piliers fondamentaux. Les institutions de ce pays ont montré, à plusieurs reprises, qu’elles peuvent résister aux foucades et desiderata des hommes qui les animent. Car, au fond, l’essence d’une institution politique réside dans sa capacité à s’imposer aux hommes qui l’ont pourtant créée ; les hommes, pour résoudre les problèmes protéiformes auxquels ils sont confrontés, créent les institutions, mais, in fine, celles-ci finissent par les apprivoiser. Il y a mille et une raisons d’attendre cela de nos institutions, pour que les Sénégalaises et Sénégalais soient protégés contre toute forme d’arbitraire.
Par Baba DIENG

