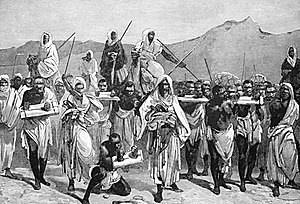Lors de la dernière émission Jaakarlo, un débat passionné a opposé deux visions du monde : celle de la rigueur économique et celle de la perception populaire.
Au cœur du désaccord, un terme aussi technique que mal compris : le «misreporting», concept défini par le Fonds monétaire international (Fmi) à l’article VIII, section 5 de ses statuts. Alors que Dr Seydou Bocoum a rappelé avec précision qu’il s’agit d’une transmission de données inexactes ou incomplètes à une institution financière internationale, volontaire ou non, ses interlocuteurs, Bouba Ndour et Malal Talla, ont préféré y voir une forme de mensonge d’Etat, voire de manipulation politique.
Ce malentendu n’est pas anodin. Il illustre une fracture grandissante entre la culture scientifique de l’économie et la culture émotionnelle de la politique. Comme le disait John Maynard Keynes, «la difficulté n’est pas de comprendre les idées nouvelles, mais d’échapper aux anciennes qui ont pris racine dans nos esprits».
Le Fmi définit le misreporting comme tout cas où un Etat membre transmet au Fonds des données erronées ou incomplètes, qu’il s’agisse d’une erreur involontaire ou d’une omission volontaire.
Ce n’est donc ni une insulte, ni un jugement moral, mais un constat technique, vérifié selon des procédures strictes.
Le Fmi s’intéresse notamment à la position extérieure et les réserves de change ; au niveau réel de la dette publique et para-publique, aux garanties de l’Etat envers les entreprises publiques et aux indicateurs de performance macroéconomique servant de base aux décaissements. Dans le cas du Sénégal par exemple, le débat sur le misreporting s’est cristallisé autour de la dette garantie des entreprises publiques comme Petrosen ou Senelec,
non pas parce que l’ancien régime «aurait menti», mais parce qu’il aurait communiqué des chiffres incomplets. Comme le rappelle l’économiste El Hadji Ibrahima Sall, «le Fmi n’est pas un tribunal politique : il évalue la cohérence des données, pas la sincérité d’un régime».
Ainsi, parler de misreporting n’est pas accuser un gouvernement de fraude, mais questionner la fiabilité du système statistique. C’est une question de méthode, non de morale.
Dans nos plateaux télévisés, le langage économique est souvent dévoyé par la recherche du spectaculaire. A Jaakarlo, le mot misreporting a été manipulé jusqu’à devenir un slogan, un mot choc vidé de sa substance. Or, comme l’écrivait Joseph Stiglitz, Prix Nobel d’économie : «Lorsque le débat économique devient émotionnel, la vérité devient secondaire, et les faits deviennent des armes.»
L’économie, pourtant, ne parle pas la langue de la rue parce qu’elle parle celle des indicateurs, des protocoles de mesure et des cadres juridiques internationaux. Réduire le misreporting à un «mensonge d’Etat» revient à effacer la frontière entre science et communication. De tels glissements fragilisent la crédibilité du pays. En 2002, par exemple, le Ghana avait été épinglé pour misreporting sur ses réserves de change. Le gouvernement de l’époque avait reconnu une «erreur comptable» et pris des mesures de correction sans qu’aucune crise politique n’en découle. Mais dans un pays où le débat public est polarisé, chaque mot devient une arme. Et quand l’émotion l’emporte sur la compréhension, la politique prend le dessus sur la science.
Le débat de ce jour-là n’était pas qu’un incident médiatique mais beaucoup plus, il était le symptôme d’une tension structurelle entre technocratie analytique et populisme médiatique. D’un côté, l’universitaire s’appuyait sur les textes, les normes et la rigueur des faits. De l’autre, les communicateurs traduisaient tout en termes de ressenti, d’émotion et de «vérité du peuple».
Mais la pédagogie ne consiste pas à tordre le sens des concepts pour les rendre populaires, mais elle devrait consister à les expliquer sans les trahir.
La vulgarisation n’a de valeur que si elle préserve la précision. Sinon, elle devient désinformation. Quand un animateur affirme que «le Fmi accuse le Sénégal de mensonge», il commet une faute grave, car il transforme un constat technique en condamnation politique, exposant ainsi l’Etat à des interprétations erronées sur la scène internationale.
En somme, le débat économique doit cesser d’être un spectacle pour redevenir un espace d’intelligence collective, fondé sur la responsabilité et la précision. Les économistes n’ont pas vocation à mépriser la rue, mais à éclairer la rue.
Les communicateurs, eux, doivent apprendre à informer sans déformer.
Comme le disait Cheikh Anta Diop, «la vérité scientifique n’a pas besoin d’être populaire pour être juste; elle doit être comprise pour être utile».
Quand la rue définit les concepts économiques, c’est la science qui recule, et avec elle, la rationalité du débat national.
Le misreporting n’est pas un mot pour diviser, mais un instrument de transparence qui permet de renforcer la confiance économique entre l’Etat et ses partenaires. Si l’émission Jaakarlo veut jouer pleinement son rôle dans la société sénégalaise, elle doit aider le public à distinguer le langage de la science de la rhétorique de la rue.
C’est à ce prix que l’intelligence deviendra souveraine, et que le Sénégal pourra construire un débat public digne de sa maturité démocratique.
En définitive, ce débat autour du «misreporting» révèle aussi les limites inquiétantes de la gouvernance économique actuelle dominée par des discours plus militants que techniques. Le parti Pastef, aujourd’hui au pouvoir, gagnerait à comprendre qu’administrer un Etat exige plus que des slogans : il faut des compétences, de la méthode et une compréhension fine des instruments économiques internationaux.
Au lieu de rejeter toute observation du Fmi comme une attaque politique contre l’ancien régime, il serait plus responsable de renforcer la fiabilité du système statistique national, de former les cadres et de consolider la transparence budgétaire. L’économie n’obéit pas à la volonté, mais à la rigueur. Ce n’est pas le Fmi qu’il faut accuser, c’est le travail qu’il faut accomplir. Le Sénégal n’a pas besoin d’un gouvernement qui se défend ; il a besoin d’un gouvernement qui produit des résultats. Le temps de la polémique doit céder la place au temps du travail, car seule la compétence construit la souveraineté.
Grand merci au Docteur Bocoum pour avoir rappelé que la vérité économique ne se crie pas, mais se démontre.
Amadou MBENGUE
Secrétaire général de la Coordination départementale de Rufisque,
Membre du Comité central et du Bureau politique du Pit/Sénégal