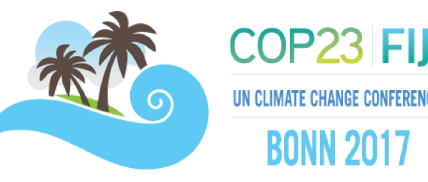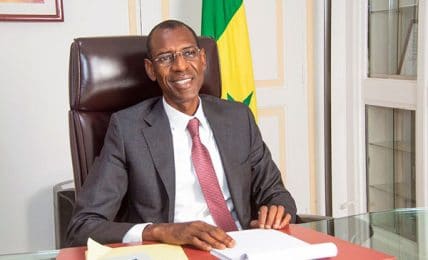49e : C’est la place qu’occupe le Sénégal au classement 2019 de Reporters sans frontières pour la liberté de la presse. En conférence de presse hier, le directeur bureau Afrique de l’Ouest de Rsf a fait savoir qu’il n’y a pas eu beaucoup de changements dans l’environnement de la presse au Sénégal. D’après Assane Diagne, pour progresser, il faudra accompagner les acteurs pour la dépénalisation des délits de presse.
Le Sénégal occupe la 49ème place du classement mondial de la liberté de la presse 2019 de Reporters sans frontières (Rsf). Notre pays gagne ainsi une place par rapport à l’année dernière où il était 50ème. Hier, lors de la publication de ce rapport, le directeur du bureau Afrique de l’Ouest de Rsf a fait savoir que le Sénégal occupe cette position parce qu’il n’y a pas eu beaucoup de changements dans l’exercice de la profession. D’après Assane Diagne, l’élément d’explication de «cette petite place» gagnée par le Sénégal doit être cherché dans l’adoption du Code de la presse et aussi le fait qu’il y a eu moins d’exactions sur les journalistes. Soulignant toutefois que l’environnement de la presse ne s’est pas amélioré, M. Diagne estime que le Code de la presse doit être révisé avant sa promulgation. «Il faut aller dans le sens de l’amélioration du Code de la presse qui n’est pas encore promulgué en dépénalisant les délits de presse. Autre chantier, c’est l’adoption d’une loi d’accès universel à l’information. Si le Sénégal s’engouffre dans ce chantier, on peut améliorer l’environnement de la presse», a-t-il indiqué.
Situation contrastée en Afrique subsaharienne
S’agissant de la situation en Afrique subsaharienne, les auteurs du rapport relèvent «la haine des journalistes, les attaques contre les reporters d’investigation, la censure notamment sur internet et les réseaux sociaux, les pressions économiques et judiciaire», mais aussi d’importantes évolutions en 2018 concernant la liberté de la presse. C’est ce qui fait dire à Rsf que les situations sont très contrastées en Afrique subsaharienne à l’image de la «Namibie (23e) qui regagne sa première place en Afrique, le Burkina Faso (36e) ou le Sénégal (49e) qui bénéficient de paysages médiatiques parmi les plus pluralistes et les trous noirs de l’information que sont l’Erythrée (178e) et Djibouti (173e), où aucun média indépendant n’est autorisé à travailler». Il y a également le cas de la Mauritanie qui «poursuit sa chute vertigineuse au classement faute d’avoir remis en liberté le blogueur défendu par Rsf, Mohamed Cheikh Ould Mohamed Mkaïtir, initialement condamné à la peine de mort pour apostasie, avant de voir sa peine commuée à deux ans de prison en novembre 2017». Rsf qui renseigne qu’il est «libérable depuis un an et demi» souligne que le blogueur est maintenu en détention dans un lieu tenu secret par les autorités pour des raisons de sécurité, selon la version officielle.
Dans son rapport, Rsf informe aussi que l’esclavage, une pratique illégale, mais toujours à l’œuvre dans le pays, demeure un sujet tabou et a valu «pour la deuxième année consécutive à un photoreporter étranger qui s’y intéressait d’être expulsé de la Mauritanie en 2018». D’après Rsf, comme en 2017, 22 pays sur 48 sont classés en rouge (situation difficile) ou en noir (situation très grave) en Afrique subsaharienne. La Rdc (154e) est le pays du continent dans lequel Rsf a enregistré le plus d’exactions en 2018. Selon le rapport, «un réalisateur et un caméraman ont dû fuir leur domicile pour échapper à leurs assaillants après avoir diffusé un documentaire sur les expropriations menées sur un terrain revendiqué par l’ex-Président Joseph Kabila».
La Gambie gagne 30 places
Néanmoins, à côté de ce tableau sombre, de fortes progressions ont été constatées notamment avec des pays comme la Gambie (92e) qui «gagne 30 places et confirme l’excellente dynamique engagée depuis le départ du dictateur Yahya Jammeh». Ce bond se justifie par la création «de nouveaux médias, des journalistes revenus d’exil et la diffamation reconnue anticonstitutionnelle». Abondant dans le même sens, le journaliste gambien Pape Sène, codirecteur du journal The Point, informe que d’importants progrès ont été notés. M. Sène informe que la radio d’Etat n’osait pas faire de revue de presse alors que maintenant c’est possible. De même, il souligne que les organes de presse privés n’étaient pas autorisés à couvrir des évènements de la présidence de la République, ni ceux de l’opposition. Ce qui n’est plus le cas avec le nouveau régime. «On a les mains libres, on fait notre travail sans hésitation et avec professionnalisme», a-t-il témoigné. Outre la Gambie, il y a l’Ethiopie (110e) «abonnée aux abîmes du classement» qui «effectue un bond spectaculaire de 40 places à la faveur d’un changement de régime». Dans ce pays, d’après Rsf, il est noté la «libération de journalistes et de blogueurs, la fin de l’interdiction de plusieurs centaines de sites et de médias, des réformes en cours du cadre légal particulièrement répressif contre les journalistes». Au niveau mondial, la première place est occupée par la Norvège, ensuite viennent respectivement la Finlande (2e), la Suède (3e), les Pays Bas (4e), le Danemark (5e).
dkane@lequotidien.sn