Un Kocc peut en cacher un autre
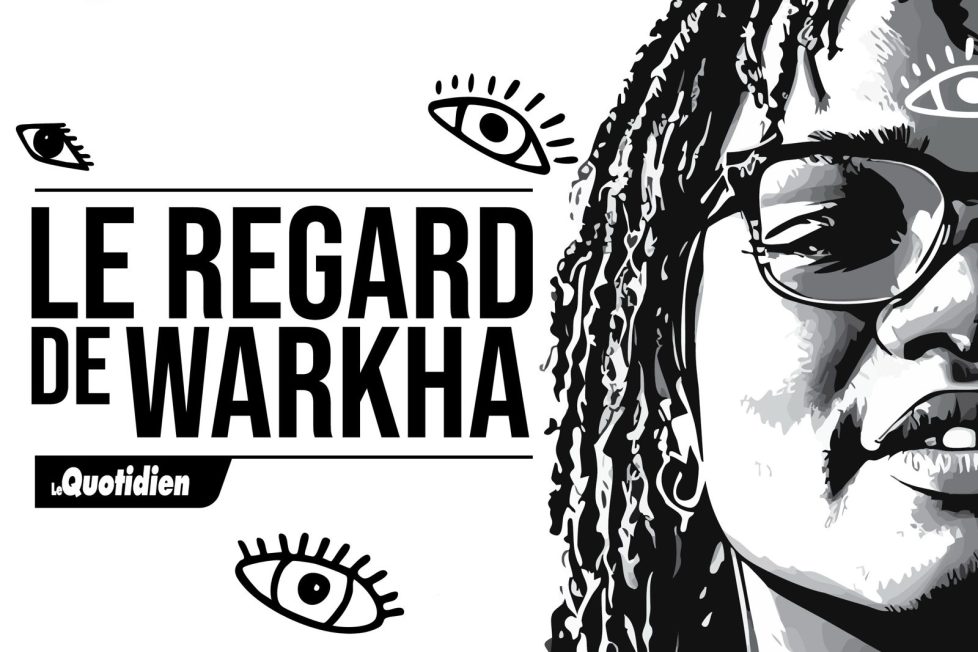
Au Sénégal, le nom de Kocc Barma évoquait jadis la sagesse. Aujourd’hui, il dérange. Il incarne à lui seul la fracture entre l’héritage d’un philosophe populaire et les dérives d’une société où l’anonymat numérique libère les instincts les plus destructeurs.
D’un côté, Kocc Barma Fall, penseur du XVIIe siècle, dont les maximes traversent les âges comme des repères éthiques. De l’autre, El Hadj Babacar Dioum, qu’on accuse d’être «Kocc», personnage de l’ombre devenu tristement célèbre pour avoir orchestré la diffusion massive de contenus intimes à des fins d’extorsion de fonds, de chantage ou de vengeance.
Lire la chronique – Mia Guissé et le théâtre de la morale sélective
L’un prônait la décence et la vérité. L’autre a fait de l’humiliation une économie. L’un s’adressait aux puissants pour éveiller les consciences. L’autre a manipulé les plus vulnérables dans le silence. Deux époques. Deux logiques. Deux visages. Un seul nom.
Et c’est là que le paradoxe s’installe. Pourquoi choisir le nom de Kocc Barma pour se dissimuler ? Pourquoi chercher l’anonymat tout en s’abritant derrière une figure aussi emblématique ? Ce n’est pas un simple pseudonyme. C’est un détournement. En empruntant un nom chargé de sens, Babacar Dioum a brouillé les repères. Il a mis une légitimité culturelle au service d’une entreprise de déshumanisation.
Lire la chronique – Le viol, un crime toujours banalisé
Aujourd’hui, lorsqu’on entend «Kocc», ce n’est plus la sagesse du Cayor qui surgit, mais l’image d’un scandale numérique. Le nom s’est chargé d’une nouvelle mémoire, forgée par les pixels de la honte et du voyeurisme. Ce glissement sémantique affecte l’imaginaire collectif. Il altère les repères des jeunes générations, qui ne sauront peut-être plus ce que ce nom représentait avant l’ère numérique.
Certes, il faut aussi reconnaître que certaines maximes attribuées à Kocc Barma véhiculent des représentations sexistes. Je ne saurais fermer les yeux sur cela. Mais ce que l’histoire a retenu de lui, c’est surtout une pensée exigeante, critique, ancrée dans la communauté. Ce que Babacar Dioum a incarné, en revanche, c’est une faillite morale et sociale.
[themoneytizer id= »124208-2″]
Agé de 38 ans, soupçonné d’être à la tête des sites Seneporno et Babiporno, Babacar Dioum a été interpellé après des milliers de plaintes et des enquêtes ouvertes depuis 2018, qui ont conduit à la découverte de près de 9000 fichiers à caractère intime sur son ordinateur. Il est décrit comme un homme discret, mais extrêmement organisé, utilisant ses compétences numériques pour administrer une plateforme tentaculaire. Mais peut-on vraiment parler d’un homme seul ?
Non. Car si Kocc a prospéré, c’est aussi parce que nous l’avons collectivement permis. Parce que nous l’avons nourri. C’est la société elle-même qui lui a offert matière à publier, à faire peur, à humilier. Il ne courait pas après les vidéos : elles venaient à lui. Il ne cherchait pas les victimes : elles lui étaient livrées, parfois volontairement, parfois par trahison. Il n’a pas eu à tendre des pièges : nous avons bâti la scène pour lui.
Combien ont transmis des vidéos par vengeance ? Combien ont payé pour se protéger ? Combien ont regardé sans dénoncer ? Combien se sont tus par peur ou par cynisme ?
Lire la chronique – Quand la vie privée devient un live sur TikTok
Et chaque fois, une femme. Toujours une femme. Sur les 9000 fichiers retrouvés, une majorité concernait des femmes jeunes, filmées, traquées, exposées. Des lycéennes, des étudiantes, des travailleuses, parfois mineures. Filmées parfois à leur insu, parfois dans des moments de confiance intime, toujours trahies.
Il est impossible de parler de cette affaire sans nommer l’injustice genrée qu’elle révèle. Car dans ce système, ce sont les femmes qui paient le prix fort. Ce sont leurs corps qui sont marchandisés. Leur intimité qui est violée, leur silence qui est exigé, leur honte qui est monnayée.
Ce système est rendu possible parce qu’il s’inscrit dans un imaginaire social qui considère encore que les femmes doivent être surveillées, punies, exposées dès lors qu’elles s’écartent des normes de respectabilité. Et c’est ce même imaginaire qui fait du regard masculin une instance de contrôle, de punition, parfois de jouissance morbide.
Lire la chronique – La santé mentale : ces maux que l’on tait
Mais cela ne doit en rien dédouaner Babacar Dioum. Il a détruit des vies, sans hésitation, en toute conscience, avec une froideur qui glace. Et ce qui a choqué, c’est aussi son apparence. Un homme à l’allure tranquille, effacé, presque «ordinaire». Ce visage, cette posture en ont désarçonné plus d’un. Parce que dans notre société, les apparences valident quand les alertes dérangent. On accorde plus de crédit à celui qui inspire confiance par son calme qu’à celle qui crie qu’elle est en danger. C’est aussi pour cela que tant d’hommes se cachent derrière des airs de respectabilité pour mieux commettre leurs forfaitures. C’est ce masque social, cette hypocrisie genrée, qui permet à tant d’agresseurs d’agir longtemps sans être inquiétés.
Babacar Dioum n’est pas une anomalie. Il est le reflet d’un système défaillant. Il incarne une logique sociale, technologique et culturelle qui rend possible et parfois même rentable la destruction d’autrui pour satisfaire des pulsions de pouvoir, de revanche ou de profit.
Ce n’est pas la technologie qui est coupable. Ce sont les regards que nous portons et les usages que nous en faisons. A chaque clic, il y a un choix humain. A chaque algorithme qui privilégie le sensationnel, il y a une intention derrière. A chaque serveur qui héberge l’indicible, il y a une tolérance implicite. Et à chaque silence institutionnel, il y a une démission politique. Ce n’est pas le numérique qui déshumanise : c’est l’absence d’éducation à l’éthique de l’image, le vide juridique autour de la vie privée, l’indifférence face aux violences faites aux femmes. La loi sénégalaise, bien que dotée depuis 2008 d’une Commission des données personnelles, peine encore à offrir une protection réelle contre la cybercriminalité. Le «revenge porn», les menaces de diffusion, les chantages sexuels numériques ne sont pas encadrés par des textes clairs et dissuasifs. Le Droit est lent, flou, et rarement appliqué de manière rigoureuse. Les victimes se heurtent à des procédures complexes et à une absence de cadre législatif spécifique. Ce déficit juridique, conjugué au silence social, crée un système où l’impunité prospère, où l’intimité devient une marchandise et où l’humiliation se convertit en audience.
[themoneytizer id= »124208-19″]
Et si nous en sommes arrivés à ce point, c’est aussi à cause de ce plaisir malsain à voir les autres tomber. Ce goût du buzz. Ce besoin de dominer en détruisant ne vient pas de nulle part. Il se nourrit d’un imaginaire collectif façonné par des années de banalisation de la violence symbolique, par une culture du scandale qui récompense l’exposition de l’intime, et par un système de pouvoir où la chute de l’autre devient un divertissement. Si nous n’éprouvions pas autant de satisfaction à juger, à humilier, à condamner sans procès, parfois même sans preuve, aucun Kocc n’aurait eu ce pouvoir. Car ce pouvoir, il lui a été confié par nos clics, nos silences, nos complicités.
Lire la chronique – Coumba Gawlo : l’étoile qui m’a élevée
Aujourd’hui, les langues se délient. D’autres noms tombent. L’affaire dépasse les serveurs et les Ip. Elle éclaire une érosion des liens sociaux. Comme cette jeune fille qui découvre que le maître chanteur n’est autre que son propre frère. Une histoire réelle, bouleversante, mais tristement révélatrice : même au sein des familles, la frontière entre protection et trahison se confond.
Un Kocc peut en cacher un autre. Mais derrière celui que nous dénonçons aujourd’hui, c’est aussi nous-mêmes qu’il faut interroger. Et peut-être qu’un jour, lorsque nous prononcerons à nouveau le nom de Kocc, ce ne sera plus celui de l’infamie, mais celui de la résistance retrouvée. Peut-être qu’alors, le vrai Kocc Barma Fall ne se retournera plus dans sa tombe.
Par Fatou Warkha SAMBE

3 Comments

Le phénomène kocc au delà de son visage sordide nous interpelle nous senegalais(es). En effet, n’eut été l’installation de la dépravation des mœurs dans notre société dis- je, Kocc n’aurait pas existé et prospéré. Des individus hommes et femmes ont délibérément ; oui délibérément alimenté le « commerce » de kocc.
Le seul point positif du scandale kocc est qu’il met à nu la dégénérescence d’une frange importante de notre société . Si, l’on y prend garde, notre pays risque une descente vers une société » nue » , sans vergogne ni foi. N’y sommes nous pas de plain pied ?
Le pire est tel que revelle la question kocc , c’est le segment essentiel d’une société qui est concerné en locurence les femmes.
Toute cette hideuse affaire se conjugue hélas au féminin.
Un excellent text, pertinent et exhaustif. Il braque un projecteur sur les tards de notre société. Nous sommes tous coupables. De véritables monstres apparaissent régulièrement, font le buzz et disparaissent. La vie continue.
L’hypocrisie est le caractère le mieux partagé.
Bravo pour votre article de grande qualité