Mimi Moy Aïda
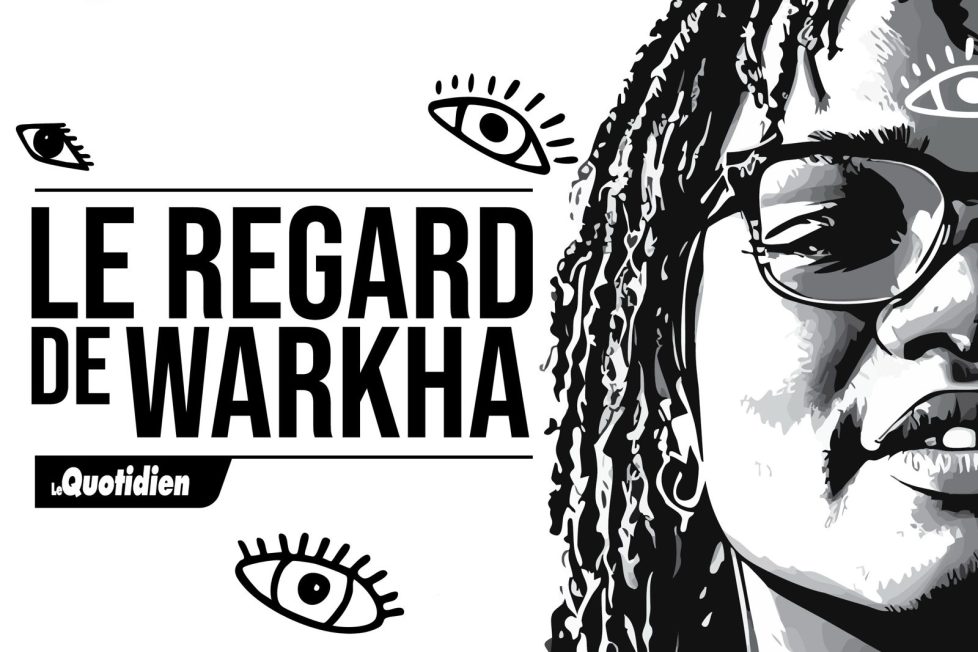
Pour saisir la portée de ce moment politique, il faut d’abord lever les yeux au-delà des polémiques et regarder le pays tel qu’il est aujourd’hui : fatigué, inquiet, éprouvé. Le Sénégal traverse une période où chaque foyer ressent le poids des difficultés, où les urgences s’accumulent plus vite que les solutions, et où l’espoir, qui avait porté tant de citoyens vers les urnes, se heurte désormais à une réalité bien plus rude. C’est depuis ce point de vérité, et non depuis les querelles qui saturent l’espace médiatique, que notre réflexion doit commencer.
Dix-huit mois après l’installation du nouveau gouvernement, le Sénégal traverse une zone de turbulence dont personne ne voit encore l’issue. Et comme si cette pression économique ne suffisait pas, le pays doit affronter d’autres urgences majeures : l’épidémie de Mpox et la Fièvre de la vallée du Rift, particulièrement virulentes dans les régions de Matam, Podor et Saint-Louis, affectant des familles, des zones agricoles, des marchés locaux entiers ; la libération soudaine d’anciens détenus politiques, innocents pourtant traînés dans la boue avant leur arrestation ; sans oublier la situation sécuritaire au Mali dont les répercussions devraient pousser le Sénégal à clarifier une stratégie de protection de ses frontières et de soutien aux régions vulnérables.
Face à cette accumulation de crises d’ordres sanitaire, social et sécuritaire, un fil rouge apparaît nettement : le pays est sous pression de tous côtés, et chaque urgence mérite une attention cohérente et structurée.
Dans n’importe quel contexte, ces défis seraient au cœur du débat public. Pourtant aujourd’hui, malgré leur importance capitale pour l’avenir du pays, ils se retrouvent relégués au second plan, avalés par des querelles qui ne devraient occuper qu’une place marginale.
En observant l’agitation politique de ces derniers jours, un malaise s’installe : pendant que les urgences se multiplient, l’attention collective se déporte ailleurs. Et je dois l’avouer : jamais je n’aurais imaginé ressentir une gêne à voir deux femmes occuper autant l’espace public. Non pas parce qu’elles ne le méritent pas, mais parce que je déplore la manière injuste et violente dont elles sont projetées dans l’arène : insultes, attaques personnelles, comparaisons déplacées…
Il n’est pas normal qu’on cherche à donner un visage féminin à une divergence politique qui n’a jamais été la leur, et qui dépasse largement ce que l’on présente au public. Cette volonté de simplifier les tensions en les incarnant dans des figures féminines relève d’un réflexe ancien, presque automatique.
Mme Aminata Touré et Dre Aïda Mbodj partagent bien plus que ce que l’on veut leur opposer. Elles ont en commun d’avoir évolué dans un espace politique construit par et pour les hommes, un univers où la parole féminine est parfois tolérée mais rarement acceptée, où leurs compétences sont scrutées comme des exceptions et leurs réussites vécues comme des intrusions. Elles ont affronté les mêmes résistances, les mêmes soupçons, les mêmes tentatives de les réduire à leur loyauté supposée envers telle ou telle figure masculine. Elles ont appris à naviguer sur un pouvoir profondément masculinisé, souvent sexiste, où il faut deux fois plus de courage pour être respectée et trois fois plus de résultats pour être reconnue. Malgré cela, elles se sont tenues debout avec dignité, avec force, avec conviction.
Dans les attaques dont Aminata Touré est victime, rien, absolument rien, n’a porté sur ses compétences. Pas un argument, pas une critique de fond, pas une remise en question de son parcours. Car il faut le rappeler : sans Aminata Touré, la victoire du camp présidentiel n’aurait peut-être pas eu la même allure. Elle fait partie de celles et ceux qui ont rendu ce succès possible, souvent au péril de leur sécurité, presque toujours au détriment de leur sérénité.
On lui reproche d’avoir été désignée coordonnatrice d’un mouvement, une responsabilité que certains utilisent désormais pour lui faire porter les tensions qui traversent les sphères du pouvoir. Est-ce juste, est-ce cohérent, est-ce acceptable de transformer une décision politique qui relève du chef de l’Etat en faute personnelle imputée à une femme qui, elle, n’a fait que répondre à un appel au service ?
Ce qui se joue ici n’a rien à voir avec ces femmes. Mais comme toujours, on tente de les placer à l’intersection des tensions pour en faire les symboles d’un désordre qu’elles n’ont pas créé.
Dre Aïda Mbodj et Aminata Touré incarnent à elles deux cette force tranquille que la politique refuse trop souvent de reconnaître.
Toutes deux se sont engagées avec détermination pour l’arrivée au pouvoir du Président Diomaye, souvent dans l’ombre, toujours avec une force et une constance exemplaires. Leur parcours, leur expérience et leur sens du sacrifice dépassent de loin celui de nombreux membres actuels du gouvernement. Elles méritent toutes deux n’importe quel poste dans ce pays, tant leurs compétences, leur courage et leur loyauté envers la Nation sont incontestables.
Et il faut aussi, à l’endroit des dirigeants, rappeler que ce n’est pas le moment des querelles, ni des divergences exhibées. La situation économique du pays ne nous en donne pas le privilège. Gouverner, ce n’est pas seulement occuper une chaise : c’est un don de soi, un art du compromis, une capacité à s’oublier au profit de la population qui vous a fait confiance. Une population sous les eaux, malade, désespérée, affamée, qui attend bien autre chose que des affrontements inutiles. Elle attend du courage, de la clarté et un sens du devoir.
Nous attendons toujours le Sénégal qui nous a été promis lors des élections.
Par Fatou Warkha SAMBE

