Condamnation
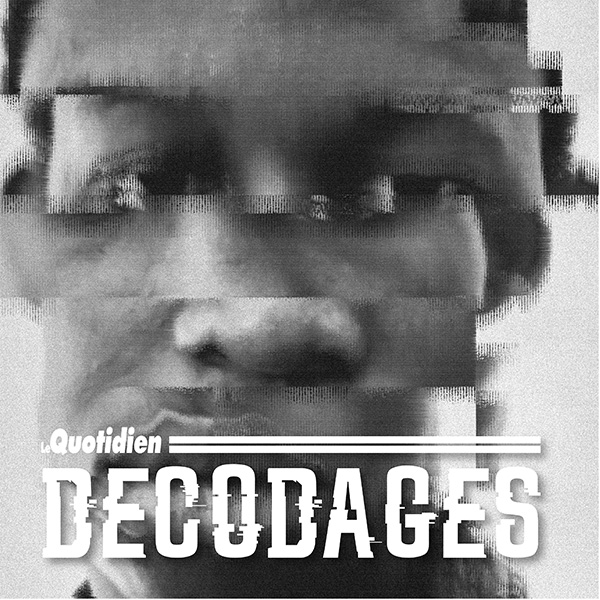
L’écrivain Amadou Elimane Kane a l’habitude de dire que «notre patrimoine littéraire est un espace dense de créativité et de beauté». Les Lettres sénégalaises, prodigieuses et dynamiques, constituent un univers de culture à même de nous inciter à inventer de nouveaux imaginaires, lesquels pourront nous sauver de l’offensive de l’inculture. Soit dit en passant, j’ai déjà entendu un polémiste, chercheur à l’œuvre scientifique douteuse, dire qu’un pays sous-développé comme le nôtre n’a pas besoin de roman, mais de travail. C’est une contrevérité d’autant plus écœurante qu’elle émane d’un «intellectuel». J’ai lu, comme préfacier, Condamnation (Editions Téranga Sénégal, 2025) de mon ami Mama Ndiaw Goumbale -cette figure de l’excellence. C’est le deuxième opus de l’écrivain.
Lire la chronique – Il faut défendre la République
Parler d’un roman est un exercice palpitant. Car l’univers romanesque est ce lieu merveilleux, ce mensonge enchâssé dans la vérité, où l’homme a l’opportunité de s’éduquer, de s’aventurer dans le labyrinthe de la nature humaine, de rencontrer des amis de toujours ; mais aussi il a le malheur d’être condamné sans appel. Ecrire un bon roman demande du talent. Et ce romancier, juriste de formation, est talentueux.
[themoneytizer id= »124208-2″]
Les premières pages du roman, qui racontent la brillante réussite de Safia à l’université, n’ont rien d’une condamnation. Elles laissent même présager un avenir radieux. Mais c’est une entourloupe : on referme ce livre passionnant avec un serrement de cœur…
Le romancier, et c’est là une manifestation éloquente de son talent, nous entraîne à notre insu dans son monde -un monde dont la cruauté et la froideur des relations humaines mettent le lecteur en face de lui-même.
Condamnation condamne à une peine salvatrice : celle de repenser, et de rafistoler, la relation que l’on entretient avec soi-même et avec les autres.
Mama a fait preuve de pragmatisme dans l’écriture. Sans fioritures. Tel un peintre, il s’est contenté de produire une fresque qui interroge, avec lucidité et courage, sa société. L’environnement du roman est concret, défiant ainsi le réel. Le récit, vif et maîtrisé, avec ses personnages merveilleusement bien construits et attachants, est concis. L’intrigue -qui est parfois mâtinée de sensualité et, surtout, de tragédie- prend le lecteur aux tripes, grâce à une narration limpide et vibrante.
Lire la chronique – La farce tragique du Premier ministre
Le romancier a compris que la littérature -surtout le roman- est une cérémonie qui initie le lecteur aux secrets les plus ésotériques de l’existence. «L’homme, écrit-il, est condamné». Dès l’enfance, la société nous inculque une langue identitaire, des valeurs, des croyances, des passions, une appartenance ; elle nous raconte aussi ses récits, ses imaginaires, sa geste et, dans certains cas, ses déconfitures, ses humiliations.
Adulte, l’homme est condamné à vivre avec tout ce qu’il a reçu, pour se donner une identité fondamentale ou, et c’est ce qui est souhaitable, une identité multiple et riche des apports féconds qui l’ont constituée. Chaque société, enseigne Michel Foucault, a ses «régimes de vérités», c’est-à-dire les discours et savoirs qu’elle accepte et protège, et les autres, plus iconoclastes, qu’elle réprime sévèrement. L’écrivain décrit parfaitement cette réalité en ces termes : «Il y a la condamnation sociale, celle qui ne s’exprime pas dans un tribunal mais dans les regards, dans les rumeurs, dans les silences. Une forme d’exclusion plus subtile, plus cruelle.»
Lire la chronique – Le Dérèglement du monde
L’histoire de Safia est rocambolesque. Trahie par une «amie» -Maria avait-elle le choix ?-, puis livrée aux ogres de sa propre famille -Grégoire et Maurice (Le Boss)-, son destin témoigne de la méchanceté de l’être humain, des trahisons douloureuses, surtout celles qui émanent des gens que l’on considère comme des amis, mais aussi de l’incroyable capacité que nous avons à résister aux affres de la vie. Soukeyna, l’amie fondamentale, et Maître Yvette Gomis, l’avocate dévouée et humaniste, sont là pour nous intimer, solennellement, de ne jamais désespérer de l’homme. Il y a toujours des opportunités salvatrices à exploiter, pour s’extirper de la société d’inimitié. Safia, malgré les ténèbres qui ont rythmé et empoisonné une bonne partie de sa vie, a su retrouver la lumière, la vie, sa fille miraculée, l’amour de Daouda –l’homme providentiel qui avance masqué. Enfin, le bonheur…
[themoneytizer id= »124208-19″]
L’écriture est une manière de rouvrir des imaginaires calfeutrés. Il faut dire qu’en raison des avancées technologiques spectaculaires, nous n’avons plus de temps à consacrer à la futurologie, au devenir, à l’utopie de créer les conditions d’un monde en train de se réaliser. Les écrivains, eux, sont des marchands de rêves, d’utopies créatrices et émancipatrices. Face aux désastres de notre époque -l’obsession de tout fructifier au point d’anéantir les futurs de notre monde, la menace de ce capitalisme destructeur de l’homme, le fondamentalisme religieux, l’exacerbation des «identités meurtrières», la bestialité des hommes, la régression des mentalités, les condamnations sociales, l’intolérance, la violation des droits des minorités et des femmes, etc.-, ils nous montrent qu’il existe des possibles que nous pouvons féconder, si nous voulons échapper à la destruction de notre monde et du vivant.
Le roman de Mama, et fort heureusement, est venu nous rappeler ce qui fait de nous des humains, et non des archanges dont la mission fondamentale doit être, pour parler comme Frantz Fanon, la «montée en humanité».
Lire la chronique – Le sucre de la Css ne doit pas ghettoïser Mbane
L’un des messages forts de ce texte est aussi la capacité incroyable du romancier à faire cohabiter deux mondes : le monde des souffrances de la condamnation et celui de l’amour. Celui-ci, même dans le désarroi, doit être présent. Car, écrit-il, «au fleuve des condamnations, là où l’on s’attend à la noyade des liens, peuvent éclore, contre toute attente, des braises d’amour». Dans un monde où la violence et la guerre sont sanctifiées, le romancier nous montre que l’amour -qui est détachement, oubli, pardon, acceptation de l’Autre, etc.- peut diminuer, voire éradiquer nos «politiques de l’inimitié».
Ce roman -puissant, émouvant, envoûtant, tragique, mais profondément humaniste, écrit avec un soin particulier apporté à la langue et surtout au style, poétique- annonce un écrivain qui a un bel avenir dans le gotha littéraire sénégalais.
Par Baba DIENG

