Nous sommes tous Soudanais
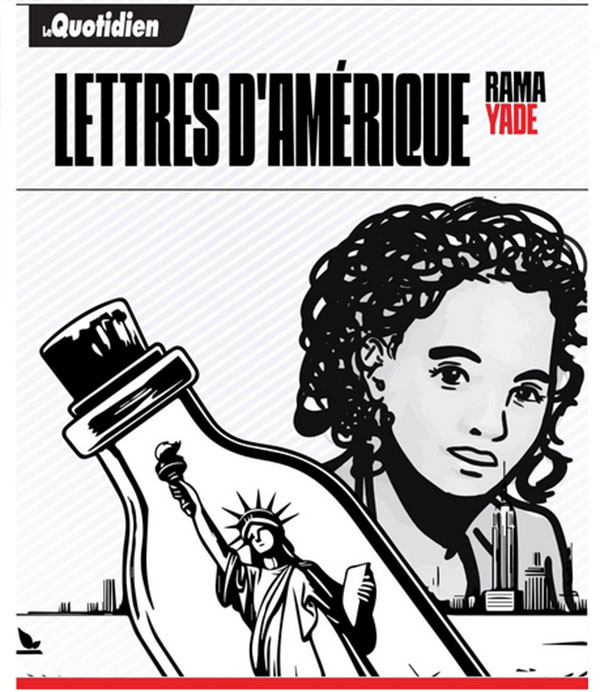
Dans la torpeur de l’été, il serait tentant d’oublier le Soudan au profit des crises du Moyen-Orient et de la guerre en Ukraine. Le génocide ne connaît pourtant pas de trêve.
La plus grave crise humanitaire au monde
Dans un pays en lambeaux où il n’existe aucun recensement systématique des morts, les estimations, après 14 mois de guerre civile, tournaient autour de 150 000. Le conflit a fait 13 millions de déplacés dont une moitié est réfugiée dans les pays voisins. Dans un pays de 48 millions d’habitants, 25 millions de Soudanais sont confrontés à une famine aiguë et 730 000 enfants à une malnutrition sévère, quand le cholera ne frappe pas, comme en témoignent les 2300 décès répertoriés en un an par le ministère soudanais de la Santé. Sans hôpitaux, ni eau potable, le Soudan, avant Gaza et Kiev, est la plus grave crise humanitaire au monde.
Ce bilan morbide est d’abord celui des belligérants qui se livrent une lutte féroce depuis avril 2023 -les Forces armées soudanaises (Fas) sous le commandement du Général Abdel Fattah al-Burhane et la milice paramilitaire des Forces de soutien rapide (Fsr) sous celui de Mohamed Hamdane Daglo dit Hemedti. Ces deux généraux avaient pourtant fait cause commune pour tirer profit de l’extraordinaire élan populaire qui avait chassé du pouvoir le vieux dictateur Omar el-Bechir, le 11 avril 2019.
Nommer le génocide
Désormais, s’adonnant à des crimes de guerre et crimes contre l’humanité, ils procèdent à des enlèvements d’enfants, des viols de masse, de l’esclavage sexuel et des incendies de village. Comme en 2001, où il faisait figure de premier génocide du 21ème siècle avec la brutale campagne de mort des Jenjawids qui aura causé 300 000 morts en quatre ans, le Darfour, situé dans l’Ouest du Soudan, est redevenu ce long martyr soudanais. Selon un rapport de Human Rights Watch datant de mai 2024, les Fsr ont multiplié les attaques dans le Darfour occidental, faisant déjà des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés. Les violences qui ciblent les Massalit et autres communautés non arabes s’apparentent, selon l’organisation, à du nettoyage ethnique. Mais beaucoup ont déjà lâché le terme de «génocide». Le rapport reprend le témoignage d’un garçon de 17 ans qui décrit le meurtre de 12 enfants et 5 adultes de plusieurs familles : «Deux membres des Rsf… ont arraché les enfants à leurs parents et, comme les parents se sont mis à crier, deux autres membres des Rsf ont tiré sur les parents et les ont tués. Puis ils ont empilé les enfants et leur ont tiré dessus. Ils ont jeté leurs corps dans la rivière et leurs affaires après eux.»
L’apathie des Africains
Face à ces atrocités, la passivité de la Communauté internationale interroge. A commencer par celle des Africains. Avec ses communiqués dérisoires, c’est une Union africaine impuissante qui se contente, depuis deux ans, d’appels à la cessation des combats ou d’exprimer sa préoccupation face à la crise humanitaire, sans qu’on n’ait jamais vu un seul chef d’Etat africain sur le front à Khartoum ou auprès des victimes à El Geneina.
Dans un communiqué à l’occasion des deux années de conflit, Amnesty International relevait que «le monde a seulement contribué à hauteur de 6, 6% des fonds nécessaires pour faire face à la catastrophe humanitaire qui sévit dans le pays». Exécution de l’embargo sur les armes, augmentation de l’aide humanitaire d’urgence, justice pour les victimes : telles sont les recommandations habituellement avancées par les observateurs. Il en est une néanmoins sur laquelle le Conseil de sécurité des Nations unies comme les médiateurs gardent un silence pudique, si ce n’est gêné : le soutien armé dont bénéficient les belligérants de la part des puissances régionales.
Le cynisme des puissances régionales
Egypte, Iran, Turquie, Chine, Emirats arabes unis, voire la Russie et l’Ukraine : ils se sont tous penchés sur le Soudan pour prendre parti sur le terrain, pour les Fas ou pour le Fsr. Certains se rendent complices du génocide en cours. Drones, or, renseignements militaires, mercenaires : tout est bon pour intensifier la violence de la guerre, tout en niant y participer. Sécurisation des eaux du Nil, maîtrise des 800 kilomètres des côtes soudanaises de la Mer rouge, contrôle des ressources minières de l’Est du Soudan : leurs motivations sont nombreuses. Le Soudan accuse aussi le Tchad et le Kenya d’être parties prenantes du conflit, comme en a témoigné Ali Youssef, le ministre soudanais des Affaires étrangères, lors d’une conférence sur le Soudan coprésidée par la France et le Royaume-Uni le 15 avril dernier, à l’occasion du deuxième anniversaire du déclenchement du conflit. Evidemment, l’enchevêtrement des intérêts géostratégiques dans la région, et au-delà, explique la passivité de la Communauté internationale. Comment les Etats-Unis pourraient-ils faire pression sur Abu Dhabi que le Soudan a traduit devant la Cour internationale de justice, sachant que les Eau sont indispensables dans leur stratégie moyen-orientale ?
Quand les Noirs dominaient l’Egypte
Il faut dire que le Soudan n’est pas un pays comme un autre. Avec ses huit frontières et sa position géostratégique entre le Sahel et la Corne de l’Afrique, le pays est issu d’une histoire de plus de 5000 ans qui en a fait un carrefour de cultures, de religions et de civilisations négro-africaines, largement antérieures à l’islam, quel que soit l’acharnement avec lequel le pouvoir islamiste de Bechir s’était évertué à effacer ces racines si typiquement africaines. D’ailleurs, le mot Soudan signifie littéralement «le pays des Noirs».
Il y eut d’abord les trois royaumes africains de Koush qui s’étendront jusqu’aux confins d’Assouan pendant plus de deux millénaires, puis, du IVe siècle avant J.C au IIIe siècle après J.C, le royaume de Méroé au Nord du Soudan actuel. L’exploit final viendra du puissant royaume soudanais de Napata, le dernier royaume païen avant l’arrivée des chrétiens et des musulmans, mais aussi un rival de l’Egypte antique, qu’il finit par conquérir et gouverner. Ses souverains montèrent sur le trône égyptien : la XXVe dynastie des pharaons était donc soudanaise. Comme le relève Abdelwahid El-Nour, «cet empire soudano-égyptien prendra fin avec la conquête de l’Egypte par les Assyriens au VIIe siècle, et se repliera alors sur Méroé, le dernier royaume soudanais, qui tombe au quatrième siècle après J.C, sous les coups de rois chrétiens d’Ethiopie. Trois royaumes chrétiens nubiens émergèrent : Nobatia, Makuria et Alodia. Makuria fut le plus puissant, maintenant son indépendance face aux Arabes musulmans pendant plusieurs siècles. La christianisation des petits royaumes nubiens s’achève avec la conquête arabe du Soudan à la fin du VIIe siècle».
Le Peuple en recours
C’est ce Soudan millénaire qui est aujourd’hui piégé par un jeu régional dangereux et menacé de partition, avec le risque d’une déstabilisation du continent africain, mais aussi de l’exceptionnel héritage culturel soudanais dont aucune des puissances régionales ou globales de l’heure, à l’œuvre pour l’engloutir, n’a jamais pu égaler la sophistication. Sans doute ce legs explique-t-il la puissance politique du Peuple soudanais -seul recours à ce stade devant l’apathie internationale.
Directrice Afrique
Atlantic Council
Aux lecteurs
A la suite d’un aménagement technique, les «Lettres d’Amérique» sont devenues mensuelles. La chronique paraît désormais le premier jour ouvré du mois.
La Rédaction

