Prendre à bras-le-corps la menace terroriste
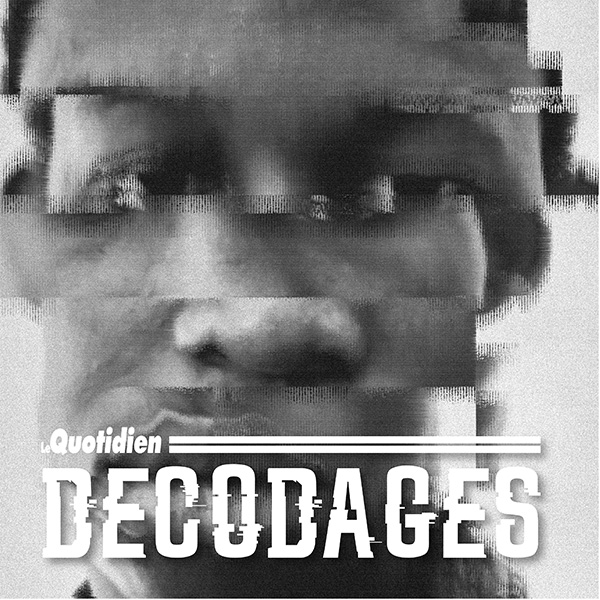
La transnationalité des menaces est sans doute l’une des conséquences les plus néfastes de la mondialisation. Ou de la globalisation, selon l’acception économique que les Américains donnent à ce concept. Avec ce phénomène irréversible que le géographe britannique David Harvey appelle la «compression du temps et de l’espace», aucune région du monde n’est à l’abri des menaces, quelle que soit la sécurité de son repaire. La conception classique de la guerre -qui postule que les belligérants soient deux ou plusieurs Etats dotés d’armées régulières opérant dans des territoires bien définis (à l’exception tragique de la Grande Guerre)- est vieillotte, puisque les acteurs de la violence sont devenus transnationaux et multiples. C’est ce qui justifie, dans la théorie en Relations internationales, toute la pertinence du concept de sécurité globale : la nature protéiforme et diffuse des menaces exige que les réponses concertées des Etats soient aussi protéiformes.
Lire la chronique – La loi des loubards
Les années 1970 coïncident avec l’échec cuisant du nationalisme panarabe, symbolisé par les déconfitures du Raïs Gamal Abdel Nasser, et la montée du fondamentalisme musulman. Jusqu’en 2011 -année qui marque le début des opérations terroristes de grande envergure dans le Sahel-, le terrorisme traduisait l’opposition frontale et meurtrière entre le monde arabe et l’Occident. L’élargissement des tentacules de cette menace a pris les pays africains au dépourvu : le terrorisme est venu s’ajouter aux grands problèmes locaux sans crier gare. Il faut dire aussi que la chute du régime libyen à la même période a été un élément accélérateur de cette spirale de violence, car elle a occasionné l’entrée massive de kalachnikovs, obus, tanks, lance-roquettes… provenant des arsenaux à ciel ouvert de la Jamahiriya (la République des masses), notamment dans les parties septentrionales du Niger et surtout du Mali.
Il existe, dans les pays minés par le terrorisme, une dynamique constante de désinstitutionalisation et d’informalisation du pouvoir politique, rompant ainsi avec l’idéal type wébérien de l’Etat. La perte progressive du monopole de la violence par l’institution étatique s’est soldée par une dévolution graduelle -mais réelle- de celle-ci à des entrepreneurs privés dont certains ont progressivement acquis des capacités de capture et de remobilisation des ressources de la violence à des fins économiques et politiques. Au fond, les terroristes veulent l’effondrement de la société de Droit dont ils menacent, entre autres assises profondes, la sécularisation. Au Mali, par exemple, les territoires occupés par les groupes terroristes sont administrés selon les règles de la loi islamique, parfois en collusion avec les chefs traditionnels.
Lire la chronique – L’automne du père de la désenghorisation
Les pays de l’Aes, où l’idée même de l’Etat est remise en cause et délégitimée par la propagande terroriste, ont montré toutes leurs limites. Les nouveaux acteurs de la guerre, qui ont thésaurisé énormément de ressources pour saper l’ordre du politique, opèrent dans la mobilité et dans l’imprévisibilité. Alors que la stratégie des Etats se fonde sur la maîtrise des territoires et des frontières, celle des groupes terroristes repose sur la maîtrise du mouvement et des réseaux sociaux et marchands. En raison de leur maîtrise parfaite du désert dont l’une des caractéristiques est d’être fluctuants au gré des événements climatiques, les terroristes, munis de pick-up et de deux-roues, ont la capacité de se déplacer sur des distances considérables, d’entretenir des alliances changeantes et bâtardes, de privilégier les flux au détriment des territoires et de la fixité. Ils sévissent dans la mobilité, et réinventent au quotidien leurs méthodes de tuer, d’endoctriner les masses vulnérables en usant de divers procédés.
Lire la chronique – Restituer le patrimoine africain
J’ai lu le dernier rapport de Timbuktu Institute : Menace du Jnim dans la région des trois frontières du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal. Ce centre de recherches, fondé par le Dr Bakary Samb, travaille sur les questions de sécurité et leurs causes en Afrique. Lorsque ce document a été publié, des grognards ont considéré les chercheurs comme des suppôts de Cassandre. Ou, selon l’antienne nationale que les factotums de la révolution psalmodient à l’envi, comme des ennemis du «Projet». Certains de nos politiciens professionnels dont les esprits sont naturellement préoccupés par des vétilles, n’ont pas pipé mot sur le sujet.
[themoneytizer id= »124208-2″]
A la page 4 du rapport, il est écrit que le «Jnim (Jama’at nusrat al-Islam wal-muslimîn) a considérablement accru son activité dans la région de Kayes au cours des trois dernières années. En 2024, il a multiplié à plus de sept fois ses actions violentes dans la région, comparées à 2021. Dans cette région de Kayes, le Jnim a attaqué des installations des Forces de sécurité, des postes de douane et des convois sur les routes principales menant à Bamako, ainsi qu’en Mauritanie et au Sénégal». C’est dire que les terroristes -qui sont actifs dans des secteurs économiques comme l’élevage, les vols de bétail à grande échelle, la contrebande, l’extraction de l’or, l’exploitation forestière, etc.- investissent dans la région des trois frontières non seulement pour se positionner comme un acteur essentiel dans la vie socio-économique des communautés transfrontalières, mais aussi pour contrôler l’ensemble des transits de ce point névralgique. Ce nouveau positionnement si inquiétant pour la Mauritanie et le Sénégal, qui se fait par la diplomatie et la répression, est aussi motivé par l’ambition d’enclaver Bamako, d’attaquer les grandes traites, et de maîtriser les points d’approvisionnement de la capitale malienne.
Sur le plan théorique, ces activités économiques du Jnim permettent de s’interroger sur les vrais mobiles du terrorisme dans le Sahel. Dans sa thèse de doctorat en sociologie (Terrorisme au sahel : de la guerre idéologique au business criminogène, présentée et soutenue publiquement le 24 septembre 2019 à l’Université de Bourgogne-Franche-Comté), Abdoul Aziz Issaleye nous propose un autre récit sur le terrorisme. Selon lui, l’argument du radicalisme religieux qu’une vaste littérature occidentale ne cesse de brandir, effleure le phénomène. Pour une bonne compréhension de celui-ci, il faut l’enchâsser dans son contexte, car, écrit-il, «en examinant la situation de près, on se rend à l’évidence que ce sont surtout les problèmes locaux, c’est-à-dire la misère, le désœuvrement, le sentiment d’exclusion, les tensions ethniques, entre autres, qui ont servi de terreau au phénomène du terrorisme dans cette région».
Lire la chronique – Du souverainisme au kémalisme
Qui pis est, le rapport, dans sa page 8, dit que «si des mesures économiques efficientes ne sont pas prises, le Jnim pourrait faire de nouvelles percées au Sénégal et en Mauritanie, et recruter au sein de l’importante population juvénile désillusionnée par sa situation économique». En d’autres termes, les conscrits sont en grande partie motivés par des raisons économiques, des frustrations ; le Jnim, en raison de sa capacité à produire un imaginaire, réussit par moments à se présenter comme un pis-aller pour ces laissés-pour-compte. La solution militaire (le tout militaire), quoique fondamentale, est donc réductrice et lacunaire. Il faut, préconisent à juste titre les auteurs du rapport, une approche holistique qui combine solutions économiques et récits fondateurs.
[themoneytizer id= »124208-19″]
Notre pays, souligne le rapport, présente des facteurs de résilience tels que la «prévalence de la cohésion sociale sur la violence», la «modération religieuse largement répandue» et le «professionnalisme de ses Forces de défense et de sécurité». Mais il a aussi des facteurs de vulnérabilité liés à ses «frontières poreuses», à la «méconnaissance de la menace par les populations locales», celles des régions de Kédougou, Matam et Tambacounda, à la «propagation du salafisme» et aux «griefs socio-culturels et religieux». Défis qui doivent nous
intimer d’être davantage sur le qui-vive, de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires, ceux avec lesquels nous sommes innervés par la géographie et l’histoire, pour prendre à bras-le-corps la menace terroriste.
Par Baba DIENG

