Senghor, Sa Nègre Attitude
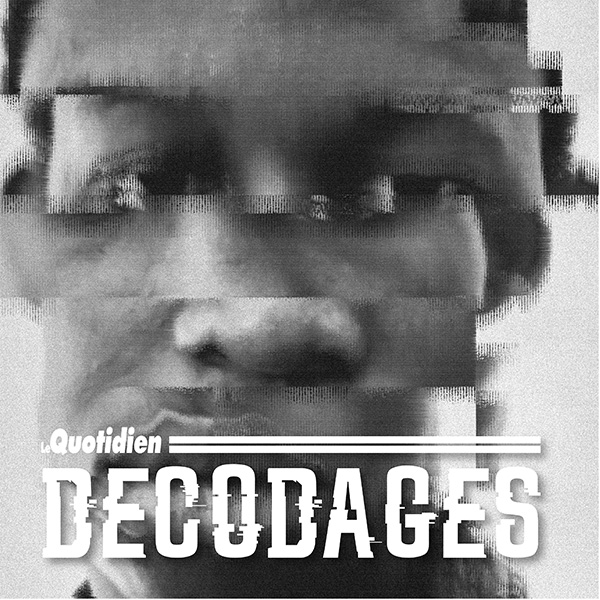
Le journaliste Ibou Fall m’a fait l’amitié de m’envoyer son livre remarquable sur le poète-Président Léopold Sédar Senghor : Senghor, Sa Nègre Attitude (Editions Forte impression, 2021). Avec un récit poignant et vif -Ibou ferait un excellent romancier-, le satiriste, fin connaisseur du Sénégal et de ses mœurs, nous propose un nouveau récit sur celui qu’il appelle affectueusement Sédar Gnilane. C’est un opus salvateur, dans la mesure où la figure du Président Senghor est bardée d’épithètes loufoques, d’idées reçues, de qualifications injustes, fabriquées de toutes pièces par les «ploucs maniérés à la préciosité surfaite». La scatologie et la vulgarité prennent le pas sur l’argumentation. Senghor est présenté, selon une idée malheureusement très répandue, comme un Nègre dont la proclamation de la négritude n’est que le masque d’une francophilie aliénante. Peau noire, masques blancs, pour les lecteurs de Frantz Fanon.
Le récit s’ouvre sur le départ volontaire de Sédar Gnilane, en décembre 1980. Cet acte symbolique que ses détracteurs gérontocrates ont vu comme une trahison, Ibou le qualifie d’«art de partir qui relève du savoir-vivre». Nous pourrions ajouter le sens de l’histoire. C’est cette lucidité, cette grande idée du Sénégal, qui lui a permis de préférer l’écriture positive de son nom à grands traits dans les manuels d’histoire aux dorures et lambris du pouvoir. Entré incidemment en politique, l’intellectuel méthodique et organisé, semble-t-il, y a trouvé ses marques, sa vocation, l’occasion rêvée pour lui d’inviter son minuscule Peuple au grand rendez-vous de l’Universel, tout en fécondant des décennies durant ce que le Pr Souleymane Bachir Diagne appelle le «mouvement d’une pensée», c’est-à-dire une action politique intimement liée à la fabrique de discours et de savoirs à même de comprendre, d’expliquer et d’attaquer les défis auxquels sont confrontés ses hédonistes compatriotes, l’Afrique et, bien sûr, notre monde. Une pensée aussi dense que complexe, plus actuelle comme jamais dans un monde où les tribus planétaires imposent leur loi, est sortie de la vie exceptionnelle de cette voix singulière du XXe siècle.
Avec une érudition très séduisante, Ibou Fall nous aide à mieux comprendre la figure extrêmement complexe de Senghor. Cet homme dont les mille et une vies sont reliées par ce fil rouge : créer des ponts entre des différentes cultures dont l’histoire a décrété à première vue la nature toujours conflictuelle de leurs relations. L’enfant, qui fuyait le luxe de la maison de Diogoye Basile Senghor, a été le père de l’homme dont le rapport avec la mondanité restera toujours marqué par la tenue et la retenue, par le stoïcisme et le sens élevé de l’intérêt général, par le rejet formel de l’hédonisme et le culte du travail. L’agrégé de grammaire, le «député kaki», celui que les anti-senghoriens présentent à tort comme un «Blanc-Noir» (pour parler comme Amadou Hampâté Bâ), avait l’intelligence et la capacité de se fondre dans la tourbe, pour porter ses combats les plus difficiles à mener. C’est cette approche par le bas de la politique qui lui a valu sa victoire éclatante aux Législatives de 1951, sous la bannière du Bloc démocratique sénégalais (Bds). Le «Parti des Badolos» dicta sa loi à la Sfio de son ex-mentor Lamine Guèye : 213 182 voix, soit 67 % des suffrages exprimés.
Le récit de Ibou Fall est aussi une description assez savoureuse de nos mœurs et maquignonnages. Senghor, Sa Nègre Attitude est une belle fresque de l’histoire politique de notre pays, de ses goûts, de ses imaginaires, de son intimité, de ses forces et faiblesses, de sa nature bâtarde car étant une «créature de la France», de ses grands hommes. Ibou nous propose aussi d’importants portraits d’hommes et de femmes qui ont posé les premiers pilastres de notre Etat : Mamadou Dia, Valdiodio Ndiaye, Babacar Bâ, André Peytavin, Amadou Cissé Dia, Me Abdoulaye Wade, Jean Collin, le Président Abdou Diouf, Me Doudou Thiam, Caroline Faye, et même l’écrivain et cinéaste Ousmane Sembène, pour ne citer que quelques-uns.
L’hagiographie que Ibou Fall consacre à Sédar Gnilane a le mérite de ne pas occulter ce que l’on peut appeler la face nocturne du règne senghorien. Il est vrai qu’au sortir de la crise de décembre 1962, Senghor -«traumatisé» et
seul aux commandes de notre Etat naissant, après avoir «conjuré» son ami Mamadou Dia que les pouvoirs et orientations avaient transformé en adversaire ombrageux- décida de durcir son régime. Les années 1960 furent marquées par une violence d’Etat sans précédent. Les partis dissidents furent apprivoisés soit par le levier de la cooptation, soit par celui de la répression -tradition que nos mœurs politiciennes n’ont toujours pas abandonnée. Une forme d’unification des intérêts et points de vue, comme le veulent les théoriciens libéraux de la démocratie, fut instituée, à partir de 1966. Mais Senghor, humaniste et homme de culture ouvert sur le monde, était très sensible à l’image que son règne donnait à la Communauté internationale. C’est la raison pour laquelle il gouvernait en s’appuyant sur ce que Pierre Fougeyrollas, gauchiste et philosophe, considère comme des «soupapes de sûreté», c’est-à-dire l’ensemble des équilibres et consensus trouvés avec l’élite maraboutique, les syndicats, les universitaires, les étudiants, etc., pour garantir une relative stabilité. Ces amortisseurs de crises ont permis en grande partie au poète-Président de faire l’économie de la violence dans une époque où les partis uniques en Afrique régnaient par le truchement de boucheries absolues.
Ibou Fall a écrit un livre sensationnel sur la nègre attitude de Senghor, celui à qui nous devons les victoires exceptionnelles de notre contrat social. Mais aussi l’utopie de féconder nos possibles au moyen de la culture. Le Premier ministre Ousmane Sonko, en citant Senghor, a récemment déclaré que le travail culturel est au début et à la fin de tout processus de développement. Est-ce le signe qui annonce que notre pays est en train de redevenir senghorien, après plusieurs décennies d’aventure ?
POST-SCRIPTUM : J’ai suivi le journaliste Papa Ngagne Ndiaye défendre mordicus, devant plusieurs de ses invités -Madiambal Diagne, Moustapha Diakhaté et Pape Mahawa Diouf-, l’idée selon laquelle en démocratie, les minoritaires doivent raser les murs au profit des majoritaires. Cette monomanie est conceptuellement erronée et politiquement dangereuse. Car, dans la politique démocratique, la protection des minorités, quelles que soient leurs orientations politiques et sociales, est un impératif catégorique. En démocratie, les adversaires acceptent tout simplement d’être battus aux voix et s’engagent aussitôt dans une lutte pour le triomphe d’un nouveau projet politique hégémonique -au sens agonistique que la philosophe belge Chantal Mouffe donne à la politique. La tyrannie de la majorité, antidémocratique, est donc une manière de favoriser la prolifération des antagonismes, créant ainsi les conditions de destruction de la communication politique.
Par Baba DIENG

